« J’ARRIVAIS PAS A DORMIR » de Ahmed Kalouaz (Editions le Mot et le reste, 2018)
Depuis des décennies, Ahmed Kelouaz parsème son chemin et le nôtre de recueils de textes en prose qui sont pure poésie. Il y en a ici quarante-deux, qui ont à peu près trois pages chacun, et qui pour cette raison n’ont pas le temps de peser ni d’épuiser—ce dont on lui est extrêmement reconnaissant. Les mots sont ses fidèles et inséparables compagnons, et on se dit qu’il a bien raison de leur faire confiance car ils ne le trahissent jamais. Le compagnonnage intime, tout de complicité, qu’il y a entre eux et lui, est une des grâces dont le lecteur a la chance de bénéficier. On traverse le langage, on en éprouve la transparence, il nous emmène sur des traces plutôt que sur de véritables chemins destinés à aboutir où que ce soit. Le monde à travers lequel on suit l’auteur donne parfois l’impression d’être presque imperceptible, ou plutôt il le serait si nous n’étions guidés par lui, rendus aptes par lui à déceler ce qu’il y a de présence, ô combien précieuse, dans la presque absence d’un monde en voie d’effacement.
 Car s’il évite la lourdeur des constats trop explicites, Ahmed Kalouaz sait joindre à sa discrétion une sorte d’évidence concernant les villages et hameaux auxquels il continue depuis de décennies de rendre visite, par de petites routes écartées qui ont l’objet de sa pré dilection : celles du sud-est comme du sud-ouest, parfois aussi celles du Val de Loire et de la Bretagne; quelque indice à chaque fois nous aide à situer le pays dont il parle, car il le connaît si bien qu’il lui suffit pour cela de très peu de mots. En quoi consiste cette évidence, à la fois non dite et omniprésente ? C’est l’évidence chargée de nostalgie que tout ce monde qu’il aime est désormais en voie d’effacement et qu’il faut savoir, à travers les mots de ceux qui en parlent, ce qu’il était beaucoup plus que ce qu’il en reste maintenant.
Car s’il évite la lourdeur des constats trop explicites, Ahmed Kalouaz sait joindre à sa discrétion une sorte d’évidence concernant les villages et hameaux auxquels il continue depuis de décennies de rendre visite, par de petites routes écartées qui ont l’objet de sa pré dilection : celles du sud-est comme du sud-ouest, parfois aussi celles du Val de Loire et de la Bretagne; quelque indice à chaque fois nous aide à situer le pays dont il parle, car il le connaît si bien qu’il lui suffit pour cela de très peu de mots. En quoi consiste cette évidence, à la fois non dite et omniprésente ? C’est l’évidence chargée de nostalgie que tout ce monde qu’il aime est désormais en voie d’effacement et qu’il faut savoir, à travers les mots de ceux qui en parlent, ce qu’il était beaucoup plus que ce qu’il en reste maintenant.
Crédit Patrice Normand Opale
La poésie de chacun des poèmes en prose qui constituent le recueil est un certain art de dire le peu de réalité que le promeneur–enquêteur impénitent est amené à rencontrer, et le pouvoir d’évocation d’autant plus grand de ces traces pour qui prend le temps d’en ressentir la présence en suspens. Comme dans la poésie préislamique, ce à quoi les mots renvoient est le passage de la caravane qui désormais n’est plus là. La poésie de cette prose que nous offre Ahmed Kalouaz vient justement du fait que ce dont il parle s’est dépouillé en grande part de sa matérialité. Ou presque, car c’est justement dans cet effet de « presque rien » que la 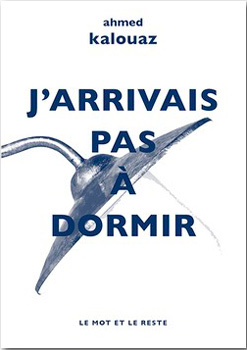 poésie trouve son lieu. Tel était le langage du philosophe Jankélévitch, qui en 1980 employait cette formule dans un de ses titres célèbres—bien qu’il ne fasse pas partie des références d’Ahmed Kalouaz, si nombreuses qu’elles soient. Ces références qu’on trouve presque à chaque chapitre renvoient le plus souvent à des poètes, comme René Char, Eluard, Aragon, ou à des chanteurs tels que Jacques Brel ou Jean Ferrat. Mais la manière dont l’auteur s’y prend pour qu’ils soient présents dans son texte ne consiste pas en rapprochements explicites, il est bien davantage adepte d’un mode allusif, qui donne le sentiment que ces gens l’accompagnent, qu’ils sont présents en lui et avec lui comme des compagnons de longue date, auxquels il est uni par empathie.
poésie trouve son lieu. Tel était le langage du philosophe Jankélévitch, qui en 1980 employait cette formule dans un de ses titres célèbres—bien qu’il ne fasse pas partie des références d’Ahmed Kalouaz, si nombreuses qu’elles soient. Ces références qu’on trouve presque à chaque chapitre renvoient le plus souvent à des poètes, comme René Char, Eluard, Aragon, ou à des chanteurs tels que Jacques Brel ou Jean Ferrat. Mais la manière dont l’auteur s’y prend pour qu’ils soient présents dans son texte ne consiste pas en rapprochements explicites, il est bien davantage adepte d’un mode allusif, qui donne le sentiment que ces gens l’accompagnent, qu’ils sont présents en lui et avec lui comme des compagnons de longue date, auxquels il est uni par empathie.
Il se pourrait d’ailleurs que ce dernier mot soit un mot clef pour tout le recueil. Car c’est aussi de l’empathie qui unit l’auteur aux gens dont il parle, souvent des anonymes rencontrés ici ou là brièvement mais dont il ressent les sentiments même à travers leur peu de mots. Ce sont des gens qui ont connu des jours meilleurs— sans doute parce qu’ils l’étaient objectivement et parce qu’eux-mêmes étaient plus jeunes pour les apprécier—mais qui pour autant ne se laissent pas aller à des regrets bavards ni au gémissement. Or lui-même, l’auteur, si discrètement que ce soit, éprouve aussi le sentiment du temps qui passe et de la jeunesse qui est partie avec lui. A soixante-cinq ans (né en 1952 en Algérie), comment pourrait-il être encore le jeune vagabond qu’il a été, courant allégrement par des chemins « buissonniers » (un mot qu’il affectionne) ? En quoi il rejoint la grande tradition poétique illustrée par Ronsard : « Las ! Le temps non, mais nous nous en allons ».
Denise Brahimi
(article repris du N° 25 (octobre 2018) de la lettre mensuelle de la section Auvergne- Rhône- Alpes de Coup de Soleil)
