« L’EXIL D’OVIDE » de Salim Bachi (éditions JC Lattès, 2018)
Les livres de cet auteur se succèdent de très près, au point qu’il en publie deux dans cette même année 2018. Et cela fait au total une bonne douzaine depuis qu’il a commencé à écrire, d’emblée chez Gallimard et récompensé par des prix, avec Le Chien d’Ulysse en 2001. Que ce soit ce premier titre ou son dernier L’exil d’Ovide, on ne peut manquer de remarquer que Salim Bachi trouve la source de ses livres dans ses connaissances littéraires, puisant dans la culture classique qui se trouve être ici européenne mais qui est d’autres fois celle du monde musulman.
Pour autant, et c’est toute son originalité ainsi que son talent d’écrivain, cet auteur ne nous accable jamais de son érudition, ses livres restent légers, ce qui ne veut pas dire qu’ils aient peu de contenu, mais plutôt que ce contenu est présenté sous une forme très fluide et toujours personnalisée. Cela signifie que le savoir dont Salim Bachi fait état porte le reflet de sa situation et de ses sentiments et se trouve intégré à sa propre vie. L’autobiographie est présente dans ses livres sous une forme qui va au-delà des allusions sans aller jusqu’à devenir pesante elle non plus, et contrairement à ce qui se passe dans une partie de la production romanesque contemporaine, nous ne sommes nullement dans l’autofiction.
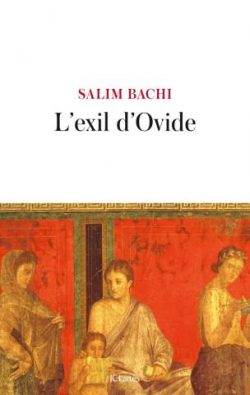 Pour comprendre cela, L’exil d’Ovide est un bon exemple : Ovide est ce poète latin qui fut exilé par l’Empereur Auguste au début de notre ère, pour quelque indiscrétion commise malgré lui. Après quoi il ne put jamais revenir à Rome et passa donc le reste de sa vie, une bonne dizaine d’années, à chanter tristement son exil dans un îlot perdu de la Mer Noire alors appelée Pont-Euxin : d’où le titre, qui est géographique, de l’un de ses recueils de vers, Les Pontiques, tandis que l’autre, de manière bien plus significative, s’intitule Les Tristes. Alors qu’il avait écrit avant cet exil sur bien d’autres sujets plus riants, Ovide ne peut finalement exprimer rien d’autre que cette douleur de l’exil sous la forme d’un lyrisme poétique pour lequel il sert désormais de référence. Et c’est bien ainsi que Salim Bachi s’empare de son nom, pour en faire le modèle exemplaire de ce qu’il vit lui-même, depuis qu’il a quitté l’Algérie pour la France pendant la tristement fameuse décennie noire.
Pour comprendre cela, L’exil d’Ovide est un bon exemple : Ovide est ce poète latin qui fut exilé par l’Empereur Auguste au début de notre ère, pour quelque indiscrétion commise malgré lui. Après quoi il ne put jamais revenir à Rome et passa donc le reste de sa vie, une bonne dizaine d’années, à chanter tristement son exil dans un îlot perdu de la Mer Noire alors appelée Pont-Euxin : d’où le titre, qui est géographique, de l’un de ses recueils de vers, Les Pontiques, tandis que l’autre, de manière bien plus significative, s’intitule Les Tristes. Alors qu’il avait écrit avant cet exil sur bien d’autres sujets plus riants, Ovide ne peut finalement exprimer rien d’autre que cette douleur de l’exil sous la forme d’un lyrisme poétique pour lequel il sert désormais de référence. Et c’est bien ainsi que Salim Bachi s’empare de son nom, pour en faire le modèle exemplaire de ce qu’il vit lui-même, depuis qu’il a quitté l’Algérie pour la France pendant la tristement fameuse décennie noire.
Cependant, à la différence du sort qu’Ovide s’est vu imposer, l’Algérien en exil a toute latitude pour voyager et devient une sorte d’errant qui promène sa tristesse ou son mal de vivre dans un certain nombre de grandes villes européennes. Ce sont des villes éminemment littéraires, ce qui veut dire qu’à leur nom s’attache celui d’un écrivain, parmi les plus célèbres, ou sinon son nom du moins le titre d’une de ses œuvres. Salim Bachi établit avec celles-ci, d’une manière qui semble très naturelle et très spontanée, un rapport de compréhension voire d’empathie, il partage les amours et les douleurs qui s’y expriment, et il n’oublie jamais de rappeler les situations historiques déterminantes de toutes les vies individuelles dont elles commandent le déroulement.
C’est pourquoi d’une manière apparemment simple, on apprend beaucoup à lire Salim Bachi. Il réactive des savoirs qu’on aurait cru un peu perdus dans les tréfonds d’une mémoire devenue inactive et il leur redonne une présence actuelle , comme si c’était nous-mêmes qui revivions les faits. Les différents chapitres, c‘est-à-dire les différentes villes ou les différentes œuvres qui sont présentes dans son livre, n’y sont pas toutes de la même façon, ce qui fait qu’on n’a jamais l’impression de lire une notice bio-bibliographique pour les secondes, encore moins touristique pour les premières.
D’ailleurs le tourisme (le fameux tourisme de masse qui l’emporte sur tous les autres aujourd’hui) est son ennemi, contre lequel il vitupère, particulièrement dans les pages consacrées à Rome où il a séjourné durablement grâce à une bourse d’écrivain à la Villa Médicis, située sur la colline du Pincio, en plein cœur de la ville. La ville ne lui a pas plu et ce n’est pas seulement parce qu’il adopte les sentiments de l’Irlandais James Joyce à son égard. Rome lui paraît comme érodée, vidée de son esprit ou de son âme par le flot touristique incessant et l’enlaidissement cruel dont il est cause. Il en est ainsi pour quelques autres hauts lieux du tourisme international dont Paris pourrait bien faire partie.
Lisbonne en revanche lui convient et c’est une ville pour laquelle il ressent des affinités, peut-être parce que la symbiose des lieux avec l’écrivain qui les a habités, Pessoa, est particulièrement intime et poétique. Il dit d’ailleurs qu’il se sent des points communs avec Pessoa, connu pour avoir publié sous des noms multiples ou hétéronymes qui lui permettaient de démultiplier sa personnalité.
 Il existe cependant au moins un lieu pour lequel il ne passe pas par la médiation d’un autre écrivain que lui-même et ce lieu est Grenade, qui occupe certainement une place à part dans sa vie et sa sensibilité, si l’on en juge par le fait qu’en 2005 il a publié un livre intitulé Autoportrait avec Grenade, récit, (Le Rocher). Comme dans le présent livre, il évoque les palais et jardins qui font la célébrité de la ville andalouse, mais plus encore son histoire personnelle d’homme qui s’est trouvé malade et hospitalisé dans cette ville avant que ne resurgisse sa force physique de manière inespérée. Il faut peut-être comprendre que dans cet exercice d’associations entre villes et écrivains qu’est L’exil d’Ovide, celle à laquelle il aspire est ou serait l’association entre lui-même et Grenade,—mais peut-être lui faudra-t-il encore un certain nombre de livres pour y arriver.
Il existe cependant au moins un lieu pour lequel il ne passe pas par la médiation d’un autre écrivain que lui-même et ce lieu est Grenade, qui occupe certainement une place à part dans sa vie et sa sensibilité, si l’on en juge par le fait qu’en 2005 il a publié un livre intitulé Autoportrait avec Grenade, récit, (Le Rocher). Comme dans le présent livre, il évoque les palais et jardins qui font la célébrité de la ville andalouse, mais plus encore son histoire personnelle d’homme qui s’est trouvé malade et hospitalisé dans cette ville avant que ne resurgisse sa force physique de manière inespérée. Il faut peut-être comprendre que dans cet exercice d’associations entre villes et écrivains qu’est L’exil d’Ovide, celle à laquelle il aspire est ou serait l’association entre lui-même et Grenade,—mais peut-être lui faudra-t-il encore un certain nombre de livres pour y arriver.
Le domaine germanique n’est pas exclu de ses réflexions, d’autant moins que c’est le plus politique de ceux qu’il aborde, avec Berlin Alexanderplatz d’Alfred Döblin et Le Docteur Faustus de Thomas Mann, l’un et l’autre exilés parce que fuyant le nazisme, ce qui entraîne Salim Bachi vers une vision particulièrement sombre de son sujet, associant la guerre et l’exil et prenant pour fond la déroute morale d’un pays. Salim Bachi pense d’autant plus sûrement à l’Algérie qu’elle était déjà à l’origine de son premier livre sur Grenade, l’ Autoportrait… et au cœur de son roman de 2017 Dieu, Allah, moi et les autres.
Denise Brahimi
(extrait de la Lettre culturelle franco-maghrébine N° 30, Coup de Soleil Lyon)
