Editorial
Une fois n’est pas coutume, le dernier mois de l’année étant celui des fêtes, dans la Lettre aussi c’est le moment de mettre en avant le plaisir, celui du spectacle. C’est pourquoi nous commencerons par l’évocation de 3 films, un marocain qui était attendu depuis longtemps : celui de Nabil Ayouch « Tout le monde aime Touda », un franco algérien de Hassan Guerrar : « Barbès Little Algérie », dont le titre indique suffisamment le lieu de l’action, et celui de la Canado-tunisienne Meryam Joobeur « La Source » qui se passe nous dit-on dans un village reculé de Tunisie. On voit que l’ensemble assure équitablement l’apport des 3 pays du Maghreb.
Pour rendre hommage au thème dominant de ce qui s‘écrit depuis quelques années, la Lettre vous présente cette fois 3 livres consacrés à des femmes, leur présence étant devenue incontournable dans nos préoccupations actuelles. Il peut s’agir de femmes anonymes, comme dans le livre de Nora Aceval, grande spécialiste du conte oral, qui attire cette fois notre attention sur la « Sagesse des femmes du Maghreb ». Mais on trouve aussi dans cet ensemble la présence de femmes plus ou moins célèbres : Tin Hinan, historique et mythique à la fois, est l’héroïne du livre de Kader Gaïd « Tin Hinan, la reine du sud ». Une autre dont parle Driss Riffas, « La Berbère donatiste », est beaucoup moins connue sans doute mais c’est une raison de plus pour s’y intéresser.
Viennent enfin les essais et documents. Les amateurs de livres vraiment sérieux, substantiels et qui donnent à penser aimeront les Mémoires de Madjid Benchikh (né en 1937) : « Chemin de vie ».
Tous les cinéphiles savent à quel point l’œuvre d’Ahmed Bedjaoui est indispensable en la matière et c’est plus que jamais le cas du dernier, « Le cinéma algérien en 44 leçons ».
Enfin nous évoquerons le livre de Boualem Sansal : « Le français, parlons-en », ne serait-ce que pour formuler clairement notre position sur ce qui agite actuellement le monde littéraire et au-delà en France et en Algérie :
Quoi qu’on puisse dire de ce que Boualem Sansal écrit, c’était une erreur impardonnable de l’emprisonner et c’est une urgence absolue de le libérer.
Rassurez-vous, Michel Wilson n’a pas n’a pas oublié la part des images qui contribueront à vous divertir ce mois-ci. Celles des tableaux de Serge Vollin qui illustrent « La petite jupe verte » de Fatima Besnaci Lancou. Il évoque également le livre pour la jeunesse « Banale flambée dans ma cité », de Mabrouck Rachedi.
Denise Brahimi
NDLR Que notre Lettre de début d’année vous apporte un message de bonheur et d’amitié. En évoquant le dernier livre de Boualem Sansal, et lui donnant ainsi un peu la parole, qu’elle contribue à ce qu’il retrouve vite sa liberté, un bien précieux que les artistes, encore moins que toute autre personne, ne devraient jamais se voir retirer.

Peut-être souhaitez-vous faire un don à notre association, pour contribuer à notre fonctionnement? Et notamment au coût de réalisation de cette Lettre?
Vous en avez la possibilité en cliquant ICI. Merci d’avance!
Et si vous souhaitez nous faire le plaisir de nous rejoindre en adhérant, c’est LA!

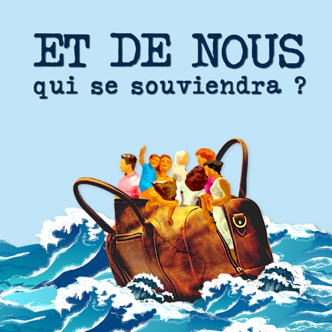 « Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).
« Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).
Hommage à une communauté en voie de disparition, il a pour objectif d’aider les pieds-noirs à transmettre. Il s’adresse à leurs descendants, aux enseignants qui souhaitent parler de la guerre d’Algérie, et plus largement à tous ceux qui s’intéressent aux exils et à la résilience. Il interroge l’exil comme acte fondateur ainsi que les questions d’identité, d’invisibilité et d’intégration. Il pose également la question de la transmission et de la mémoire des pieds-noirs.
Le projet a démarré en janvier 2022, année de commémoration du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.
Pour écouter les épisodes déjà parus : https://podcast.ausha.co/et-de-nous-qui-se-souviendra

« TOUT LE MONDE AIME TOUDA », film de Nabil Ayouch 2024
On retrouve dans ce dernier film de Nabil Ayouch nombre des problèmes douloureux qui grèvent la société marocaine, notamment celui de la jeune mère seule qui n’a guère d’autre ressource pour faire vivre son enfant que la prostitution. Il oppose ainsi de manière touchante voire pathétique la tendresse de l’amour maternel à la violence de la misère qui n’épargne pas les enfants. Il en est ainsi par exemple dans une grande ville telle que Casablanca, sur laquelle il porte dans chacun de ses films ou presque un regard plein de détresse et d’amour qui est bouleversant.
 Cependant, dans celui-ci qui est consacré au personnage de Touda (incarné par l’actrice Nisrin Erradi) il insiste cette fois bien davantage sur le fait qu’un autre mode de vie aurait pu exister pour les femmes en dehors de la soumission et de l’humiliation, et peut-être même a-t-il existé, de manière plus ou moins mythique, dans quelque endroit ou à quelque moment du passé. De cela on aurait au moins une preuve dans une expression musicale singulière, saisissante, qui dit sous la forme d’un cri transformé en chant ce qu’il en est de la révolte des femmes, de leur aspiration à une vie libre et émancipée. Cette musique s’entend dans un chant traditionnel berbère étrange connu sous le nom d’Aïta, où l‘on sent la rémanence d’un passé sans doute très ancien. Il est l’apanage de certaines chanteuses, les Cheikhates dont la vie et l’art sont aujourd’hui mal connus, ce qui a incité Nabil Ayouch à les approcher pour tâcher de les comprendre mieux.
Cependant, dans celui-ci qui est consacré au personnage de Touda (incarné par l’actrice Nisrin Erradi) il insiste cette fois bien davantage sur le fait qu’un autre mode de vie aurait pu exister pour les femmes en dehors de la soumission et de l’humiliation, et peut-être même a-t-il existé, de manière plus ou moins mythique, dans quelque endroit ou à quelque moment du passé. De cela on aurait au moins une preuve dans une expression musicale singulière, saisissante, qui dit sous la forme d’un cri transformé en chant ce qu’il en est de la révolte des femmes, de leur aspiration à une vie libre et émancipée. Cette musique s’entend dans un chant traditionnel berbère étrange connu sous le nom d’Aïta, où l‘on sent la rémanence d’un passé sans doute très ancien. Il est l’apanage de certaines chanteuses, les Cheikhates dont la vie et l’art sont aujourd’hui mal connus, ce qui a incité Nabil Ayouch à les approcher pour tâcher de les comprendre mieux.
Dans le film, il en parle à travers Touda, qui aspire à devenir Cheikha mais qui découvre le profond malentendu dont ces femmes sont victimes. Car la liberté à laquelle elles aspirent et qu’elles tentent de mettre en œuvre dans leur propre manière de vivre est confondue, notamment par les hommes, avec un libertinage sans frein donnant toute liberté de les approcher et d’user d’elles sexuellement.
Ce qui peut aller jusqu’au viol, comme le prouve la première scène du film au cours de laquelle Touda subit cette maltraitance et cette humiliation. Elle comprend à cette occasion l’énorme contresens dont sont victimes des jeunes femmes comme elles, danseuses et chanteuses couramment confondues avec des prostituées du fait qu’elle sont amenées à se produire dans des cabarets sordides, où s’exprime sans fard le désir sexuel des hommes. On voit d’assez près celui ou ceux qui permettent à Touda de survivre avec son enfant handicapé dans une petite ville de province miséreuse, où on veut la réduire par la force à n’être rien d’autre qu’une chanteuse de variété. Cette situation insupportable fait qu’elle décide de partir à Casablanca, ce qui est un projet audacieux, signe de sa nature intrépide et de son indomptable volonté.
Touda voit dans ce départ la possibilité de réaliser un double projet, devenir une cheikha au sens où elle l’entend et mettre son fils dans une école où l’on éduque les enfants handicapés comme lui. Toute la seconde moitié du film consiste en la mise en question de ce que Touda a cru et voulu en venant à Casablanca.
Pour Touda, l’avenir de son fils passe par la prise en charge de son handicap dans un lieu spécialisé et ce qu’on en voit fait qu’on est prêt à partager son espoir. Cependant, avant d’arriver à Casablanca, elle a fait étape avec lui en pleine campagne, chez ses parents, où elle compte le laisser quelque temps seulement. Et il s’est avéré que l’enfant y était parfaitement heureux. Elle aussi d’ailleurs pendant le peu de temps qu’elle y a passé avec lui et qui a donné au spectateur le sentiment d’une sorte de paradis merveilleux, où pour la première fois on a vu Touda sourire, toute à la joie enfantine de s’amuser avec son petit garçon. L’impression se confirme lorsqu’elle téléphone ensuite de Casablanca pour savoir comment il va : il est parfaitement bien à gambader dans la campagne avec les moutons de la ferme, c’est la vie qui lui convient—mais peut-elle de gaîté de cœur le laisser là et renoncer pour lui à tout autre avenir ?
 Le réalisateur laisse la question ouverte, Touda ayant son propre problème à régler à Casablanca : trouver du travail dans un lieu qui lui permettra de devenir cheikha. Et l’on assiste alors à sa très cruelle désillusion, car elle constate la même attitude à tous les niveaux de la société, ce qui est justement l’idée que Nabil Ayouch veut faire apparaître par la construction de son film. La première partie montrait la grossièreté du désir masculin dans le cadre miséreux de la petite ville mais la dernière partie en est la réplique identique à un tout autre niveau de la société, celui du luxe et de la richesse évidente chez ceux qui ont le privilège d’assister au spectacle. Tel est bien le sens de la formule « Tout le monde aime Touda ». Ce « tout le monde » veut dire qu’il en est ainsi du haut en bas de la société et que le problème n’est pas social mais structurel. Touda, à nouveau réduite à la dimension sexuelle d’une femme qu’on peut acheter, est accablée par sa découverte et ne peut que fuir éperdument. On lit alors dans ses yeux agrandis par son désespoir le sentiment qu’elle éprouve de son impuissance, qui est aussi semble-t-il celle du réalisateur, bien incapable de suggérer une solution. Le spectateur est confondu de chagrin devant cette femme pathétique que son combat obstiné n’a conduit à aucune issue. Il fallait trouver l’actrice pour le dire et Nabil Ayouch l’a fait. Bien au-delà de ce qu’on appelle un problème social, le film conduit à la tragédie.
Le réalisateur laisse la question ouverte, Touda ayant son propre problème à régler à Casablanca : trouver du travail dans un lieu qui lui permettra de devenir cheikha. Et l’on assiste alors à sa très cruelle désillusion, car elle constate la même attitude à tous les niveaux de la société, ce qui est justement l’idée que Nabil Ayouch veut faire apparaître par la construction de son film. La première partie montrait la grossièreté du désir masculin dans le cadre miséreux de la petite ville mais la dernière partie en est la réplique identique à un tout autre niveau de la société, celui du luxe et de la richesse évidente chez ceux qui ont le privilège d’assister au spectacle. Tel est bien le sens de la formule « Tout le monde aime Touda ». Ce « tout le monde » veut dire qu’il en est ainsi du haut en bas de la société et que le problème n’est pas social mais structurel. Touda, à nouveau réduite à la dimension sexuelle d’une femme qu’on peut acheter, est accablée par sa découverte et ne peut que fuir éperdument. On lit alors dans ses yeux agrandis par son désespoir le sentiment qu’elle éprouve de son impuissance, qui est aussi semble-t-il celle du réalisateur, bien incapable de suggérer une solution. Le spectateur est confondu de chagrin devant cette femme pathétique que son combat obstiné n’a conduit à aucune issue. Il fallait trouver l’actrice pour le dire et Nabil Ayouch l’a fait. Bien au-delà de ce qu’on appelle un problème social, le film conduit à la tragédie.
Denise Brahimi
« BARBES, LITTLE ALGERIE», film de Hassan Guerrar 2024
Le titre de ce film est forgé d’après celui de James Gray, « Little Odessa » (1994). Dans ce dernier il s’agissait d’un quartier juif ukrainien de Brooklyn et le réalisateur s’y inspirait largement de l’histoire de sa propre famille immigrée aux USA dans les années 1920. Dans le film d’Hassan Guerrar, on se trouve dans le 18e arrondissement de Paris, au pied de la butte Montmartre, le point commun est qu’il s’agit dans les deux cas d’un quartier d’immigration, où la population immigrée est si dense qu’elle semble reconstituer son lieu d’origine dans son nouveau lieu ou lieu d’adoption. En fait, les gens qui vivent dans un  quartier comme Barbès sont le plus souvent des binationaux, dont le réalisateur Hassan Guerrar se fait le porte parole, et ils se vivent comme tels. Ce qui veut dire qu’ils sont les premiers à jongler avec leur double appartenance, à s’en amuser et à utiliser presque comme un code secret les liens de complicité qu’elle crée entre eux : compensation au fait de savoir que pour autant ils sont aussi des exclus enfermés dans leur ghetto plus facilement ouvert sur le ciel que sur le reste de la ville, a fortiori du pays. A Barbès, pour le petit groupe humain que nous fait connaître Hassan Guerrar, le ciel c’est Montmartre et sa colossale basilique qui est la limite de leur horizon.
quartier comme Barbès sont le plus souvent des binationaux, dont le réalisateur Hassan Guerrar se fait le porte parole, et ils se vivent comme tels. Ce qui veut dire qu’ils sont les premiers à jongler avec leur double appartenance, à s’en amuser et à utiliser presque comme un code secret les liens de complicité qu’elle crée entre eux : compensation au fait de savoir que pour autant ils sont aussi des exclus enfermés dans leur ghetto plus facilement ouvert sur le ciel que sur le reste de la ville, a fortiori du pays. A Barbès, pour le petit groupe humain que nous fait connaître Hassan Guerrar, le ciel c’est Montmartre et sa colossale basilique qui est la limite de leur horizon.
Du moins il en est ainsi pour les occupants des lieux installés depuis longtemps déjà, et qui vivent en toute familiarité au sein de ce cercle étroit. C’est forcément différent, pour des raisons diverses, avec les nouveaux arrivants. On fait connaissance avec l’un d’eux qui est le personnage principal du film, Malek (joué par le rappeur Sofiane Zermani), un homme d’une quarantaine d’années, blessé comme on le comprend dès qu’on le voit et avant même de savoir pourquoi. Il faut vraiment que d’anciennes connaissances insistent beaucoup pour qu’il s’habitue à les fréquenter, ce qui est d’autant plus une chance pour lui qu’il y a là une femme remarquable, Hadria, jouée par la non moins remarquable actrice Adila Bendimerad (vue notamment dans le film « La Dernière Reine », de 2022). En fait, c’est elle qui fait la force du quartier et qui lui assure un équilibre viable en dépit des violences destructrices qui le mettent en danger.
D’une autre manière que Malek, son jeune neveu Riyad qui arrive d’Alger découvre Barbès avec beaucoup de curiosité et même d’enthousiasme mais aussi avec une naïveté qui lui sera fatale.
Barbès, lieu clos sur lui-même est aussi un lieu dangereux notamment parce qu’il abrite mafieux et dealers. Même si la police y pénètre parfois en force et brutalement, ce n’est pas forcément aux vrais responsables qu’elle s’en prend, sans doute parce qu’ils sont assez forts pour lui échapper. Riyad, lui, a l’âme d’un gentil touriste qui aime bien voir du pays mais l’histoire racontée par le film montre que Barbès est en fait un lieu d’enfermement où il n’est pas possible de vivre avec innocence et légèreté.
Cependant l’impression qu’on y éprouve est complexe et contradictoire. Car c’est en même temps un lieu chaleureux, d’une grande solidarité, comme le prouve le comportement des habitants pourtant très variés qu’on voit à la fête de l’Aïd, à la fin du ramadan : ils sont heureux de vivre tous ensemble et dans la joie, malgré la mort qui vient de frapper, faisant sa victime du jeune et innocent Riyad. D’ailleurs cette solidarité est indispensable à leur survie et les habitants de Barbès le savent bien.
 Malek l’écorché vif finit par comprendre que ce n’est pas un lieu où cultiver sa solitude sur fond de rancœur personnelle. On apprend peu à peu qu’il a fui l’Algérie faute de pouvoir supporter la coexistence avec sa famille, où il se vit à tort ou à raison comme une sorte de mal-aimé. Se croyant exclu par les autres, il préfère s’exclure lui-même en partant.De manière inespérée, Barbès lui a apporté une forme d’intégration. On a le sentiment qu’à la fin de cette histoire (tragique), il a acquis une sorte d’humanité qui lui manquait auparavant. Telle serait la vertu de Barbès, un lieu qui tue et qui fait du bien.
Malek l’écorché vif finit par comprendre que ce n’est pas un lieu où cultiver sa solitude sur fond de rancœur personnelle. On apprend peu à peu qu’il a fui l’Algérie faute de pouvoir supporter la coexistence avec sa famille, où il se vit à tort ou à raison comme une sorte de mal-aimé. Se croyant exclu par les autres, il préfère s’exclure lui-même en partant.De manière inespérée, Barbès lui a apporté une forme d’intégration. On a le sentiment qu’à la fin de cette histoire (tragique), il a acquis une sorte d’humanité qui lui manquait auparavant. Telle serait la vertu de Barbès, un lieu qui tue et qui fait du bien.
Alors que l’histoire se passe à un moment où sévit partout en France l’épidémie du covid, Barbès donne un peu l’impression d’être un refuge, comme si le quartier était protégé par son statut de ghetto, même s’il ne s’agit que d’un sentiment subjectif éprouvé par les habitants et non d’une réalité. Il en va ainsi du particularisme et du repli, mortifère et pourtant senti comme un abri contre une faiblesse bien réelle mais qui par là se trouve déniée. Le sentiment dominant qu’éprouve le spectateur est la sympathie, le film est une leçon d’humanisme discrète et sans moralisation.
Denise Brahimi
« LA SOURCE» film de Meryam Joobeur, France, Canada, Tunisie, 2024
 La réalisatrice est une Canado-Tunisienne qui vit à Montréal, son film ne s’en passe pas moins en Tunisie, dans un village assez retiré semble-t-il, au bord de la mer et peuplé par des bergers éleveurs de moutons. C’est du moins le cas de la famille qui sera continûment au centre du récit, un couple de parents, Brahim et Aïcha, vivant avec leur jeune fils Adam qui est encore un enfant, délicieux, charmeur, sans doute un peu trop gâté par sa mère —et le père n’a pas l’air d’être en reste dans ce partage d’affection.
La réalisatrice est une Canado-Tunisienne qui vit à Montréal, son film ne s’en passe pas moins en Tunisie, dans un village assez retiré semble-t-il, au bord de la mer et peuplé par des bergers éleveurs de moutons. C’est du moins le cas de la famille qui sera continûment au centre du récit, un couple de parents, Brahim et Aïcha, vivant avec leur jeune fils Adam qui est encore un enfant, délicieux, charmeur, sans doute un peu trop gâté par sa mère —et le père n’a pas l’air d’être en reste dans ce partage d’affection.
Mais ce tableau presque idyllique n’a pas le temps de s’installer que déjà on le sent gagné par une insupportable angoisse, due à la disparition des deux fils aînés, Mehdi et Amine. On comprend qu’ils sont partis pour le jihad islamique, et qu’ils sont sans doute devenus des terroristes, comme dit leur petit frère Adam qui en est très chagriné. Une voisine et amie déplore elle aussi le départ inexpliqué de son fils, torturée de ne pas savoir s’il reviendra ou s’il est mort et si elle doit ou non faire son deuil. « Ces jeunes sont endoctrinés », dit quelqu’un, mais personne n’en sait plus et cette ignorance crée un effet de mystère sur lequel insiste la réalisatrice, dont on comprend qu’elle ne veut pas faire un film documentaire et purement réaliste, mais qu’elle tend au contraire vers le fantastique et vers le sentiment de peur qui va grandissant, à mesure que vont se produire d’autres disparitions.
Un personnage cependant incarne la volonté de rester raisonnable et humain, gentil avec les enfants du village auquel il veut épargner le climat délétère qui commence à régner ; c’est Bilal, tout juste sorti d’une école de police et jouant le rôle d’une sorte de grand frère pour Adam, qui en la personne d’Amine et Mehdi a perdu les deux siens. En fait l’un des deux revient, c’est Mehdi mais en très triste état, et il annonce qu’Amine est mort mais sans rien expliquer de ce qui s’est passé. On constate seulement qu’il ramène avec lui une jeune femme enceinte, Reem, muette et entièrement voilée, à l’ exception des deux yeux qui lui donnent un regard à la fois étrange et beau. Elle ne communique avec personne et la gêne s’installe autour d’elle. Mehdi la désigne comme sa femme, ils semblent en effet très attachés l’un à l’autre mais leur présence doit rester discrète, voire totalement secrète puisqu’il a été décrété au village (ailleurs aussi sans doute) que ceux qui tenteraient de revenir du djihad seraient immédiatement arrêtés et emprisonnés. Brahim est d’ailleurs furieux contre son fils Mehdi, l’insulte et voudrait le voir partir dans les plus brefs délais mais Aïcha obtient que ce soit seulement lorsque Reem aura accouché.
 Cependant la situation va évoluer autrement et l’on entre dans une dernière partie du film dont le statut est incertain, entre cauchemar et réalité ; on dirait que s’y mêlent des prémonitions ou des visions qui sont semble-t-il comme un don de voyance propre à Aïcha. Quoi qu’il en soit, au cours de cette fin, Mehdi s’entend condamner par un chef islamiste tout puissant (dont on ne sait d’où il est sorti) à subir « la dernière épreuve » : étant avéré que Reem est une mécréante et qu’elle doit mourir, c’est Mehdi qui est chargé de la tuer, bien qu’il tente d’abord de dire qu’il ne le pourra pas. Il le fera pourtant et d’autres tueurs contribuent à sa mise à mort en la rouant sauvagement de coups. On entend la voix du Maître qui dit : « Ne réfléchissez pas, frappez. » Après quoi, ayant accompli cet acte horrible, Mehdi se jette dans la mer du haut d’une falaise pendant que sa mère Aïcha gémit et pleure comme une héroïne de tragédie.
Cependant la situation va évoluer autrement et l’on entre dans une dernière partie du film dont le statut est incertain, entre cauchemar et réalité ; on dirait que s’y mêlent des prémonitions ou des visions qui sont semble-t-il comme un don de voyance propre à Aïcha. Quoi qu’il en soit, au cours de cette fin, Mehdi s’entend condamner par un chef islamiste tout puissant (dont on ne sait d’où il est sorti) à subir « la dernière épreuve » : étant avéré que Reem est une mécréante et qu’elle doit mourir, c’est Mehdi qui est chargé de la tuer, bien qu’il tente d’abord de dire qu’il ne le pourra pas. Il le fera pourtant et d’autres tueurs contribuent à sa mise à mort en la rouant sauvagement de coups. On entend la voix du Maître qui dit : « Ne réfléchissez pas, frappez. » Après quoi, ayant accompli cet acte horrible, Mehdi se jette dans la mer du haut d’une falaise pendant que sa mère Aïcha gémit et pleure comme une héroïne de tragédie.
D’ailleurs c’est un aspect que la réalisatrice a accentué chez elle dès le début du film : celui-ci est ponctué de très nombreux gros plans qui soulignent la douleur maternelle d’Aïcha et dont on peut penser qu’ils appartiennent à l’iconographie des massacres accomplis par le terrorisme—on pense par exemple à cette figure qui a frappé les esprits pendant la décennie noire en Algérie et qu’on a parfois appelé la madone de Benthala : elle dit la douleur d’une femme —sans doute une mère—avec une force inouïe évoquant pour les chrétiens celle de la Vierge à la mort de son fils, en italien « piéta », dont l’exemple le plus connu est une sculpture de Michel-Ange. Il est certain que la réalisatrice s’est particulièrement attachée aux représentations d’Aïcha donnant par elles à son film une dimension mythologique et tragique plutôt que documentaire —sans doute n’avait-elle ni les éléments ni l’envie de ce genre cinématographique.
Pour le personnage de Reem elle a choisi aussi de préserver une sorte de fascinant mystère, laissant entendre qu’il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire mais qu’elle choisit de ne pas les dire pour se concentrer sur sa mort atroce, ce qu’on peut considérer aussi comme une sorte de plaidoyer féministe, accru par le fait que Reem est une femme enceinte, ce qui est une sorte de redoublement de féminité qu’il convient d’autant plus d’éliminer du point de vue du fanatisme islamique. Même le délicieux Adam est gagné par la peur de la femme qui sévit dans le village et qui fait de Reem un bouc émissaire pour conjurer l’effroi général devant les disparitions. Mehdi est une victime collatérale de cette nécessaire élimination, de toute façon condamné par son impuissance à choisir entre amour et haine. Mehdi a abandonné son frère et tué sa femme, image terrible de l’anti-humanisme dont les islamistes font profession.
Denise Brahimi

« SAGESSE DES FEMMES DU MAGHREB» de Nora Aceval , éditions Al Manar, 2023
 Nora Aceval est bien connue comme spécialiste de la littérature orale, dont elle a apprécié l’importance à partir des contes entendus dans son enfance, sur les hauts plateaux de Tiaret en Algérie. Bien qu’elle ait quitté le pays à l’âge de 23 ans, elle a entrepris de faire des collectes de contes sur le terrain, notamment dans le Djebel Amour (Atlas saharien) et de ce travail on peut dire qu’il est devenu la passion d’une vie. Son premier ouvrage publié date de 2000, et depuis lors elle a produit plus d’une quinzaine de livres.
Nora Aceval est bien connue comme spécialiste de la littérature orale, dont elle a apprécié l’importance à partir des contes entendus dans son enfance, sur les hauts plateaux de Tiaret en Algérie. Bien qu’elle ait quitté le pays à l’âge de 23 ans, elle a entrepris de faire des collectes de contes sur le terrain, notamment dans le Djebel Amour (Atlas saharien) et de ce travail on peut dire qu’il est devenu la passion d’une vie. Son premier ouvrage publié date de 2000, et depuis lors elle a produit plus d’une quinzaine de livres.
Cependant et même s’il est parfois plus spécialement question des femmes, comme dans « La Science des femmes et de l’amour », la plupart des contes recueillis par Nora Aceval concernent aussi bien les femmes que les hommes, ce qui incite à souligner l’originalité de ceux-ci, dans la présentation très soignée qu’en donne Al Manar. Le mot « sagesse » qui figure dans le titre n’est évidemment pas anodin, et il faut pour mieux comprendre les intentions de l’auteure aller au-delà de ce que pourrait en être une acception banale, vague et un peu usée. Ici au contraire on pourrait dire que son emploi est offensif et désigne ce qui pourrait bien être la clef de ce livre, soulignant ce que nos idées reçues ont tendance à occulter. En effet lorsqu’ il s’agit du rapport entre les hommes et les femmes au Maghreb nous avons tous et surtout toutes un seule idée, à savoir que celui-ci est régi par le patriarcat, dont on ne sait que trop, hélas, ce qu’il est.
 Eh ! bien non, justement, nous ne le savons pas trop, nous ne le savons au contraire pas assez, ou plutôt nous en oublions une partie d’une manière réductrice qui ne rend pas compte des équilibres sociaux. Car s‘il est vrai que les hommes disposent de pouvoirs qui n’appartiennent qu’à eux et sont trop souvent tentés d’en user brutalement voire pire (ce qui est incontestable), il existe aussi un contre-pouvoir féminin qui est fort subtil, et dont l’optimisme des contes consiste à montrer qu’à terme, il est souvent triomphant. Sa subtilité consiste à éviter toute révolte apparente et à jouer au contraire le jeu de la soumission : la femme obéit à ce que son seigneur et maître veut lui imposer, mais elle sait que si sa volonté est déraisonnable, il risque fort d’en être la première victime. Ce qui se produit alors, si l’on en croit les contes, est une prise de conscience de l’homme qui comprend son erreur et s’efforce de la corriger. Il n’est pas interdit de penser que les femmes qui racontent de telles histoires prennent leurs désirs pour des réalités. Mais il se trouve que dans nombre de cas, ces conclusions favorables aux femmes renvoient à des sourates du Coran ! On pourrait aller jusqu’à dire que c’est une certaine pratique brutale du patriarcat qui est une déviation funeste par rapport à la religion et à la sagesse traditionnelle qui en est le véhicule, pourvu qu’on veuille bien y prêter attention.
Eh ! bien non, justement, nous ne le savons pas trop, nous ne le savons au contraire pas assez, ou plutôt nous en oublions une partie d’une manière réductrice qui ne rend pas compte des équilibres sociaux. Car s‘il est vrai que les hommes disposent de pouvoirs qui n’appartiennent qu’à eux et sont trop souvent tentés d’en user brutalement voire pire (ce qui est incontestable), il existe aussi un contre-pouvoir féminin qui est fort subtil, et dont l’optimisme des contes consiste à montrer qu’à terme, il est souvent triomphant. Sa subtilité consiste à éviter toute révolte apparente et à jouer au contraire le jeu de la soumission : la femme obéit à ce que son seigneur et maître veut lui imposer, mais elle sait que si sa volonté est déraisonnable, il risque fort d’en être la première victime. Ce qui se produit alors, si l’on en croit les contes, est une prise de conscience de l’homme qui comprend son erreur et s’efforce de la corriger. Il n’est pas interdit de penser que les femmes qui racontent de telles histoires prennent leurs désirs pour des réalités. Mais il se trouve que dans nombre de cas, ces conclusions favorables aux femmes renvoient à des sourates du Coran ! On pourrait aller jusqu’à dire que c’est une certaine pratique brutale du patriarcat qui est une déviation funeste par rapport à la religion et à la sagesse traditionnelle qui en est le véhicule, pourvu qu’on veuille bien y prêter attention.
Denise Brahimi
« TIN HINAN, LA REINE DU SUD» par Kader Gaid, éditions Dalimen, 2024
 Dans la catégorie femmes maghrébines, il est certain que Tin Hinan a une part portante de célébrité, à quoi il faut ajouter aussitôt que pour autant, elle est fort mal connue. En littérature, elle doit une place prestigieuse à la romancière Assia Djebar (morte en 2015) qui l’inclut dans une réflexion très personnelle. Ce n’est pas le cas du travail accompli par Kader Gaid qui entend écrire sur la reine berbère un roman historique où il supplée de son mieux à l’absence de documentation. Et pour ce faire, il s’appuie sur tout ce qu’on sait par ailleurs du mode de vie de Touaregs du Hoggar qui la revendiquent pour leur reine,—alors même qu’elle venait du nord—ayant vécu semble-t-il au 4e et au 5e siècle de l’ère chrétienne.
Dans la catégorie femmes maghrébines, il est certain que Tin Hinan a une part portante de célébrité, à quoi il faut ajouter aussitôt que pour autant, elle est fort mal connue. En littérature, elle doit une place prestigieuse à la romancière Assia Djebar (morte en 2015) qui l’inclut dans une réflexion très personnelle. Ce n’est pas le cas du travail accompli par Kader Gaid qui entend écrire sur la reine berbère un roman historique où il supplée de son mieux à l’absence de documentation. Et pour ce faire, il s’appuie sur tout ce qu’on sait par ailleurs du mode de vie de Touaregs du Hoggar qui la revendiquent pour leur reine,—alors même qu’elle venait du nord—ayant vécu semble-t-il au 4e et au 5e siècle de l’ère chrétienne.
Aucun des problèmes qui se posent autour de Tin Hinan n’est clairement c’est-à-dire scientifiquement résolu et il ne semble pas que Kader Gaïd ait voulu apporter des arguments dans un ou des débats concernant son héroïne. Il s’en remet plutôt aux éléments légendaires qui sont le plus fréquemment attestés tels que l’extrême beauté de la reine dans toute une première partie ou la boiterie qui en revanche apparaît chez elle  avec l’âge. Il magnifie volontiers tout ce que les Kel Ahaggar considèrent comme des acquis considérables dont ils sont redevables à leur reine. Celle-ci aurait apporté avec elle un grand nombre de savoirs très précieux. Elle avait une connaissance approfondie de l’astronomie, ce qui d’ailleurs lui aurait permis de se diriger depuis le nord vers le lieu où elle s’est fixée, à Abalessa proche de Tamanrasset qui serait aussi le lieu de son tombeau. Pour tout ce qui concerne l’organisation sociale des groupes humains qu’elle a pris en charge, elle semble avoir été d’une particulière efficacité, expliquant que beaucoup ont voulu se ranger sous ses lois.
avec l’âge. Il magnifie volontiers tout ce que les Kel Ahaggar considèrent comme des acquis considérables dont ils sont redevables à leur reine. Celle-ci aurait apporté avec elle un grand nombre de savoirs très précieux. Elle avait une connaissance approfondie de l’astronomie, ce qui d’ailleurs lui aurait permis de se diriger depuis le nord vers le lieu où elle s’est fixée, à Abalessa proche de Tamanrasset qui serait aussi le lieu de son tombeau. Pour tout ce qui concerne l’organisation sociale des groupes humains qu’elle a pris en charge, elle semble avoir été d’une particulière efficacité, expliquant que beaucoup ont voulu se ranger sous ses lois.
Pour la vie de son héroïne, Kader Gaid s’en tient aux dates qui sont communément admises avec toute leur incertitude mais il ne prend pas en compte les tentatives postérieures pour la situer dans le temps à une date plus récente, permettant d’en faire un Musulmane. Il se range plutôt quoique avec une certaine discrétion, du côté de ceux qui voient en elle des formes d’un régime matrilinéaire, par ailleurs bien attesté chez les Touaregs, et très différent du patriarcat répandu dans tout le Maghreb arabe, comme l’atteste un ensemble bien répertorié de preuves évidentes. Mais l’auteur se décharge de tout travail anthropologique, sociologique et historique sur les textes fondamentaux en ces matières qu’il cite dans sa bibliographie. C’est à elle qu’il invite les lecteurs à se reporter après les avoir séduits par les mystères de la légendaire « reine du sud ».
Denise Brahimi
«ROBBA LA BERBERE DONATISTE» par Driss Reffas, roman, préface de Yasmina Khadra, Casbah éditions, 2023
Au seul mot de « donatisme » on ne peut que dresser l’oreille tant il est vrai qu’il fait partie de ce (et de ceux) que l’histoire a finalement écrasé(s) ; mais ce n’est évidemment pas une raison, bien au contraire, pour sous-estimer l’importance du passé auquel il renvoie, et qui fait partie de l’immense épopée du peuple algérien. Robba est une combattante et son histoire mérite bien d’être contée.
 On ne peut se dispenser de rappeler en quelques mots ce qu’a été le donatisme, nom qui dérive de celui de l’évêque Donat ou plus exactement Donat de Baghaï des Nemmenchas dans l’Aurès, au sud-est de l’Algérie ; et tous les événements qui sont liés à cet évêque ainsi qu’à ses disciples (appelés donatistes) se passent à la fin du 4e siècle et au début du 5e siècle de l’ère chrétienne. On est assez bien renseigné pour ce qui concerne Robba elle-même , née en 384 et morte en 434, ce qu’on peut tout à fait rapprocher des dates concernant la vie d’un personnage beaucoup plus connu, sous le nom de Saint-Augustin, né en 354 et mort en 430. L’évocation de ce dernier, non sans rapport avec le donatisme (mais rapport négatif de rejet) montre toute l’importance prise à cette époque par l’histoire religieuse du christianisme dans l’Algérie antique. Mais en fait, cette histoire n’est pas seulement religieuse, elle est aussi politique et plus vaste encore, puisqu’il s’agit d’un affrontement qu’on peut dire sans anachronisme anticolonial, entre la puissance colonisatrice qu’était alors la Rome impériale et certaines tribus berbères qui refusaient de se laisser romaniser. On peut donc dire de Robba qu’elle est une héroïne berbère qui incarne la résistance opposée localement à l’Eglise romaine ; à l’inverse du mouvement dont elle fait partie et qui se rattache à l’évêque Donat, d’autres Berbères se sont convertis au catholicisme romain et ont été appelés les traditeurs. Les Donatistes ont représenté à cette époque une forme de résistance à la romanisation, ce qui les rend proches d’un autre groupe d’opposants plus extrémistes et plus violents, les Circoncellions : ceux-ci sont des paysans révoltés par la misère, anticatholiques et antiromains ; on peut sans doute les considérer comme une variété radicale de donatistes.
On ne peut se dispenser de rappeler en quelques mots ce qu’a été le donatisme, nom qui dérive de celui de l’évêque Donat ou plus exactement Donat de Baghaï des Nemmenchas dans l’Aurès, au sud-est de l’Algérie ; et tous les événements qui sont liés à cet évêque ainsi qu’à ses disciples (appelés donatistes) se passent à la fin du 4e siècle et au début du 5e siècle de l’ère chrétienne. On est assez bien renseigné pour ce qui concerne Robba elle-même , née en 384 et morte en 434, ce qu’on peut tout à fait rapprocher des dates concernant la vie d’un personnage beaucoup plus connu, sous le nom de Saint-Augustin, né en 354 et mort en 430. L’évocation de ce dernier, non sans rapport avec le donatisme (mais rapport négatif de rejet) montre toute l’importance prise à cette époque par l’histoire religieuse du christianisme dans l’Algérie antique. Mais en fait, cette histoire n’est pas seulement religieuse, elle est aussi politique et plus vaste encore, puisqu’il s’agit d’un affrontement qu’on peut dire sans anachronisme anticolonial, entre la puissance colonisatrice qu’était alors la Rome impériale et certaines tribus berbères qui refusaient de se laisser romaniser. On peut donc dire de Robba qu’elle est une héroïne berbère qui incarne la résistance opposée localement à l’Eglise romaine ; à l’inverse du mouvement dont elle fait partie et qui se rattache à l’évêque Donat, d’autres Berbères se sont convertis au catholicisme romain et ont été appelés les traditeurs. Les Donatistes ont représenté à cette époque une forme de résistance à la romanisation, ce qui les rend proches d’un autre groupe d’opposants plus extrémistes et plus violents, les Circoncellions : ceux-ci sont des paysans révoltés par la misère, anticatholiques et antiromains ; on peut sans doute les considérer comme une variété radicale de donatistes.
Ces éléments historiques sont très présents dans ce que Driss Reffas considère comme un roman. Il suit chronologiquement les événements qui ont marqué les 50 ans de vie de son héroïne Robba. Elle est la petite sœur d’Honoratus, de 15 ans son aîné, connu lui-même pour avoir été un évêque donatiste qui a participé aux grands débats de cette époque. Au moment de sa naissance un autre personnage, oncle de Robba, prononce ces paroles dont le sens est tout à fait clair : « Nous sommes un peuple libre qui refuse d’être spolié de ses terres(…) Beaucoup de gens de notre peuple se sont ralliés à l’Eglise de l’empereur pour spolier nos terres, faire travailler leurs frères pour enrichir les Romains. »
 Au moment où il parle, Donat est mort (en 355) mais ses adeptes sont toujours autant décidés à se battre et à promouvoir le culte chrétien comme ils le conçoivent. Honoratus quitte la maison familiale pour aller faire des études et améliorer son latin. Dans les lieux qu’il traverse, il y a souvent des rixes entre colons berbéro-romains et autochtones berbères. On parle beaucoup aussi d’un certain Augustin évêque d’Hippone qui lui a pris parti contre les donatistes, ceux-ci le méprisent pour s’être soumis à l’Eglise de l’Empereur (sa mère, Monique est traitée de « bourgeoise provinciale ») et s’efforcent d’attirer les gens dans leurs basiliques ; Honoratus s’emploie à cette tâche.
Au moment où il parle, Donat est mort (en 355) mais ses adeptes sont toujours autant décidés à se battre et à promouvoir le culte chrétien comme ils le conçoivent. Honoratus quitte la maison familiale pour aller faire des études et améliorer son latin. Dans les lieux qu’il traverse, il y a souvent des rixes entre colons berbéro-romains et autochtones berbères. On parle beaucoup aussi d’un certain Augustin évêque d’Hippone qui lui a pris parti contre les donatistes, ceux-ci le méprisent pour s’être soumis à l’Eglise de l’Empereur (sa mère, Monique est traitée de « bourgeoise provinciale ») et s’efforcent d’attirer les gens dans leurs basiliques ; Honoratus s’emploie à cette tâche.
Pendant ce temps la petite Robba a grandi, nous sommes maintenant en 401, elle a 17 ans. En 405, le donatisme est déclaré hors-la-loi par un concile d’évêques catholiques réunis à Carthage et les donatistes, craignent non sans raison, d’être persécutés : il y a des exemples de martyres. Honoratus est devenu évêque à l’âge de 31 ans, et sa jeune sœur Robba est à ses côtés. Elle dénonce en la personne d’Augustin « une fabrication de l’Empire romain ». L’Eglise catholique recule et l’Empereur fait proclamer en 410 la liberté de tous le cultes. Mais ce n’est qu’une manœuvre et Robba entre dans la clandestinité pour mieux soutenir la résistance des paysans. L’église donatiste se définit comme celle des pauvres et des opprimés. En 411, un grand concile se réunit à Carthage, il y est décrété officiellement que les donatistes ne sont pas seulement schismatiques mais hérétiques, ce qui est beaucoup plus grave et les expose à d’implacables châtiments.
Robba dans ses prises de parole rappelle le souvenir de l’évêque Donat qui en son temps avait lutté contre l’intervention de l’Empereur dans les affaires de l’Eglise. Mais des événements extérieurs interviennent dans l’histoire du donatisme, c’est le moment des invasions vandales en Afrique du Nord, elles commencent en 429, les donatistes n’y sont pas directement impliqués mais en profitent pour essayer de récupérer leurs terres passées aux mains des colons traditeurs, c’est la guerre ouverte entre ces derniers et l’alliance entre circoncellions et donatistes. Et Robba y trouve la mort en 434. L’auteur (lui-même musulman) l’intègre avec honneur dans l’histoire de l’Algérie chrétienne.
Denise Brahimi
«Chemin de vie, colonisation, libération nationale et luttes plurielles pour la démocratie, Mémoires» , par Madjid Benchikh, Koukou éditions, Alger, 2023
L’auteur est un grand juriste algérien qui a écrit de nombreux ouvrages et articles. Né en 1937, il a pu vivre en tant qu’adulte toute l’histoire de la guerre d’indépendance et il a continué le combat après la libération du pays, jusqu’au récent Hirak inclusivement !
Originaire d’un village kabyle, il raconte son histoire depuis sa naissance « au pied du Djurdjura », son enfance à l’école coloniale à partir de 1945 et son adolescence au lycée de Boufarik à partir de 1950 dans la Mitidja.
 En mai 1956, le FLN appelle tous les étudiants à faire la grève des cours et des examens. Le jeune Madjid n’est encore que lycéen mais il adhère aussitôt et avec enthousiasme à ce mot d’ordre. Son père est déjà membre du FLN, lui-même participe de son mieux à la lutte : actes de sabotage, fabrication de bombes. Sa commune est administrée par un gouverneur politique en liaison avec le FLN, en sorte que le politique l’emporte sur le militaire, une hiérarchie qu’il défendra sa vie durant. La grève étant levée, il reprend ses études fin 1957 au lycée de Maison-Carrée et il est reçu au bac mais il lui faut trouver du travail pour gagner sa vie, c’est ainsi qu’il part à Constantine en septembre 1959 pour y être maître d’internat. Puis les circonstances l’amènent en quelques autre lieux.
En mai 1956, le FLN appelle tous les étudiants à faire la grève des cours et des examens. Le jeune Madjid n’est encore que lycéen mais il adhère aussitôt et avec enthousiasme à ce mot d’ordre. Son père est déjà membre du FLN, lui-même participe de son mieux à la lutte : actes de sabotage, fabrication de bombes. Sa commune est administrée par un gouverneur politique en liaison avec le FLN, en sorte que le politique l’emporte sur le militaire, une hiérarchie qu’il défendra sa vie durant. La grève étant levée, il reprend ses études fin 1957 au lycée de Maison-Carrée et il est reçu au bac mais il lui faut trouver du travail pour gagner sa vie, c’est ainsi qu’il part à Constantine en septembre 1959 pour y être maître d’internat. Puis les circonstances l’amènent en quelques autre lieux.
Durant tout ce retour sur son cheminement, son but principal est d’être aussi précis que possible dans la reconstitution de ses souvenirs ; mais comme il écrit à distance longtemps après les événements, il les ponctue de réflexions soutenues par des références poétiques, principalement à la poésie française du 19e siècle, ce dont il faut sans doute remercier la bonne éducation scolaire dont il a bénéficié. C’est pourquoi son récit n’est pas austère malgré la dureté de l’histoire en cours. En effet pendant ce temps-là, l’importance de l’OAS a grandi, mais en même temps, la lutte pour l’indépendance s’anime d’un souffle nouveau et du sentiment qu’à terme, c’est sa cause qui a gagné.
Il se trouve que l’occasion se présente pour lui de partir en France à l’Université de Grenoble, ce qu’il fait en novembre 1961. Il est chargé d’un travail de contact et d’organisation par le FLN mais il n’en approuve pas les méthodes inutilement autoritaires. En Algérie l’indépendance ouvre l’époque des divisions entre les aspirants au pouvoir. A Grenoble Madjid est élu président des étudiants algériens mais son esprit critique se développe à l’égard des membres du FLN et de leur méthode autoritaire, et il fait le choix d’une politique, si difficile soit-elle, fondée sur la pratique de la démocratie. Politiquement il se sent proche de Hocine Aït Ahmed, mais opposé à toute guerre civile. En novembre 1964 il décide avec d’autres étudiants de rentrer en Algérie. En juin 1965 c’est le coup d’Etat du colonel Boumediene qui installe l’autorité militaire au centre du pouvoir et rend très difficile toute mobilisation populaire. Madjid et ses amis manifestent contre le coup d’état mais ils ne sont pas nombreux.
Les Mémoires abordent ensuite le chapitre des nationalisations, en un mot : le pétrole. L’auteur devenu conseiller juridique est amené de ce fait à suivre au plus près la gestion de cette question majeure par Belaïd Abdesselam, Ministre de l’Industrie et de l’Energie. On pourrait presque s’en tenir au sous-titre choisi par Madjd Benchikh : « Un ministre autoritaire » et l’on sait déjà que cet adjectif désigne pour lui un défaut rédhibitoire, d’autant que les choses peuvent aller dans ce cas jusqu’à « une conception quasi féodale du pouvoir ».
 L’auteur fait un récit chronologique de l’enchaînement des événements à partir de la guerre d’indépendance et avant même que celle-ci ne soit proclamée en 1962. Mais il est évident que son récit n’est pas neutre, l’esprit général en est une opposition aux maîtres du pouvoir, au nom des exigences démocratiques qu’ils ont négligées voire bafouées.
L’auteur fait un récit chronologique de l’enchaînement des événements à partir de la guerre d’indépendance et avant même que celle-ci ne soit proclamée en 1962. Mais il est évident que son récit n’est pas neutre, l’esprit général en est une opposition aux maîtres du pouvoir, au nom des exigences démocratiques qu’ils ont négligées voire bafouées.
Ayant démissionné, il retourne à l’université en 1968 pour devenir professeur de droit. Il est aidé en cela par la connaissance qu’il a acquise sur le terrain. En 1973, il est élu doyen de la faculté de droit et reste à ce poste jusqu’en 1976. Cependant, c’est à partir de 1988, même si son engagement politique a commencé bien avant, qu’il va mener pleinement le combat pour la démocratie et les droits humains. Dans cette démarche il participe à la création d’une section algérienne d’Amnesty International et en devient le Président. Au moment des manifestations d’octobre 1988, il est de ceux qui ont compris que la formule du parti unique était désormais dépassée et de fait en février 1989, le multipartisme est reconnu. A partir de 1990, il fréquente Hocine Aït Ahmed et il est le candidat de son parti le FFS aux élections législatives de 1991. Il pense qu’il n’aurait pas fallu interrompre le processus électoral, son mot d’ordre est : ni Etat policier, ni république intégriste. En 1996 il s’installe à Paris mais revient souvent en Algérie.
Le dernier chapitre du livre porte un titre tout à fait clair et on peut y voir une sorte d’aboutissement de toute la carrière de l’auteur, même si le mouvement dont il parle est resté à ce jour… inabouti : « Mon soutien au soulèvement populaire de février 2019 ». Voie pacifique, fin du système autoritaire : rien ne pouvait mieux convenir à ses convictions que le Hirak !
Denise Brahimi
« LE CINEMA ALGÉRIEN EN 44 LEÇONS » par Ahmed Bedjaoui, éditions Meziani Mohamed-Walid, 2023
 Quiconque s’intéresse au cinéma algérien sait bien que le grand maître en la matière est Ahmed Bedjaoui, auteur de plusieurs livres essentiels mais aussi acteur lui-même et au plus haut niveau de l’histoire de ce cinéma depuis l’indépendance. Cela fait 65 ans qu’il participe à sa gestion et s’il se peut à son orientation non sans les obstacles inhérents à une activité culturelle que le pouvoir politique n’a pas tort de considérer comme primordiale dans la formation de l’opinion. Cependant travailler à la constitution du cinéma algérien et à l’élaboration de son histoire n’est pas simple dans un pays soumis à la fois à des variations idéologiques nombreuses et dans les faits à un immobilisme des plus pesants. Le pouvoir y est susceptible d’interventions directes voire brutales sur le contenu des films et en même temps il se montre indifférent voire aveugle face aux nécessités financières de leur production et de leur distribution.
Quiconque s’intéresse au cinéma algérien sait bien que le grand maître en la matière est Ahmed Bedjaoui, auteur de plusieurs livres essentiels mais aussi acteur lui-même et au plus haut niveau de l’histoire de ce cinéma depuis l’indépendance. Cela fait 65 ans qu’il participe à sa gestion et s’il se peut à son orientation non sans les obstacles inhérents à une activité culturelle que le pouvoir politique n’a pas tort de considérer comme primordiale dans la formation de l’opinion. Cependant travailler à la constitution du cinéma algérien et à l’élaboration de son histoire n’est pas simple dans un pays soumis à la fois à des variations idéologiques nombreuses et dans les faits à un immobilisme des plus pesants. Le pouvoir y est susceptible d’interventions directes voire brutales sur le contenu des films et en même temps il se montre indifférent voire aveugle face aux nécessités financières de leur production et de leur distribution.
Ahmed Bedjaoui est mieux placé que quiconque pour donner son avis là-dessus et il le fait courageusement. Ce n’est pourtant qu’un des buts ou des aspects de ce livre, le principal étant d’apporter des renseignements irremplaçables sur les conditions dans lesquelles un certain nombre des films algériens ont été possibles. L’auteur peut d’autant mieux en parler qu’il y était en personne et que parfois même souvent les décisions ont été prises par lui. On le sent conscient d’une sorte de devoir qui lui incombe de ne pas laisser des faits connus de lui tomber dans l’oubli ; et le lecteur ne peut qu’être reconnaissant de recevoir ce savoir en héritage.
 44 films donc, depuis l’origine du cinéma algérien qui commence avec la guerre d’ indépendance et continue de plus belle aujourd’hui en dépit de tout obstacle. Difficile de parler d’un « âge d’or » de ce cinéma, que beaucoup pourtant situent dans la première décennie d’après 1962 alors qu’il y avait tant à dire et un si grand désir d’expression. Mais il ressort de ces « 44 leçons » qu’il n’y a pas de temps mort dans cette production—et la terrible décennie noire y a été bien des fois évoquée malgré l’angoisse inhérente à un tel sujet. Il y a notamment beaucoup de films de femmes sur cette question tant il est vrai qu’elles ont été certes non pas les seules mais les principales victimes. Comment peut-on après cela dire que la guerre civile (1990-2000) reste un sujet que l’Algérie n’a pas évoqué !
44 films donc, depuis l’origine du cinéma algérien qui commence avec la guerre d’ indépendance et continue de plus belle aujourd’hui en dépit de tout obstacle. Difficile de parler d’un « âge d’or » de ce cinéma, que beaucoup pourtant situent dans la première décennie d’après 1962 alors qu’il y avait tant à dire et un si grand désir d’expression. Mais il ressort de ces « 44 leçons » qu’il n’y a pas de temps mort dans cette production—et la terrible décennie noire y a été bien des fois évoquée malgré l’angoisse inhérente à un tel sujet. Il y a notamment beaucoup de films de femmes sur cette question tant il est vrai qu’elles ont été certes non pas les seules mais les principales victimes. Comment peut-on après cela dire que la guerre civile (1990-2000) reste un sujet que l’Algérie n’a pas évoqué !
La position particulière d’Ahmed Bedjaoui à l’égard du cinéma algérien explique la façon dont il procède à l’égard des 44 films étudiés. Il ne peut évidemment consacrer que quelques pages ou même moins à chacun d’eux et en appelle d’ailleurs à un travail collectif du type dictionnaire qui seul pourrait tenter d’être complet. Choisissant donc parmi les éléments dont il dispose, il traite d’abord du « contexte » de chaque film, c’est le mot qu’il emploie pour le resituer au moment de sa conception et pour informer sur sa production et sa distribution (parfois difficile ou inexistante).
Vient ensuite la partie qu’il appelle « le film » et qui consiste à évoquer à la fois sa thématique et la manière dont le réalisateur l’a traitée. Pour simplifier à l’extrême ce qui ressort de ces 44 études (plus quelques suppléments en guise d’ouverture sur les « nouvelles tendances dans le jeune cinéma ») on pourrait distinguer en suivant la chronologie comme le fait l’auteur entre ce qui relève d’un cinéma ancien ou classique (déjà !) et ce qu’il en est d’un cinéma nouveau—bien qu’il y ait sans doute plus de continuité que de rupture dans ce développement. On peut sans doute situer le passage de l’un à l’autre assez souplement vers la fin du siècle dernier et le début du suivant, entre « La Citadelle » de Mohamed Chouikh (1989) et « La Maison jaune » de Amor Hakkar (2007).
Ahmed Bedjaoui rappelle à l’occasion que l’on y trouve un certain nombre de « films cultes » dont certains sont parvenus à un nombre d’entrées sidérant. C’est le cas de « L’opium et le bâton » d’Ahmed Rachedi (1971) d’après le roman de Mouloud Mammeri, le plus gros succès commercial en Algérie avec plus d’un million et demi d’entrées. L’auteur n’en soutient que davantage des films qu’il juge admirables alors qu’ils n’ont connu aucun succès à leur sortie en Algérie (tel est le cas des films d’Assia Djebar, connue comme très grande romancière mais qui était aussi cinéaste). Même s’il revient sur quelques-uns des très grands films parmi les plus connus, tels que « Chronique des années de braise » de Mohammed Lakhdar-Hamina (1975) ou « Omar Gatlato » de Merzak Allouache (1976), il fait aussi découvrir ou presque des œuvres qui le sont beaucoup moins, tels que « Les Déracinés » (= Les Beni Hendel) de Lamine Merbah (1977) ou « Les enfants de novembre » de Moussa Haddad (1985) ; et c’est de sa part un travail d’autant plus utile qu’on ne peut s’en remettre à une distribution erratique ou lacunaire.
Tout critique est pris entre un devoir d’impartialité, qu’on pourrait dire simplement d’honnêteté et le désir légitime d’exprimer un choix à la fois personnel et fondé. Pour Ahmed Bedjaoui, ce choix serait sans doute en faveur de « Nahla » de Farid Beloufa (1979) dont il dit, ce qui n’est pas rien : « Beaucoup, comme moi, considèrent ce film comme le plus achevé et le plus brillant de toute l’histoire de la cinématographie algérienne ». Entre 44 exemples, le lecteur à l’occasion de faire son propre choix.
Denise Brahimi
« LA PETITE JUPE VERTE » de Fatima Besnaci-Lancou Editions Espaces et Signes septembre 2024
Le titre de ce joli petit livre revient comme une antienne dans tous les récits de vie qu’il nous offre. C’est le vêtement cousu par Choura, la maman de Nedjma, alter ego de l’auteure, pour ses filles pour fêter l’indépendance de l’Algérie, le 5 juillet 1962. De nombreux enfants algériens ont ainsi porté ce jour-là les couleurs de ce pays enfin réapproprié. Ce qui , pour ces enfants de harkis, aurait pu sembler étonnant, mais c’est méconnaître l’appartenance profonde à leur pays que ressentent ces familles que les circonstances ont contraintes à se ranger sous la protection de l’armée française. C’est la  complexité de cette histoire que Fatima Besnaci-Lancou ne se lasse pas de dévoiler et de raconter. Nous l’avons commenté dans des Lettre passées, notamment au travers de son récent livre de photographies « Réfugiés et détenus de la guerre d’Algérie », et « Ils ont dit non à l’abandon des harkis », coécrit avec Houria Delorme Bentayeb.
complexité de cette histoire que Fatima Besnaci-Lancou ne se lasse pas de dévoiler et de raconter. Nous l’avons commenté dans des Lettre passées, notamment au travers de son récent livre de photographies « Réfugiés et détenus de la guerre d’Algérie », et « Ils ont dit non à l’abandon des harkis », coécrit avec Houria Delorme Bentayeb.
Cet ouvrage est splendidement illustré des tableaux de Serge Vollin, alias Cherif Ben Amor, peintre d’art brut reconnu tant en France qu’en Allemagne et aux Etats Unis. Lui même est attaché au destin des harkis, ayant, enfant, assisté de près au meurtre de son beau-père, harki. Il a fait don de nombreux tableaux au mémorial de Rivesaltes.
Dans ce livre, Fatima-Nedjma fait exprimer à chaque membre de sa famille, grand-mère, mère, père, tante et oncle, sœurs, les souvenirs qu’ils gardent de cette petite fille habillée aux couleurs algériennes. Ce récit polyphonique permet aux lecteurs de découvrir sensiblement la trajectoire tragique d’une famille arrachée à son terroir de Sidi-Ghilès-ex Novi, proche de Cherchell, un lieu important pour l’auteur de ces lignes, dont des ancêtres d’Arras sont venus en 1848 créer ce village de colonisation.
Les conditions du départ, puis de l’arrivée en France, sont épouvantables, comme pour de nombreuses familles de ces supplétifs de l’armée française. Le grand-père, Deda est contraint pendant l’été 62 par les nouveaux dirigeants, à des travaux forcés pour expier la fuite de ses deux fils, harkis, partis s’abriter dans des casernes de l’armée française. Puis il disparaît, probablement massacré, et son corps ne sera pas retrouvé, ce dont Mohand, le père de Nedjma ne se remettra jamais.
 Malgré l’entraide entre les familles, la suite, en France sera terrible pour tous, et particulièrement pour la famille de Mohand et Choura qui ne pourront bénéficier longtemps de l’accueil enfin chaleureux du village de Vic le Comte, près d’Issoire, où Nabil et Kheira, oncle et tante de Nedjma s’implantent avec un certain plaisir, rejoints par la grand-mère, Hena.
Malgré l’entraide entre les familles, la suite, en France sera terrible pour tous, et particulièrement pour la famille de Mohand et Choura qui ne pourront bénéficier longtemps de l’accueil enfin chaleureux du village de Vic le Comte, près d’Issoire, où Nabil et Kheira, oncle et tante de Nedjma s’implantent avec un certain plaisir, rejoints par la grand-mère, Hena.
Mohand, tuberculeux, ce qui lui interdit de trouver un travail, Choura et leurs filles vont vivre un long et douloureux parcours de camps en camps, Bourg Lastic, Saint-Hilaire, Mouans Sartoux, 15 ans de relégation. Nedjma souffre d’anorexie, se que relate sa sœur, Mina, et mettra une longue période à recouvrer la santé.
Le mode choisi pour ce récit familial est très vivant, donne à chaque personnage un caractère propre et sa vision personnelle des étapes que traverse la famille. Outre la petite jupe verte qui revient au détour de chaque récit, un objet central organise le récit : le photo de la famille prise le 5 juillet 1962 par l’oncle Halim à Sidi Ghilès, dont Nedjma, qui en est la dépositaire, fait s’exprimer dans ce livre chacun des personnages y figurant. Cette scène est également peinte par Serge Vollin et illustre la couverture-verte- du livre.
Un beau livre que nous aimerions contribuer à faire découvrir.
Michel Wilson
« BANALE FLAMBÉE DANS MA CITÉ » de Mabrouck Rachedi (Editions Actes Sud jeunesse 2024)
 Nous apprécions beaucoup les livres de Mabrouck Rachedi, qui écrit aussi bien pour les adultes que pour la jeunesse. Nous avons du reste commenté par le passé deux livres classés en littérature jeunesse « Krimo, mon frère » et « Toutes les couleurs de mon drapeau ». Littérature jeunesse, parce que le héros évoqué dans chaque livre est un jeune adolescent, qui « trimballe » la complexité des relations aux adultes, mais à qui il arrive des aventures que peu d’adultes connaissent. Le tout est écrit dans une langue précise, aux phrases courtes, une langue contemporaine, mais qui ne cède pas aux facilités du parler « djeuns ».
Nous apprécions beaucoup les livres de Mabrouck Rachedi, qui écrit aussi bien pour les adultes que pour la jeunesse. Nous avons du reste commenté par le passé deux livres classés en littérature jeunesse « Krimo, mon frère » et « Toutes les couleurs de mon drapeau ». Littérature jeunesse, parce que le héros évoqué dans chaque livre est un jeune adolescent, qui « trimballe » la complexité des relations aux adultes, mais à qui il arrive des aventures que peu d’adultes connaissent. Le tout est écrit dans une langue précise, aux phrases courtes, une langue contemporaine, mais qui ne cède pas aux facilités du parler « djeuns ».
Ce dernier ouvrage a été écrit à l’occasion d’une résidence d’écriture réalisée par le Département de la Seine-Saint-Denis. Ce bain prolongé dans la vie du « neuf-trois » a probablement contribué à donner au roman une touche naturaliste, qui sent le « vécu ». Cela dit l’auteur avait su tout autant nous faire vivre au Japon dans son précédent livre, Krimo, mon frère, ce qui confirme un talent narratif qui « embarque » le lecteur, jeune ou moins jeune…
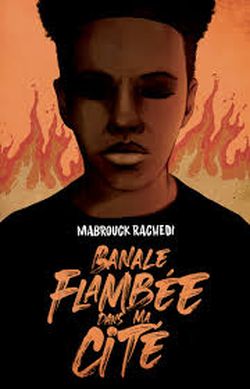 Le héros est un adolescent, Mabataï, orphelin de mère. Ses parents, originaires d’un pays d’Afrique subsaharienne étaient tous les deux professeurs. Son prénom lui a été donné par sa mère, après un accouchement difficile, et en référence à la chanson de Balavoine « Mon fils, ma bataille », le vers suivant « fallait pas qu’elle s’en aille » illustre la douleur de la perte de cette mère qui a bataillé contre la maladie. Mabataï est rêveur, taiseux, amateur de Camus chez qui il s’identifie à Meursault (Aujourd’hui maman est morte…). C’est aussi un coureur à pied remarquable, ainsi qu’un auteur de textes de chansons qui pourraient l’amener à un beau succès.
Le héros est un adolescent, Mabataï, orphelin de mère. Ses parents, originaires d’un pays d’Afrique subsaharienne étaient tous les deux professeurs. Son prénom lui a été donné par sa mère, après un accouchement difficile, et en référence à la chanson de Balavoine « Mon fils, ma bataille », le vers suivant « fallait pas qu’elle s’en aille » illustre la douleur de la perte de cette mère qui a bataillé contre la maladie. Mabataï est rêveur, taiseux, amateur de Camus chez qui il s’identifie à Meursault (Aujourd’hui maman est morte…). C’est aussi un coureur à pied remarquable, ainsi qu’un auteur de textes de chansons qui pourraient l’amener à un beau succès.
Le roman aborde la mort, la violence, la politique, la drogue, mais aussi l’amitié, l’amour, et la poésie et la littérature jalonnent aussi le récit.
L’auteur évite ainsi la facilité d’un récit de « banlieue », ces « infra mondes » que nous donnent si souvent à voir les médias. Les situations sont complexes, les personnages également, la place donnée à la chanson fait un contrepoint bienvenu aux situations de deal et de violence dans les sous-sols d’immeubles. Une intrigue plutôt élaborée permettrait à ce livre de nourrir un scénario de film dans l’inspiration de ceux qui font un succès actuellement sur les écrans français…
Le lectorat-cible paraît devoir être intéressé par ce contenu riche et bien ancré dans le vécu d’une partie des jeunes urbains. Par exemple la relation police-jeunes, finement argumentée.
Mais les lecteurs plus âgés, voir « boomers » peuvent y trouver également matière à s’informer, et même à réfléchir !
Un livre à offrir à vos ado… mais pas que !
Michel Wilson.
Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.
 – Utiles
– Utiles
de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun
Cliquez ici pour voir le film et le mot de passe utilesjoussour

–Entre nos mains
de Leila Saadna
Cliquez ici pour voir le film, puis mot de passe utilesjoussour
Et sa bande-annonce, cliquez ici

- Jeudi 2 janvier Everybody loves Touda de Nabil Ayouch au cinéma Toboggan de Décines
- Jeudi 9 janvier 19h15 Pièce Ruptures de Yamna Sahli au Théâtre de l’Astrée Campus de La Doua Villeurbanne
- Lundi 13 janvier Film Barbès Little Algérie au Ciné Duchère Lyon 9ème
- Mercredi 15 janvier Film Le bleu du caftan à L’Aquarium Lyon 4ème
- jeudi 16 janvier, Film La Source au cinéma Gérard Philipe de Vénissieux
- Vendredi 17 janvier Rencontre avec Kaouter Archi à la Librairie Terre des Livres Lyon 7ème
- Vendredi 17 janvier à 19h30 représentation de la pièce « Gisèle Halimi l’avocate insoumise » de et par Nadia Larbiouene, compagnie Novecento à la Maison de passages à Lyon
- Mercredi 18 décembre Everybody loves Touda Cinéma Toboggan de Décines
- Lundi 20 janvier Intervention mémoires croisées de la guerre d’Algérie au Lycée Notre Dame des Minimes Lyon 5ème
- Mardi 21 janvier Intervention mémoires croisées de la guerre d’Algérie au Lycée Aragon Picasso de Givors
- Mardi 28 janvier représentation de la pièce Gisèle Halimi l’avocate insoumise de et par Nadia Larbiouene, compagnie Novecento au Lycée Aragon Picasso de Givors
N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.



