Editorial
Coup de soleil s’est illustré en ce mois de mars 2023 par un si grand nombre de manifestations qu’il est impossible d’en rendre compte dans la Lettre, alors même qu’il y aurait beaucoup à dire et à admirer. On va donc essayer dans cette Lettre du 1er avril de revenir à un rythme « normal », qui permette à tout le monde de se faire un programme personnel à sa mesure, compte tenu des intérêts divers de chacun. Trois films, trois livres, voilà ce qui s’appelle un programme équilibré. Pour les premiers nous suivons ce que l’activité cinématographique propose, ravis qu’elle soit si riche ces temps-ci. « La dernière Reine », « Houria », « Le Bleu du caftan », un programme où brillent les films de femmes, qui abordent sans réticence les plus urgents des problèmes de société aussi bien que ceux d’individus en situation dramatique —et dans tous les cas on ne peut qu’admirer la qualité des acteurs qui les soutiennent de tout leur talent (inoubliable trio du « Caftan bleu !).
D’une sélection de lectures possibles, nous en avons retenu trois : « Maison Atlas » d’Alice Kaplan, auquel pourrait être joint « Moïse de Tétouan » permettent de prolonger une récente action que Coup de soleil a consacrée aux Juifs du Maghreb à l’Hôtel de ville de Lyon .
Pour faciliter la connaissance de l’histoire algérienne qui suscite beaucoup de curiosité, on regardera sûrement avec intérêt un livre plaisant qui s’intitule : « L’Algérie en 54 objets ».
Dans le domaine artistique, on pourra s’instruire grâce à Maurice Mauviel sur les peintres qui ont accompagné la conquête de l’Algérie et dont certains sont fort célèbres. Ce qui nous a incités à signaler une conférence de Martial Pardo sur les écrivains et musiciens français découvrant eux aussi un pays et son art jusqu’alors à peu près inconnus.
Denise Brahimi
Peut-être souhaitez-vous faire un don à notre association, pour contribuer à notre fonctionnement? Et notamment au coût de réalisation de cette Lettre?
Vous en avez la possibilité en cliquant ICI. Merci d’avance!

« MAISON ATLAS » par Alice Kaplan, roman traduit de l’américain, éditions Le bruit du monde, 2022
L’auteure prévient qu’à partir de faits réels elle a organisé le roman à sa manière, ou à sa convenance, ce qui veut dire qu’elle a fait en sorte de joindre dans la fiction les deux lieux (au départ fort éloignés) et les deux centres d’intérêt de sa propre vie, qui a priori ont fort peu en commun, sinon d’appartenir au monde juif, dans ses deux variantes différentes,  l’européenne ou ashkénaze et la nord-africaine ou sépharade. Elle n’a pas de peine à imaginer dans le début de son récit le hasard par lequel ils se sont trouvés réunis, et n’importe que ce soit vérité ou fiction : deux étudiants, l’Américaine Emily et le Juif algérien Daniel se rencontrent parce qu’ils sont venus l’une et l’autre faire leurs études à Paris, et l’attraction amoureuse crée entre eux un lien d’où naîtra plus tard une petite fille, Becca, inoubliable pour chacun de ses deux parents, même si la cruauté de l’histoire fait qu’il seront avant même cette naissance et pour le reste de leur vie définitivement séparés.
l’européenne ou ashkénaze et la nord-africaine ou sépharade. Elle n’a pas de peine à imaginer dans le début de son récit le hasard par lequel ils se sont trouvés réunis, et n’importe que ce soit vérité ou fiction : deux étudiants, l’Américaine Emily et le Juif algérien Daniel se rencontrent parce qu’ils sont venus l’une et l’autre faire leurs études à Paris, et l’attraction amoureuse crée entre eux un lien d’où naîtra plus tard une petite fille, Becca, inoubliable pour chacun de ses deux parents, même si la cruauté de l’histoire fait qu’il seront avant même cette naissance et pour le reste de leur vie définitivement séparés.
Avant que le hasard ne les réunisse, Emily et Daniel ont une histoire familiale déjà longue que le livre raconte parce qu’elle fait partie globalement des tribulations vécues par les Juifs, de manière particulièrement intense au 20ème siècle et notamment par l’effet du nazisme qui a porté à une puissance de destruction extrême l’antisémitisme séculaire, plus ou moins virulent selon les époques et les lieux. Alice Kaplan ne revient pas sur les faits les plus connus, ceux auxquels elle s’intéresse, concernant la rencontre de Daniel et d’Emily, se situent à la fin de ce même 20ème siècle, en 1993, jusqu’à un dernier épisode situé dans la période actuelle, au 21ème siècle. Il est dû au rôle que va jouer désormais la jeune Becca qui arrive tout juste à l’âge adulte et décide de se prendre en main sans que le roman puisse dire ce que sera sa propre histoire dans l’avenir. C’est donc principalement sur ces deux générations que se centre « Maison Atlas », dont la partie algérienne est la plus importante. En effet, à partir de sa double origine ethnique et géographique, le roman bascule vers l’histoire d’une famille (c’est le sens du mot « maison » employé dans le titre) dont le destin se joue entièrement en Algérie, et c’est à l’histoire des Juifs algériens que « Maison Atlas » apporte une importante contribution.
 L’intérêt du roman est de revenir sur ce groupe ethnique jadis prospère voire flamboyant, à un moment où on peut penser qu’il n’en reste plus grand-chose. A travers plusieurs représentants de la famille Atlas, on la voit d’abord dans toute sa splendeur, son pouvoir et son rayonnement, avant d’assister à son amenuisement et même à sa disparition en la personne de Daniel, qui semble renoncer de lui-même à son appartenance singulière. Du moins peut-on dire « de lui-même » quand on le revoit à l’extrême fin du livre, mais il faut reconnaître que les événements extérieurs ont beaucoup fait pour qu’il en arrive là. Alice Kaplan n’insiste pas beaucoup sur l’exode massif des Juifs algériens au sein du groupe Pied Noir lorsqu’arrive l’indépendance du pays en 1962, puisque la famille Atlas fait justement partie de ceux qui décident d’y rester par l’effet d’un choix assumé de longue date et totalement revendiqué. Mais un nouvel ensemble de faits s’impose et fait dévier ce choix en 1993, au cœur de la tristement célèbre décennie noire qui oppose les intégristes musulmans et leur terrorisme meurtrier au pouvoir officiel décidé à les éliminer par tous les moyens. Pendant ces événements sanglants le père de Daniel est assassiné et lui-même court grand risque de subir le même sort, raison pour laquelle il disparaît, renonçant de ce fait à son amour pour Emily, qui n’aura plus jamais de nouvelles de lui. Cette disparition signifie la fin de la maison Atlas et de ce qu’ont voulu les hommes qui en ont été les supports pendant plusieurs générations auparavant. Et c’est là-dessus qu’insiste avec force la romancière Alice Kaplan, ce sur quoi il faut s’arrêter avec elle, allant à l’encontre de certaines idées dominantes aujourd’hui.
L’intérêt du roman est de revenir sur ce groupe ethnique jadis prospère voire flamboyant, à un moment où on peut penser qu’il n’en reste plus grand-chose. A travers plusieurs représentants de la famille Atlas, on la voit d’abord dans toute sa splendeur, son pouvoir et son rayonnement, avant d’assister à son amenuisement et même à sa disparition en la personne de Daniel, qui semble renoncer de lui-même à son appartenance singulière. Du moins peut-on dire « de lui-même » quand on le revoit à l’extrême fin du livre, mais il faut reconnaître que les événements extérieurs ont beaucoup fait pour qu’il en arrive là. Alice Kaplan n’insiste pas beaucoup sur l’exode massif des Juifs algériens au sein du groupe Pied Noir lorsqu’arrive l’indépendance du pays en 1962, puisque la famille Atlas fait justement partie de ceux qui décident d’y rester par l’effet d’un choix assumé de longue date et totalement revendiqué. Mais un nouvel ensemble de faits s’impose et fait dévier ce choix en 1993, au cœur de la tristement célèbre décennie noire qui oppose les intégristes musulmans et leur terrorisme meurtrier au pouvoir officiel décidé à les éliminer par tous les moyens. Pendant ces événements sanglants le père de Daniel est assassiné et lui-même court grand risque de subir le même sort, raison pour laquelle il disparaît, renonçant de ce fait à son amour pour Emily, qui n’aura plus jamais de nouvelles de lui. Cette disparition signifie la fin de la maison Atlas et de ce qu’ont voulu les hommes qui en ont été les supports pendant plusieurs générations auparavant. Et c’est là-dessus qu’insiste avec force la romancière Alice Kaplan, ce sur quoi il faut s’arrêter avec elle, allant à l’encontre de certaines idées dominantes aujourd’hui.
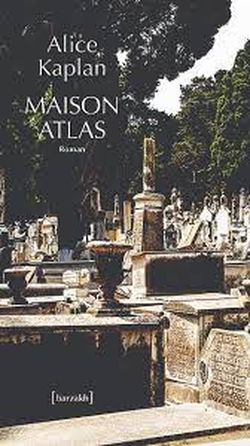 Ce que montre le roman est que la prospérité de la Maison Atlas qui longtemps n’a cessé de croître va de pair avec la parfaite intégration de cette grande famille juive dans son environnement arabe et musulman. Alice Kaplan insiste beaucoup moins que d’autres même si elle y fait allusion sur certains effets néfastes du décret Crémieux souvent évoqué comme la source d’une vive animosité entre Juifs et Musulmans, elle n’en parle jamais comme de deux communautés séparées puisqu’elle pense que celles-ci n’existent pas et n’ont jamais existé. Certes elle ne peut manquer de signaler l’existence d’un antisémitisme en Algérie mais elle y voit le fait de quelques individus particuliers qui sont parvenus ici ou là à jouer un rôle néfaste politiquement. On remarque aussi dans son livre qu’elle ne parle jamais de l’Etat d’Israël ni des Palestiniens, et si l’on cherche à voir ce qu’elle propose comme solution, sous la forme romanesque évidemment (mais est-il besoin de solution s’il n’y a pas de problème ?), on est amené à penser que le modèle à suivre pourrait être celui de Daniel qui au moment où Becca le retrouve vit avec une épouse musulmane et semble ne faire aucune référence ni pour lui-même ni pour les autres à sa judaïté. Se fondre dans cette masse qu’est le peuple algérien (ou la nation algérienne pour ceux qui préfèrent parler politiquement ); éviter de se définir par l’appartenance à une communauté séparée, telle serait la seule réponse possible aux fauteurs de haine qui trouvent leur compte à entretenir la menace d’affrontement.
Ce que montre le roman est que la prospérité de la Maison Atlas qui longtemps n’a cessé de croître va de pair avec la parfaite intégration de cette grande famille juive dans son environnement arabe et musulman. Alice Kaplan insiste beaucoup moins que d’autres même si elle y fait allusion sur certains effets néfastes du décret Crémieux souvent évoqué comme la source d’une vive animosité entre Juifs et Musulmans, elle n’en parle jamais comme de deux communautés séparées puisqu’elle pense que celles-ci n’existent pas et n’ont jamais existé. Certes elle ne peut manquer de signaler l’existence d’un antisémitisme en Algérie mais elle y voit le fait de quelques individus particuliers qui sont parvenus ici ou là à jouer un rôle néfaste politiquement. On remarque aussi dans son livre qu’elle ne parle jamais de l’Etat d’Israël ni des Palestiniens, et si l’on cherche à voir ce qu’elle propose comme solution, sous la forme romanesque évidemment (mais est-il besoin de solution s’il n’y a pas de problème ?), on est amené à penser que le modèle à suivre pourrait être celui de Daniel qui au moment où Becca le retrouve vit avec une épouse musulmane et semble ne faire aucune référence ni pour lui-même ni pour les autres à sa judaïté. Se fondre dans cette masse qu’est le peuple algérien (ou la nation algérienne pour ceux qui préfèrent parler politiquement ); éviter de se définir par l’appartenance à une communauté séparée, telle serait la seule réponse possible aux fauteurs de haine qui trouvent leur compte à entretenir la menace d’affrontement.
Mais le roman est ouvert sur l’avenir : reste à savoir ce que fera Becca ?
Denise Brahimi
(voir aussi une note de lecture de Catherine Giffard:https://coupdesoleil.net/evenements/maison-atlas-roman-et-histoire-juifs-en-algerie/
« L’HISTOIRE DE L’ALGERIE EN 54 OBJETS », Jazaïrhope 2022
Ce livre se présente comme un parcours chronologique en 6 chapitres qui conduit le lecteur de la préhistoire jusqu’à l’indépendance, sinon tout à fait jusqu’à aujourd’hui. Il est l’œuvre de plusieurs auteur.e.s qui sont principalement des anthropologues, la dénomination scientifique la plus vaste pour désigner l’apport d’un ensemble de sciences humaines à la connaissance d’un objet —celui-ci désignant dans ce livre l’Algérie elle-même. Mais le mot « objet » qui figure dans le titre y prend un sens très particulier et du fait qu’il est au pluriel, il y devient tout à fait concret : ce sont vraiment des objets au sens matériel du mot qui y sont utilisés, du moins au départ de chacun des courts articles dont l’ensemble constitue ce livre relativement petit, guère plus de 200 pages, ce qui représente une véritable gageure pour un parcours d’une telle ampleur.
 54 objets nous dit-on, et ce chiffre ne reste pas longtemps énigmatique dès qu’on a compris le but et l’intention de ce livre : il s’agit de célébrer la formation et la conquête de la nation algérienne par elle-même, à partir du moment où elle entre en guerre contre la colonisation pour restaurer son identité. La date de 1954, en tant que début de la guerre d’Indépendance, est rappelée par ce titre en tant que date-clef d’une histoire résolument nationale. Tout ce qui précède est destiné à montrer la constitution du patrimoine algérien au cours des siècles et même des millénaires puisque le premier chapitre a pour objet, c’est bien le mot, la mâchoire de l’Homme de Tighennif, représentant « la plus ancienne espèce humaine primitive du Nord de l’Afrique ». On a compris dès la présentation de ce livre qu’il ne cherche pas à faire œuvre d’érudition mais qu’il veut au contraire se rendre autant que possible accessible en utilisant la matérialité des objets en même temps que leur signification symbolique. Cette mâchoire permet de suggérer, non sans quelque précaution, que la présence humaine en Algérie remonterait à 2,4 millions d’années !
54 objets nous dit-on, et ce chiffre ne reste pas longtemps énigmatique dès qu’on a compris le but et l’intention de ce livre : il s’agit de célébrer la formation et la conquête de la nation algérienne par elle-même, à partir du moment où elle entre en guerre contre la colonisation pour restaurer son identité. La date de 1954, en tant que début de la guerre d’Indépendance, est rappelée par ce titre en tant que date-clef d’une histoire résolument nationale. Tout ce qui précède est destiné à montrer la constitution du patrimoine algérien au cours des siècles et même des millénaires puisque le premier chapitre a pour objet, c’est bien le mot, la mâchoire de l’Homme de Tighennif, représentant « la plus ancienne espèce humaine primitive du Nord de l’Afrique ». On a compris dès la présentation de ce livre qu’il ne cherche pas à faire œuvre d’érudition mais qu’il veut au contraire se rendre autant que possible accessible en utilisant la matérialité des objets en même temps que leur signification symbolique. Cette mâchoire permet de suggérer, non sans quelque précaution, que la présence humaine en Algérie remonterait à 2,4 millions d’années !
Les 6 chapitres du livre présentent un certain nombre d’objets, tous illustrés par une représentation visuelle si minime soit-elle qui contribue à leur donner un caractère concret. On ne s’étonnera pas que la période de la colonisation française soit la plus nourrie et comporte pas moins qu’une quinzaine d’objets, parmi lesquels une part importante est faite à l’Emir Abdel-Kader, à son sceau et à sa smala. Mais l’avantage du type de présentation choisi pour ce livre est aussi de donner forme à des événements ou à des documents qui si connus soient-ils ne l’étaient pourtant que comme des formules ou des mots. Beaucoup de ceux et celles qui n’appartiennent pas à la communauté de la recherche historique n’avaient sans doute jamais vu ni cherché à voir comment se présente le fameux décret Crémieux qui « déclare citoyens français les Israélites indigènes de l’Algérie ». Et on le voit ici !
Il est très plaisant de trouver dans ce livre une très grande variété d’objets, pour reprendre ce mot, qui sont souvent d’une grande beauté, tels que la selle du Dey d’Alger, aussi élégante que luxueuse et d’ailleurs chargée d’une longue histoire ; mais il y a aussi à l’inverse des images effroyables, comme la guillotine de la prison Barberousse, utilisée pendant la Guerre d’Algérie. A sa juste place puisqu’à l’origine de la conquête coloniale, il y a le « chasse-mouche » trop souvent utilisé dans les récits pour ne pas être devenu en partie mythique ou légendaire. D’autres objets le sont d’autant plus qu’on peut les voir maintenant dans de très grands musées comme le Louvre. D’ailleurs nombre d’entre eux ont été choisis par l’Unesco pour figurer au patrimoine mondial de l’humanité.
Pour des gens peut-être plus frivoles, ou plus esthètes et moins soucieux d’Histoire avec un grand H, il y a beaucoup de plaisir à trouver répartie dans les chapitres de ce livre une double collection, consacrée l’une à des instruments de musique et l’autre à des bijoux, deux catégories d’objets qui caractérisent la qualité d’une civilisation. Parmi les premiers, on est content de trouver l’imzad, instrument typique des populations touaregs et qui est l’apanage des femmes ; ou encore la Kwitra, richement ornée et chère aux écoles musicales de Tlemcen et d‘Alger (après avoir été utilisée au temps de l’Espagne islamique.
Quant aux bijoux, ils sont nombreux dans cette sélection et certains d’une grande beauté, comme ce qu’on appelle le nœud d’amour algérien et qui existe aussi bien en boucles d’oreilles qu’en collier ; certains peuvent aussi être la marque de telle ou telle région, variable selon la manière dont ils sont portés : c’est le cas du skhab, long collier dont les perles sont une pâte d’ambre gris, de clous de girofles et autres produits naturels odorants.
Plus on avance dans le livre et plus on est frappé par sa volonté de mettre en valeur le patrimoine algérien ; le discours national, ou nationaliste, y prend de plus en plus d’importance et c’est parfois aux dépens des objets eux-mêmes, dont pourtant on ne se lasse pas. On se prend à rêver d’une édition de luxe qui les mettrait en valeur encore davantage, mais ce serait contraire à l’esprit de ce livre qui veut être accessible à tous et qui est en effet un excellent travail de vulgarisation.
Denise Brahimi
« ALGERIE, DES PEINTRES DE LA CONQUÊTE, EUGENE FROMENTIN ET HORACE VERNET » par Maurice Mauviel, éditions Wallada, 2022
Ce gros livre est certes illustré mais toujours trop peu au gré du lecteur et surtout par des images beaucoup trop petites par rapport au format réel des tableaux. Il n’y en a pas moins beaucoup à tirer de cette étude riche en informations souvent fort détaillées, de plus animée par une intention fort perceptible qui lui sert de fil conducteur. Et cette intention est d’autant plus louable qu’elle n’est pas, et de loin, l’attitude la plus répandue à l’égard des peintres dont il est question dans ce livre, les deux qui sont cités dans le titre et quelques autres qui sont venus s’y rajouter plus brièvement.
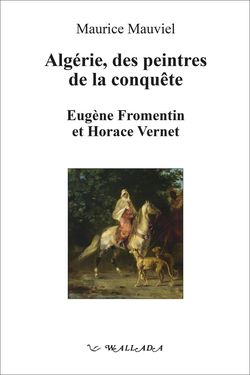 Ces peintres, éventuellement écrivains, appartiennent à la catégorie dite des orientalistes, le mot « Orient » incluant dans ce cas l’Algérie conquise par la puissance coloniale française à partir de 1830. Comme il le précise lui-même, Maurice Mauviel s’est intéressé essentiellement aux représentations de la conquête, c’est-à-dire aux très nombreux combats, dont certains plus connus que d’autres, qui ont été nécessaires à l’armée française pendant plusieurs décennies pour venir à bout des résistances qu’elle rencontrait.
Ces peintres, éventuellement écrivains, appartiennent à la catégorie dite des orientalistes, le mot « Orient » incluant dans ce cas l’Algérie conquise par la puissance coloniale française à partir de 1830. Comme il le précise lui-même, Maurice Mauviel s’est intéressé essentiellement aux représentations de la conquête, c’est-à-dire aux très nombreux combats, dont certains plus connus que d’autres, qui ont été nécessaires à l’armée française pendant plusieurs décennies pour venir à bout des résistances qu’elle rencontrait.
Il est évident que l’orientalisme ne se résume pas (pas même majoritairement) à ces scènes guerrières qui d’ailleurs permettent au peintre, parfois ou souvent chez Horace Vernet, de s’attarder sur des motifs descriptifs voire pittoresques, dont on devine qu’ils étaient très appréciés, ne serait-ce que par leur nouveauté et aussi par leur richesse ornementale.
En fait la peinture le plus souvent désignée comme orientaliste concerne les mœurs, la vie quotidienne et notamment celle des femmes, certains paysages mais le plus souvent limités à des tableaux de proximité. Et ce qui s’en dégage est beaucoup plus pacifique sauf exception que les scènes montrées par les « peintres de la conquête » auxquels s’est intéressé Maurice Mauviel. Mais il faut dire que ce n’est pas vraiment à l’origine son choix qui l’a porté à cela, il y a été conduit par une polémique longue et durable mettant en cause l’orientalisme et visant à le dénigrer gravement. On peut citer pour faire vite l’ouvrage le plus connu à cet égard, et déjà un peu ancien (mais il a des épigones non moins virulent.e.s encore aujourd’hui) : il s’agit d’un livre de l’Américain d ‘origine palestinienne Edward Saïd, « L’Orientalisme. L’Orient crée par l’Occident. » (1978). La thèse très polémique de ce livre est que l’orientalisme a été créé de toute pièce et sans fondement pour soutenir l’idée d’une supériorité des Occidentaux propre à justifier leur volonté de conquérir toute une vaste partie du monde. Et celle-ci, sommairement et globalement, s’est trouvé baptisée « Orient » par leurs soins. Dans ce vaste ensemble, la peinture de scènes dites orientales ne peut être vue que comme chargée d’intentions. Il s’agirait, dans tous les cas, de donner une vision péjorative des supposés Orientaux, et dans le cas particulier de la conquête de l’Algérie cette même thèse voudrait que les peintres aient montré les personnages dits orientaux dans des poses ou des attitudes ou des situations humiliantes ou ridicules pour eux.
 Maurice Mauviel s’emploie avec précision à montrer pourquoi il n’en est rien, ce qui n’est pas toujours une question d’interprétation mais souvent, tout simplement, renvoie à une lecture factuelle des scènes représentées.
Maurice Mauviel s’emploie avec précision à montrer pourquoi il n’en est rien, ce qui n’est pas toujours une question d’interprétation mais souvent, tout simplement, renvoie à une lecture factuelle des scènes représentées.
Les observations du livre à cet égard sont d’autant plus crédibles que son auteur n’adopte pas un ton polémique mais s’appuie souvent sur des déclarations des peintres eux-mêmes : plus particulièrement dans le cas d’Horace Vernet, nombre de ses déclarations prouvent qu’il n’aime pas la guerre (surtout pas celle-là sans doute) et qu’il est très loin d’admirer ou d’approuver les comportements des soldats français.
Pour ce qui est d’Eugène Fromentin, les pages qui lui sont consacrées sont moins nombreuses et sans doute moins riches, elles concernent ce que cet auteur a montré et dit (puisqu’il est à a fois peintre et écrivain à parts égales plus ou moins) à propos de la prise de la ville de Laghouat dans le sud algérien, un épisode de la conquête dont tout le monde s’accorde à reconnaître qu’il a été particulièrement sanglant et que Fromentin relate dans son livre intitulé « Un été au Sahara ». Mais c’est bien plus encore dans son autre récit algérien, intitulé « Une année dans le Sahel » qu’il exprime les impressions tirées de ses voyages et séjours faits en Algérie entre 1846 et 1853. On peut difficilement être plus éloigné de la vision d’Edward Saïd que les réflexions de Fromentin dans ce livre sur la tristesse et les effets néfastes voir mortifères de la conquête.
Maurice Mauviel parle bien de l’amour de certains artistes et écrivains pour l’Algérie, il veut rappeler le souvenir de certains d’entre eux qui sont encore plus ou moins méconnus, au nombre desquels l’écrivain Jean Pélégri, qui fut lié à Mohammed Dib par une grande amitié. Il s’agit de leur rendre justice, et de lutter contre les idées reçues, qui ne relèvent ni de la critique littéraire ni de la critique d’art mais de l’idéologie.
Denise Brahimi
« MOÏSE DE TETOUAN, SA MEMOIRE EN HERITAGE 1492-1962 » par Sylviane Serruya, éditions BoD-Books on demand, 2020
Ce livre est consacré, à travers un exemple, à l’histoire des Juifs dits sépharades, c’est-à-dire d’Espagne, du Maroc et d’Algérie : le mot sépharade qui vient de la langue hébraïque médiévale, désigne la péninsule ibérique et les Juifs qui y habitaient mais ont dû en partir lorsque les souverains catholiques les en ont expulsés. Cet événement historique marquant date de 1492, comme il est rappelé dans le titre de ce livre, l’autre date qui s’y trouve également est celle d’un exode massif des Juifs d’ Algérie lorsque celle-ci est devenue une nation indépendante de la France dont elle était une colonie depuis 1830.
 Entre les deux dates, moins de cinq siècles se sont écoulés, très remplis d’événements pour la population juive des « mégorachim », ce nom désignant ceux qui ont été expulsés d’Espagne en 1492. De façon assez naturelle, ils sont alors partis s’implanter au plus près de leur point de départ, sur la côte marocaine du nord, et notamment à Tétouan dont il est également question dans le titre : la ville est située à une soixantaine de Kilomètres de Tanger et elle est proche du détroit de Gibraltar, elle est très marquée par l’influence de l’Andalousie et l’importance de la population juive fait qu’elle est ou était parfois désignée comme « la petite Jérusalem ». Cependant, au moment où s’y réfugient les ancêtres de Moïse, lui-même ancêtre de l’auteure du livre, on ne peut dire qu’il leur soit fait bon accueil, et les choses se sont même gâtées à tel point que leurs conditions de vie, très dégradées à la fin du XVIIIe siècle, les obligent finalement à un nouvel exode. Ils font cette fois le choix de l’Algérie voisine, c’est-à-dire de l’Oranie.
Entre les deux dates, moins de cinq siècles se sont écoulés, très remplis d’événements pour la population juive des « mégorachim », ce nom désignant ceux qui ont été expulsés d’Espagne en 1492. De façon assez naturelle, ils sont alors partis s’implanter au plus près de leur point de départ, sur la côte marocaine du nord, et notamment à Tétouan dont il est également question dans le titre : la ville est située à une soixantaine de Kilomètres de Tanger et elle est proche du détroit de Gibraltar, elle est très marquée par l’influence de l’Andalousie et l’importance de la population juive fait qu’elle est ou était parfois désignée comme « la petite Jérusalem ». Cependant, au moment où s’y réfugient les ancêtres de Moïse, lui-même ancêtre de l’auteure du livre, on ne peut dire qu’il leur soit fait bon accueil, et les choses se sont même gâtées à tel point que leurs conditions de vie, très dégradées à la fin du XVIIIe siècle, les obligent finalement à un nouvel exode. Ils font cette fois le choix de l’Algérie voisine, c’est-à-dire de l’Oranie.
Ceux que Sylviane Serruya appelle « mes trisaïeuls » fuient Tétouan en 1855, pour une Algérie qui est celle de la conquête, la résistance de l’Emir Abdelkader ayant d’ailleurs entraîné l’implication du Sultan du Maroc dans ces événements.
Les immigrants juifs recherchent la protection de la France et en bénéficient en effet tant bien que mal. Mais ils n’ont pas d’autres atouts à leur disposition, étant mal vus à la fois des colons (de diverses origines ) et des Musulmans.
Peut-on considérer que Moïse, l’ancêtre que Sylviane Serruya a choisi d’évoquer, est une sorte de témoin exemplaire, représentatif de sa communauté ? A dire vrai, ce n’est pas forcément ce qui apparaît à la lecture du livre, Moïse n’a vraiment rien d’exceptionnel et sa descendante ne cesse de reconnaître qu’elle manque complètement d’informations sur son personnage de prédilection. Ce qui n’a évidemment rien d’étonnant mais entraîne une conception assez particulière du livre, écrit autour de ou à partir d’un personnage qu’on pourrait dire « en creux ». Dans tous les passages ou presque qui sont consacrés à son héros Moïse, l’auteure procède de la même façon, ce qui veut dire qu’elle commence par une très importante batterie de questions qui le concernent plus ou moins directement mais qui de toute façon resteront sans réponse : tout au plus peut-elle proposer un certain nombre de vraisemblances ou de possibilités qu’aucune preuve tangible ne permet d’attester. C’est l’histoire telle qu’elle aurait pu être ou qu’elle a peut-être été mais qui peut le dire ?
Finalement le seul événement d’ailleurs tout à fait dramatique qu’elle puisse avancer au sujet de Moïse concerne sa mort, très prématurée puisqu’elle se produit en 1891, alors qu’il est âgé de 37 ans (il était né à Tétouan en 1854). Comme on en est prévenu de façon allusive auparavant, on s’imagine qu’il a dû être victime d’un acte antijuif mais en fait il n’en est rien : il a été victime d’un fou jaloux qui le prend pour l’amant de sa femme !
Après quoi d’ailleurs l’histoire continue et elle est riche d’exactions de toute sorte commises contre les Juifs ; en l’absence du défunt Moïse, Sylviane procède comme elle l’a à peu près toujours fait auparavant, la seule différence étant qu’elle présente les événements dont elle parle comme ceux qu’il n’a pas pu voir puisqu’ils se sont produits après sa mort.
 Le livre est animé par la volonté manifeste d’être utile et convaincant, à cette fin il propose un certain nombre de documents et de fait, même pour ceux qui ont quelques notions sur les Juifs sépharades à travers l’histoire, c’est l’occasion d’acquérir des connaissances plus précises—il semble d’ailleurs qu’on ait de plus en plus de moyens de le faire depuis un certain temps grâce à la publication de travaux, études ou romans.
Le livre est animé par la volonté manifeste d’être utile et convaincant, à cette fin il propose un certain nombre de documents et de fait, même pour ceux qui ont quelques notions sur les Juifs sépharades à travers l’histoire, c’est l’occasion d’acquérir des connaissances plus précises—il semble d’ailleurs qu’on ait de plus en plus de moyens de le faire depuis un certain temps grâce à la publication de travaux, études ou romans.
Sans doute sommes-nous arrivés à un moment de l’histoire où certains conflits étant apaisés, on peut considérer beaucoup de faits comme historiques ce qui signifie sans doute plus abordables et moins polémiques qu’ils ne l’ont été. L’abondance de travaux consacrés aux Ashkénazes (ou Juifs d’Europe centrale et orientale) notamment du fait de la Shoah a pu créer aussi une sorte d’émulation parfaitement légitime, aux effets bienvenus. Sylviane Serruya qui est née à Oran a vécu le dernier exil de sa communauté mais son livre prouve qu’à l’évidence elle n’accepte pas l’oubli. Il y a chez elle un besoin émouvant de reconnaissance à l’égard de ses ancêtres et une infinie compassion pour ce qu’ils ont vécu.
Denise Brahimi
« LES FRANCAIS ET LA MUSIQUE ARABE EN ALGERIE» Conférence de Martial Pardo, le 17 mars 2023, Théâtre de l’Iris, Villeurbanne
Dans son enfance algérienne, Martial Pardo n’a jamais entendu de musique arabe et la langue ne lui a pas été enseignée. Musicien de jazz, il a dirigé le conservatoire de Villeurbanne, seule ville avec Bourges à être dotée d’un cursus de musique et de danse orientale parmi les 145 grands conservatoires de France. Ce qui est évidemment dommage !
 Sa conférence invite à voyager aux côtés des écrivains et des musiciens français, du Levant aux régences barbaresques, puis – surtout – en Algérie coloniale.
Sa conférence invite à voyager aux côtés des écrivains et des musiciens français, du Levant aux régences barbaresques, puis – surtout – en Algérie coloniale.
Au nombre des écrivains qu’il évoque se trouvent Hugo, Gautier, Fromentin, Maupassant, les Goncourt, Daudet ; puis un peu plus tard, Loti, Gide, Eberhardt et Montherlant. Au fil des pages, les paysages sonores abondent. Souvent, par sa « monotonie », la musique arabe irrite. Et quand elle fascine, une réaction de rejet s’en suit, par réaction.
Contrairement aux peintres, les compositeurs français ne font pas le voyage – excepté Saint-Saëns, pour sa santé…l’arbre qui cache le désert. Les musicographes, eux, scrutent les éléments qui heurtent leur oreille et leurs certitudes. Rares sont ceux qui cherchent à comprendre cette musique, à l’aimer, à la partager avec les « indigènes ». La tendance est à la dépréciation : que (ne) s’est-il (pas) passé dans l’écoute de l’Autre ? La question de l’ouïe, qui touche à l’intime, au « goût », comme à la représentation de l’Autre et à ses stéréotypes, est une des voies pour créer la relation…ou rester sourd à l’Autre.

« LA DERNIERE REINE » film réalisé par Damien Ounouri et Adila Bendimerad, 2022
Le premier plaisir que donne ce film est d’être assez différent de ce qu’on attendait, un film intéressant de toute façon mais qu’on croyait pouvoir ranger dans une catégorie bien définie, celle des films historiques eux-mêmes tirés de romans qu’on désigne de la même façon. On peut trouver au sein de ce genre aussi bien des aspects tragiques ou comiques, mais surtout des aventures en abondance, qui sont datées et traitées avec un respect plus ou moins grand de la réalité.
 Or La Dernière Reine correspond en partie à l’idée qu’on se fait d’un film historique mais en partie seulement. Un très bref rappel des faits situe l’histoire en 1516 à Alger, à un moment où de longue date déjà cette ville est convoitée par un pays voisin fort puissant, l’Espagne, auquel elle a bien du mal à résister. Ce dont s’inquiète évidemment l’homme qui la dirige, le Sultan Salim Toumi, qui cherche l’appui militaire d’un Musulman comme lui et le trouve en la personne d’Aroudj Barberousse, le chef de corsaires efficaces et violents dont la profession consiste à louer leurs services dans l’espace méditerranéen. L’alliance de Salim et d’Aroudj permet de remporter la victoire sur les Espagnols, d’où une grande satisfaction chez ceux qu’on peut bien appeler les Algériens puisque ce sont les habitants de la ville d’Alger. En ce début du 16e siècle, on se doute que celle-ci a déjà une longue histoire mais le projet du film n’est pas de la raconter. Il donne sans doute envie d’en savoir plus, il nous fait comprendre l’immensité de notre ignorance mais son originalité est qu’il ne raconte pas un épisode situé dans l’histoire, il s’y intéresse comme à un moment présent qu’il nous met sous les yeux, et de ce fait il gomme son historicité plus qu’il ne cherche à la mettre en valeur ou à la restituer : peu importe que ce soit un film historique, c’est une histoire qui nous est racontée dans son immédiateté, le film lui restitue une présence qui est justement le propre du présent, si l’on veut bien jouer ainsi sur les mots.
Or La Dernière Reine correspond en partie à l’idée qu’on se fait d’un film historique mais en partie seulement. Un très bref rappel des faits situe l’histoire en 1516 à Alger, à un moment où de longue date déjà cette ville est convoitée par un pays voisin fort puissant, l’Espagne, auquel elle a bien du mal à résister. Ce dont s’inquiète évidemment l’homme qui la dirige, le Sultan Salim Toumi, qui cherche l’appui militaire d’un Musulman comme lui et le trouve en la personne d’Aroudj Barberousse, le chef de corsaires efficaces et violents dont la profession consiste à louer leurs services dans l’espace méditerranéen. L’alliance de Salim et d’Aroudj permet de remporter la victoire sur les Espagnols, d’où une grande satisfaction chez ceux qu’on peut bien appeler les Algériens puisque ce sont les habitants de la ville d’Alger. En ce début du 16e siècle, on se doute que celle-ci a déjà une longue histoire mais le projet du film n’est pas de la raconter. Il donne sans doute envie d’en savoir plus, il nous fait comprendre l’immensité de notre ignorance mais son originalité est qu’il ne raconte pas un épisode situé dans l’histoire, il s’y intéresse comme à un moment présent qu’il nous met sous les yeux, et de ce fait il gomme son historicité plus qu’il ne cherche à la mettre en valeur ou à la restituer : peu importe que ce soit un film historique, c’est une histoire qui nous est racontée dans son immédiateté, le film lui restitue une présence qui est justement le propre du présent, si l’on veut bien jouer ainsi sur les mots.
A partir du moment où la situation et les événements historiques ont été sommairement évoqués, le film entre dans une succession de péripéties romanesques qui font évidemment place à l’imagination. Et l’on fait ici encore le même constat : le libre cours donné à l’imaginaire et au romanesque n’a rien en soi d’étonnant puisque c’est au contraire une constante du genre, cependant le style et la manière de La Dernière Reine frappent d’emblée par leur originalité. On comprend dès les premières images du film que les deux réalisateurs n’ont tenu aucun compte des conventions non dites mais pourtant bien réelles qui donnent aux films historiques un côté aisément reconnaissable : ce serait comme si les figures du Musée Grévin prenaient soudain vie dans un film d’animation. Cependant ce ne sont pas des personnages comme ceux que nous pourrions rencontrer dans un autre film plus actuel ou dans la vie, ils portent l’indice de leur historicité. Or rien de tel dans La Dernière Reine, celle-ci comme tous les autres entraînés dans son aventure sont dépourvus de cet indice, on a envie de dire qu’ils sont nus parce qu’ils sont dénués de ce qui en ferait des personnages, alors qu’ils sont des humains qui se dévoilent à eux-mêmes, et sous nos yeux ils sont livrés à l’arbitraire de la vraie vie qui les malmène et les bouscule et fait de nous les témoins.

Photo Eric Catarina
A la différence de ce qui se passerait dans un film historique plus traditionnel et plus attendu, La Dernière Reine ne met pas en œuvre des personnages dont les caractéristiques seraient fixées une fois pour toutes et qu’il suffirait de promener à travers leurs aventures en les laissant eux-mêmes inchangés. Ils ne sont pas prédéfinis mais au contraire en recherche, partiellement imprévisibles et remarquables par leur mobilité. La reine Zaphira semble d’abord uniquement soucieuse de s’attacher l’amour de son mari le Sultan Selim puis l’unique centre de sa vie devient le fils qu’elle a eu de lui ; puis elle entre dans une machination complexe pour se débarrasser d’Aroudj qui veut l’épouser ; puis elle renonce à ce projet et il se pourrait, mais le saura-t-on jamais, qu’elle tombe amoureuse de lui et préfère disparaître que de le tuer. Aroudj n’est pas moins mouvant voire insaisissable car il se prend lui aussi pour un manipulateur alors qu’il est peut-être finalement un homme amoureux et plein de désirs contradictoires, qui devient émouvant après avoir paru odieux. Lorsque la tragédie entre en scène pour finir, c’est comme si la vérité parvenait à se faire jour à travers une série de leurres qu’il a fallu traverser et l’on se sent finalement plus près d’un drame shakespearien que des « Trois mousquetaires » d’Alexandre Dumas. Ainsi se renouvelle notre vision et la vitalité du film ou sa vivacité est due à ce qu’il laisse jusqu’au bout sa place à l’imprévu. L’un de ses aspects étonnants est qu’il ne cherche pas à rendre ses personnages sympathiques, pas même ou surtout pas la Reine, mais qu’on s’attache à eux cependant, quel que soit leur statut par rapport à l’Histoire (avec un grand H) : Aroudj Barberousse a en effet existé et il est bien connu des historiens sinon pour lui-même mais en tout cas pour le rôle qu’il a joué ; pour ce qui concerne Zaphira, tout est incertain, il se pourrait qu’elle n’ait même pas existé ; mais cette différence entre eux ne se sent nullement dans le film, il leur appartient d’y créer leur crédibilité et c’est en cela que les acteurs sont convaincants car ils y parviennent, parce qu’ils sont sincères et non parce qu’ils usent de procédés. L’Histoire dans ce film est en train de se faire, elle n’est pas seulement écrite au passé, même si ce passé est une sorte d’heureuse découverte, palliant notre ignorance : un monde si proche, pour ainsi dire à portée de main, que le film nous offre comme un cadeau.
Denise Brahimi
(voir aussi https://coupdesoleil.net/lire-ecouter-voir/western-algerois-la-derniere-reine/
“HOURIA” film de Mounia Meddour,2023
Quatre ans après Papicha (2019), film de la même réalisatrice, on peut d’autant moins éviter de rapprocher les deux films qu’ils bénéficient l’un et l’autre de la même actrice principale, Lyna Khoudri, maintenant âgée d’une trentaine d’années mais qui a toujours l’air d’en avoir vingt sinon dix-sept et qui impose toujours sa présence avec le même  talent. Ce qu’on ressent physiquement comme une extrême jeunesse est d’autant plus remarquable que le personnage est doué d’une volonté et d’une intensité qui ne se dément jamais, même au pire moment des événements tragiques qui surgissent dans sa vie lorsqu’à la suite d’une agression physique violente elle perd la faculté de danser, et du même coup le désir de vivre—c’est du moins ce qu’elle croit dans un premier temps. En fait, la faculté qu’elle perd assurément est celle de parler, le traumatisme qu’elle a subi l’ayant rendu muette, ce qu’elle parvient à compenser en faisant l’apprentissage de la langue des signes et en vivant parmi des compagnes qui sont muettes comme elle, à la suite de ce qu’elles ont subi pendant la terrible décennie noire, les vingt ou trente ans écoulés depuis lors n’ayant pas effacé les séquelles des horreurs qui ont sévi à l’époque en Algérie.
talent. Ce qu’on ressent physiquement comme une extrême jeunesse est d’autant plus remarquable que le personnage est doué d’une volonté et d’une intensité qui ne se dément jamais, même au pire moment des événements tragiques qui surgissent dans sa vie lorsqu’à la suite d’une agression physique violente elle perd la faculté de danser, et du même coup le désir de vivre—c’est du moins ce qu’elle croit dans un premier temps. En fait, la faculté qu’elle perd assurément est celle de parler, le traumatisme qu’elle a subi l’ayant rendu muette, ce qu’elle parvient à compenser en faisant l’apprentissage de la langue des signes et en vivant parmi des compagnes qui sont muettes comme elle, à la suite de ce qu’elles ont subi pendant la terrible décennie noire, les vingt ou trente ans écoulés depuis lors n’ayant pas effacé les séquelles des horreurs qui ont sévi à l’époque en Algérie.
Historiquement et politiquement, le film de Mounia Meddour est centré sur ces années là et fait le constat que l’Algérie n’a pas réussi à apaiser les troubles de l’époque, alors même que l’Etat national pensait ou prétendait l’avoir fait : n’avait-on pas réintégré, sous le nom de « repentis », ceux qui s’étaient égarés clandestinement dans la pratique du terrorisme ? Cet épisode sanglant étant officiellement déclaré clos, il ne devrait plus y en avoir d’effets dans la société civile …et pourtant ce qu’on constate et qui est dénoncé dans le film est bien différent. Un certain Ali, connu comme repenti mais qui n’a pas pour autant renoncé à ses habitudes de violence et qui semble protégé par une surprenante impunité provoque le drame qui brise la cheville et du même coup la carrière d’Houria. Ni elle ni sa mère qui est pourtant une femme remarquablement énergique ne trouvent le moindre appui pour obtenir la punition du coupable, et l’on comprend peu à peu, en même temps qu’Houria elle-même, qu’elle ne peut émerger de sa catastrophe personnelle sinon par ses seules forces : chacun sait de nos jours ce qu’est la résilience, ou capacité de certains individus à surmonter si graves soient-elles les épreuves qui leur sont imposées par la vie.
Ce qu’on voit dans le film « Houria » amène d’ailleurs à nuancer l’expression « par ses seules forces». Car la jeune fille les puise aussi —et c’est un aspect du film touchant voire enthousiasment —dans le groupe solidaire formé par ses compagnes de misère qui de manières diverses ont été blessées comme elle, physiquement et moralement. Houria accepte de leur donner des leçons de danse, et prend appui sur ce rôle, où elle s’engage sans réserve, en mobilisant tout son talent : ainsi s’unissent dans cette histoire qu’on ne pourrait pourtant taxer d’optimisme résilience et sororité.
 Pour constituer ce collectif féminin qui est une vraie raison d’espérer, Mounia Meddour convoque les plus connues et les plus aimées des actrices maghrébines telles que Rachida Brakni ou Nadia Kaci . Ainsi comprenons-nous à voir son film que la solidarité joue à travers les générations et sans doute toutes les autres différences, ce qui est évidemment un message très actuel, opportunément rappelé après beaucoup de méconnaissance ou d’oubli.
Pour constituer ce collectif féminin qui est une vraie raison d’espérer, Mounia Meddour convoque les plus connues et les plus aimées des actrices maghrébines telles que Rachida Brakni ou Nadia Kaci . Ainsi comprenons-nous à voir son film que la solidarité joue à travers les générations et sans doute toutes les autres différences, ce qui est évidemment un message très actuel, opportunément rappelé après beaucoup de méconnaissance ou d’oubli.
Mais pour Mounia Meddour, la solidarité d’où elle tire force et courage n’est pas seulement sororale, elle est aussi filiale et dans ce dernier film on a l’impression qu’elle reprend sous une autre forme, comme d’ailleurs elle a annoncé qu’elle le ferait, le flambeau qu’a tenu son père Azzedine Meddour jusqu’à sa mort prématurée en 2000.
Dans son film qui est sans doute le plus connu et qui est une référence du cinéma amazigh, « La Montagne de Baya », il montrait aussi ce que veut dire persévérance, obstination et survie. Baya lutte pour la liberté de son peuple et l’on sait que le prénom Houria veut dire liberté.
Denise Brahimi
« LE BLEU DU CAFTAN » film marocain de Maryam Touzani, 2023
Ce film qui était très attendu reçoit d’emblée dans les salles et auprès de la critique un très bon accueil. En sorte qu’on peut l’aborder en s’interrogeant à ce propos : pourquoi le film séduit-il un tel public, qui n’est pas nécessairement marocain et va bien au-delà de la localisation dans sa société d’origine ? Il contient assurément un plaidoyer très touchant en faveur de l’homosexualité masculine mais on ne saurait dire que ce fait soit exceptionnel dans le cinéma d’aujourd’hui, ni même rare. On  dirait bien que dans les pays où il est encore stigmatisé voire puni de prison comme au Maroc, nombre d’énergies, les plus en vogue dans le monde de l’art, se liguent pour faire enfin sauter l’interdit, dont le film nous montre à quel point il est injustement cruel. Et dans « Le Bleu du caftan », la cinéaste toujours sensible à ce qu’on appelle les problèmes de société (formule bien trop vague pour désigner ce qui est souvent la source de très grandes douleurs) met tous les atouts de son côté pour montrer que l’homophobie n’a d’autre raison d’être sinon la force des préjugés.`
dirait bien que dans les pays où il est encore stigmatisé voire puni de prison comme au Maroc, nombre d’énergies, les plus en vogue dans le monde de l’art, se liguent pour faire enfin sauter l’interdit, dont le film nous montre à quel point il est injustement cruel. Et dans « Le Bleu du caftan », la cinéaste toujours sensible à ce qu’on appelle les problèmes de société (formule bien trop vague pour désigner ce qui est souvent la source de très grandes douleurs) met tous les atouts de son côté pour montrer que l’homophobie n’a d’autre raison d’être sinon la force des préjugés.`
En réalité ses atouts sont en nombre limité, ils consistent principalement en ses trois acteurs, tous excellents même si, en France du moins, l’actrice Lubna Azabal est la seule à être vraiment connue : âgée d’une cinquantaine d’années, elle a joué principalement et avec succès dans des films d’auteur. Dans « Le Bleu du caftan » elle se voit confier le rôle délicat d’une femme très éprise de son mari qui cependant est homosexuel, ce qu’elle n’ignore pas même si socialement il est tenu au secret. Le film est résolument intimiste, en ce sens que tout se passe dans la relation entre trois personnages, la femme Mina, son mari le tailleur Halim et un jeune homme entré par hasard dans la famille en tant qu’apprenti.
 Le talent de la réalisatrice fait qu’à partir de trois personnages seulement elle arrive à créer toute une gamme de situations à chaque fois différentes et toutes de haute intensité dramatique. Ce qui est d’autant plus étonnant que les deux hommes, Halim et son apprenti, sont quasi mutiques et ne disent jamais rien de leurs sentiments, dont la force est pourtant évidente et incontestable. Il s’agit de savoir comment se composent entre ces trois-là des désirs divergents , causant pour chacun d’entre eux des tensions qu’on peut dire tragiques—ce qui classiquement signifie que les situations sont inconciliables et que seule la mort, ici celle de Mina, apportera un dénouement à ces insoutenables douleurs.
Le talent de la réalisatrice fait qu’à partir de trois personnages seulement elle arrive à créer toute une gamme de situations à chaque fois différentes et toutes de haute intensité dramatique. Ce qui est d’autant plus étonnant que les deux hommes, Halim et son apprenti, sont quasi mutiques et ne disent jamais rien de leurs sentiments, dont la force est pourtant évidente et incontestable. Il s’agit de savoir comment se composent entre ces trois-là des désirs divergents , causant pour chacun d’entre eux des tensions qu’on peut dire tragiques—ce qui classiquement signifie que les situations sont inconciliables et que seule la mort, ici celle de Mina, apportera un dénouement à ces insoutenables douleurs.
Mina souffre doublement parce qu’elle est malade physiquement et qu’on assiste tout au long du film à son agonie, mais sa douleur vient de plus loin comme on dit dans la tragédie, puisque c’est celle de ne pouvoir vivre pleinement l’amour réciproque qui la lie à Halim. En fait Halim souffre lui aussi doublement, d’une part parce qu’il ne peut vivre son désir sexuel autrement que clandestinement et misérablement (on ne peut qu’admirer la façon discrète et pourtant évidente dont Maryam Touzani nous fait comprendre cela) ; et d’autre part parce qu’il se sent gravement coupable vis-à-vis de Mina sans pouvoir rien faire pour elle, même pas lui éviter la jalousie que dans un premier temps elle ne peut s’empêcher d’éprouver, lorsqu’elle découvre qu’un amour irrépressible s’est développé entre Halim et son apprenti. La douleur de celui-ci est peut-être la plus navrante et la plus chagrinante des trois sans doute parce qu’il s’agit du plus jeune, que personne semble-t-il n’a jamais aimé ni aidé depuis le début de sa vie, et pour qui Halim serait à la fois un père, un ami, un amant s’il ne s’agissait de toute manière d’un amour interdit, par la société mais d’abord par le respect et l’empathie qu’il éprouve pour Mina. Les larmes qu’il verse lorsque Halim rejette son geste de tendresse (désir et amour mêlés) sont d’une grande beauté parce qu’on voit bien que ce sont aussi celles d’un enfant innocent. D’ailleurs les trois sont innocents, sinon pour un mensonge que Mina a commis sciemment par jalousie et dont elle demande finalement pardon.
Mais pour parler encore de beauté, celle qui est évidente dans ce film lorsqu’elle parvient enfin à s’y faire place est la beauté du dépassement d’elle-même auquel Mina mourante parvient. Elle retrouve assez de vigueur et de vie pour faire comprendre à cet homme mûr et à ce jeune garçon qu’elle souhaite la réalisation de leur amour, car rien ne saurait être plus « pur », c’est le mot qu’elle emploie pour en parler.
Sans doute y -t- il dans le film une certaine idéalisation des trois personnages principaux, contrastant avec la médiocrité de leur entourage social, et par exemple celle des clientes vulgaires (mais riches) pour lesquelles Halim le tailleur brode d’admirables caftans. Certes, les temps sont tels que le moment est déjà venu où plus personne n’est ou ne sera capable de les apprécier. C’est pourquoi symboliquement Mina doit emporter avec elle dans la tombe l’admirable caftan bleu. La beauté à laquelle le film rend hommage est aussi bien celle d’une broderie que celle d’un amour pur et partagé. Ce film douloureux et triste est aussi rayonnant mais pour y parvenir il y fallait de la patience et du temps. Il n’est pas interdit de trouver une dimension mystique à ce dénouement.
Denise Brahimi
Un film (en salle à Toulouse entre autre en avril 2023) dont l’ambiance intimiste débouche sur des images de l’oued Bouregreg, inoubliables pour les amoureux de Salé.
Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.
 – Utiles
– Utiles
de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun
Cliquez ici pour voir le film et le mot de passe utilesjoussour

–Entre nos mains
de Leila Saadna
Cliquez ici pour voir le film, puis mot de passe utilesjoussour
Et sa bande-annonce, cliquez ici

Si vous souhaitez aider notre association régionale à développer ses actions, vous avez aussi la possibilité de faire un DON, via Hello Asso. Soyez-en remercié.e.s.
Si vous souhaitez vous investir à nos côtés, nous serions heureux d’accueillir votre adhésion. Il vous est possible de le faire en ligne sur notre site via Hello Asso.

Vous pouvez aussi nous commander notre livre « Algérie à coeur » en envoyant un chèque de 16€, port compris,
chez Michel Wilson 5 rue Auguste Comte 69002 LYON.
Et également vous avez la possibilité de souscrire en ligne sur notre site à l’ultime numéro de la Revue Le Croquant, un hommage à son créateur Michel Cornaton, que nous avons co-édité.
Nous souhaitons aussi contribuer à la diffusion du livre posthume de notre cher Abdelhamid LAGHOUATI, poète, artiste plasticien, ami de Jean Sénac et de tant d’autres. Une souscription est ouverte pour commander son livre par la Maison de la Poésie Rhône-Alpes à Saint Martin d’Hères.
SOUSCRIPTION
BON DE COMMANDE
Je commande .. .. .. .. exemplaire(s) de « Entre cri et passion » de Abdelhamid Laghouati.
Je règle par : ☐ chèque bancaire
☐ autre moyen (sauf carte bancaire)
☐ postal
À l’ordre de :
Maison de la Poésie Rhône-Alpes
33 avenue Ambroise Croizat
38400 Saint-Martin-d’Hères
Date : .. .. / .. .. / .. .. Signature :

- Lundi 3 avril Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie au Lycée Aragon Picasso de Givors
- Mardi 4 avril Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie au Lycée François Mauriac d’Andrézieux Bouthéon
- Vendredi 7 avril Cinémas du Sud à l’Institut Lumière de Lyon film La vie me va bien de Al Hadi Ulad-Mohand (Maroc)
- Samedi 8 avril Cinémas du Sud La vie d’après d’Anis Djaäd (Algérie). Voir notre Lettre n° 61 et l’article de Denise Brahimi.
- Dimanche 9 avril au cinéma Mourguet de Sainte Foy-les-Lyon film La dernière Reine de Damien Ounouri et Adila Bendimerad (cf article ci-dessus)
- Mardi 11 avril Film Rêves d’Omar Belkacemi au cinéma Charlie Chaplin de Monmélian. Voir l’article de Denise Brahimi dans notre Lettre n° 74
- Lundi 24 avril Film Rêves d’Omar Belkacemi au cinéma Opéra de Lyon
- Mercredi 26 avril présentation du livre Histoire de l’Algérie de l’origine à nos jours de Michel Pierre à la Librairie Le Tramway de Lyon
- Vendredi 28 avril intervention témoignages croisés sur la guerre d’Algérie au Collège Louise de Savoie à Pont d’Ain
N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.


