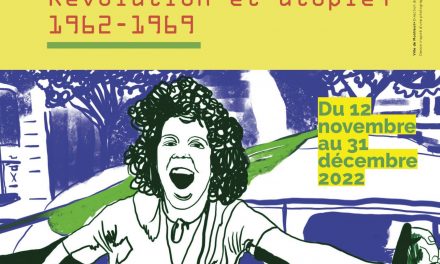« TOUS LES HOMMES DESIRENT NATURELLEMENT SAVOIR » de Nina Bouraoui (éditions Jean-Claude Lattès, 2018)
Quiconque a vu récemment une photo de Nina Bouraoui aura du mal à imaginer que cette écrivaine est maintenant plus que cinquantenaire et a déjà publié, depuis 1991, un nombre impressionnant de romans(tous accessibles en collection de poche). Elle  a gardé toute la grâce androgyne de l’adolescence, et semble échapper à tout ce qui marque ordinairement les individus, écrivains ou pas, homosexuels ou pas. C’est sans doute la raison pour laquelle il est important qu’elle raconte son histoire comme elle le fait, aussi clairement que possible, et on ne saurait en effet être plus clair qu’elle ne l’est dans ce dernier roman. Et pourtant rien n’est facile à expliquer dans son histoire, qui certes n’a rien d’exceptionnel mais qui cependant est complexe. Car la complexité est en elle à plusieurs niveaux dont on ne sait pas très bien s’ils ont un rapport entre eux ou s’il s’agit de séries indépendantes. D’une part Nina Bouraoui, née du couple mixte d’une Française et d’un Algérien, assume la double culture ou en tout cas la double appartenance qui en découle pour elle, d’autant qu’elle a effectivement vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 14 ans, ce qui n’est nullement négligeable (surtout pour une enfant précoce comme elle) avant de vivre à peu près exclusivement en France, et notamment à Rennes dans le milieu maternel de ses grands parents, on ne peut plus franco-français. Cependant elle ne parle pas de ce qui pourrait être un tiraillement provoqué par cette dualité familiale, et on ne voit aucun conflit significatif pour elle découlant de cette situation (même si la famille française a d’abord refusé le mariage mixte de ses parents). Il faut dire que le haut niveau et l’homogénéité des milieux sociaux dans lesquels elle a vécu lui a permis d’échapper au sentiment d’être cernée par des préjugés de type raciste ou racialiste. D’ailleurs c’est peut-être cette trop grande homogénéité qui l’a poussée à vouloir découvrir des aspects du monde plus problématiques et plus mêlés lorsque s’est fait sentir pour elle le désir d’écrire et de devenir écrivain. C’est d’elle-même qu’elle parle autant que des autres lorsqu’elle évoque dans le titre de son dernier roman le désir naturel de savoir.
a gardé toute la grâce androgyne de l’adolescence, et semble échapper à tout ce qui marque ordinairement les individus, écrivains ou pas, homosexuels ou pas. C’est sans doute la raison pour laquelle il est important qu’elle raconte son histoire comme elle le fait, aussi clairement que possible, et on ne saurait en effet être plus clair qu’elle ne l’est dans ce dernier roman. Et pourtant rien n’est facile à expliquer dans son histoire, qui certes n’a rien d’exceptionnel mais qui cependant est complexe. Car la complexité est en elle à plusieurs niveaux dont on ne sait pas très bien s’ils ont un rapport entre eux ou s’il s’agit de séries indépendantes. D’une part Nina Bouraoui, née du couple mixte d’une Française et d’un Algérien, assume la double culture ou en tout cas la double appartenance qui en découle pour elle, d’autant qu’elle a effectivement vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 14 ans, ce qui n’est nullement négligeable (surtout pour une enfant précoce comme elle) avant de vivre à peu près exclusivement en France, et notamment à Rennes dans le milieu maternel de ses grands parents, on ne peut plus franco-français. Cependant elle ne parle pas de ce qui pourrait être un tiraillement provoqué par cette dualité familiale, et on ne voit aucun conflit significatif pour elle découlant de cette situation (même si la famille française a d’abord refusé le mariage mixte de ses parents). Il faut dire que le haut niveau et l’homogénéité des milieux sociaux dans lesquels elle a vécu lui a permis d’échapper au sentiment d’être cernée par des préjugés de type raciste ou racialiste. D’ailleurs c’est peut-être cette trop grande homogénéité qui l’a poussée à vouloir découvrir des aspects du monde plus problématiques et plus mêlés lorsque s’est fait sentir pour elle le désir d’écrire et de devenir écrivain. C’est d’elle-même qu’elle parle autant que des autres lorsqu’elle évoque dans le titre de son dernier roman le désir naturel de savoir.
Cependant les fréquentations marginales qu’elle se met à chercher, alors qu’elle est seule et vit à Paris, ne sont liées que partiellement au désir de savoir. Il est vrai qu’à dix-huit ans, elle a tout à apprendre de la vie, et n’y sera pas aidée par l’université d’Assas où elle fait (ou est supposée faire) des études de droit. Ce n’est évidemment pas un hasard si elle choisit pour ce faire un lieu du 6e arrondissement de Paris réservé aux femmes homosexuelles et leur permettant de se rencontrer pour y former des liaisons plus ou moins sulfureuses et souvent cruelles. Nina Bouraoui évoque avec une précision assez grande ce et celles qu’elle a connues dans cet endroit, mais l’étonnant miracle que lui permet son talent d’écriture est qu’elle parvient à éviter tout ce qui pourrait susciter le voyeurisme, sans pour autant gommer quoi que ce soit des très difficiles relations induites par l’homosexualité. Il est vrai que ce dont elle nous parle date de la fin du siècle dernier et que l’homosexualité n’avait pas encore bénéficié de ce qui la rend—peut-être ?—moins difficile à vivre aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, il ressort de ce qu’elle raconte que beaucoup des femmes dont elle fait alors connaissance vivent leur situation en recourant à l’alcool ou à la drogue, et que ne manquent pas pour autant les tentatives de suicide ou les suicides si l’on peut dire réussis. On croit comprendre que l’auteure à laquelle sa jeunesse donne alors un statut particulier échappe personnellement à de telles tragédies, en revanche elle n’échappe pas aux drames passionnels, jalousie, dépit, souffrance de l’exclusion etc. Mais on croit comprendre aussi qu’en un sens c’est justement ce qu’elle cherche, connaissant de très longue date (elle dit quelque part qu’elle en a été consciente dès l’âge de huit ans) cette particularité qui sera son destin, l’homosexualité, —qu’elle ne refuse pas, sans pour autant se présenter comme une militante de la cause, et sans davantage gémir sur son sort. Le plus étonnant dans cette histoire est l’attitude parfaitement compréhensive de ses deux parents, la Française et l’Algérien, auxquels d’ailleurs 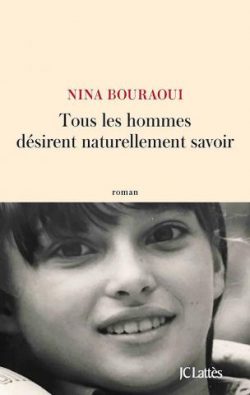 elle rend hommage en leur dédiant son livre. Pendant la partie algérienne de sa vie, il est certain qu’une certaine violence s’exerce contre toute forme de dissidence par rapport à la norme sociale exi gée, c’est-à-dire aussi bien à l’égard de sa mère, qui vit comme une femme libre, passionnée par la lecture et les arts, qu’à son propre égard, la moindre de insultes qu’elle reçoit étant d’être traitée de « pédé ». Au moment où elle quitte l’Algérie avec ses parents, en 1981, on est encore loin de la pression islamiste qui prendra toute sa force pendant la décennie suivante, mais la violence sous-jacente est extrêmement perceptible et l’on ne peut ignorer les dangers de la situation. Outre les problématiques déjà évoquées, le livre peut passer pour un hommage à la mère, qu’on ne connaît qu’indirectement à travers cette fille qui veut aussi être son fils, mais dont se dégage une sorte de lumière qui rayonne sur tout le livre. Il se peut que par la suite et pour toujours, Nina Bouraoui ait été à la recherche d’une « image de Mère »la ramenant à la première qu’elle ait connue et aimée ; il faudrait alors mettre un M majuscule à Mère, comme Lacan met un P majuscule à Père.
elle rend hommage en leur dédiant son livre. Pendant la partie algérienne de sa vie, il est certain qu’une certaine violence s’exerce contre toute forme de dissidence par rapport à la norme sociale exi gée, c’est-à-dire aussi bien à l’égard de sa mère, qui vit comme une femme libre, passionnée par la lecture et les arts, qu’à son propre égard, la moindre de insultes qu’elle reçoit étant d’être traitée de « pédé ». Au moment où elle quitte l’Algérie avec ses parents, en 1981, on est encore loin de la pression islamiste qui prendra toute sa force pendant la décennie suivante, mais la violence sous-jacente est extrêmement perceptible et l’on ne peut ignorer les dangers de la situation. Outre les problématiques déjà évoquées, le livre peut passer pour un hommage à la mère, qu’on ne connaît qu’indirectement à travers cette fille qui veut aussi être son fils, mais dont se dégage une sorte de lumière qui rayonne sur tout le livre. Il se peut que par la suite et pour toujours, Nina Bouraoui ait été à la recherche d’une « image de Mère »la ramenant à la première qu’elle ait connue et aimée ; il faudrait alors mettre un M majuscule à Mère, comme Lacan met un P majuscule à Père.
L’image si gracieuse et toujours jeune que l’auteure donne d’elle-même est aussi une image énigmatique sur laquelle on reconnaît le sourire du Sphinx. Comme par ailleurs elle parle, à propos de son propre cas, d’un œdipe inversé, on se dit que la clarté apparente et réelle de son récit n’en cache pas moins beaucoup de mystères qui le rendent très attachant, très poétique aussi, comme si une sorte d’arrière-plan métaphysique sous-tendait la transparence du récit. On pourrait être chez Jean Genet si l’on n’était en même temps chez la Princesse de Clèves. Références certes un peu lourdes mais entre lesquelles elle glisse subtilement.
Denise Brahimi
(extrait de la Lettre culturelle franco-maghrébine N° 33, mai 2019, Coup de Soleil Lyon)