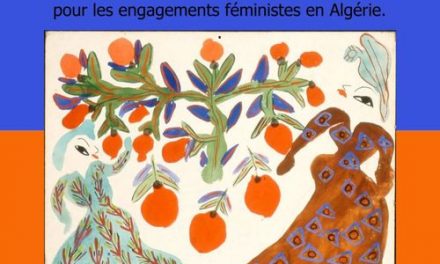Editorial
La rentrée n’a pas été seulement universitaire et scolaire, elle s’est accompagnée aussi d’une grande activité pour une association comme la nôtre, entraînant sans doute de nouveaux désirs de lecture. En tout cas nous vous en proposons quelques-unes dans nos champs d’intérêt habituels.
Des romans comme toujours, dont deux d’origine maghrébine, du Marocain Taïa « Le Bastion des larmes » et du bien connu Yasmina Khadra « Cœur d’amande »qui met l’eau à la bouche avec son nom de gâteau sucré ! A quoi il faut ajouter « L’agrafe » un roman français de Maryline Desbiolles qui rejoint le problème posé par la présence en France des communautés de harkis, plus ou moins bien intégrées à l’ensemble de la population.
Des essais aussi, comme celui de Abdelhamid Merad Boudia sur « L’économie algérienne de l’indépendance au hirak » dont le sous-titre suggère une problématique intéressante : « Entre capitalisme d’Etat et capitalisme de connivence » ; ou encore le passionnant « Barbès blues »de Hajer ben Boubaker, à la fois très vivant mais signe qu’un passé encore récent (dont une ou deux générations seulement nous séparent) est maintenant entré dans l’histoire.
Nombreuses sont les notes qui attirent brièvement l’attention sur divers faits d’actualité, qu’il s’agisse de festivals de cinéma comme celui de Fameck ou de Saint-Paul-Trois-Châteaux, d’un homme de théâtre à la brillante carrière comme Abdelwaheb Sefsaf, d’un restaurateur tunisien qui sait utiliser à bon escient son héritage culinaire ou des progrès de l’édition en tamazight en Algérie .
Des deux films évoqués dans cette Lettre, l’un est un retour en arrière, lié aux journées que Coup de soleil vient de consacrer aux Pieds noirs, c’est «De l’autre côté de la mer » de Dominique Cabrera ; tandis que l’autre de Mehdi Allaoui « Dans le sillage de Frantz Fanon » a accompagné les rencontres consacrées à cet auteur (principalement pour ses années de présence à Lyon).
Pour ce qui est de la BD, l’étonnement est d’y trouver Benjamin Stora, plus connu dans d’autres genres tels que l’essai historique, aux côtés de Nicola le Scanff : c’est, aux éditions de La Découverte « Les Algériens en France, une histoire de générations ».
Denise Brahimi

Peut-être souhaitez-vous faire un don à notre association, pour contribuer à notre fonctionnement? Et notamment au coût de réalisation de cette Lettre?
Vous en avez la possibilité en cliquant ICI. Merci d’avance!
Et si vous souhaitez nous faire le plaisir de nous rejoindre en adhérant, c’est LA!

 « Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).
« Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).
Hommage à une communauté en voie de disparition, il a pour objectif d’aider les pieds-noirs à transmettre. Il s’adresse à leurs descendants, aux enseignants qui souhaitent parler de la guerre d’Algérie, et plus largement à tous ceux qui s’intéressent aux exils et à la résilience. Il interroge l’exil comme acte fondateur ainsi que les questions d’identité, d’invisibilité et d’intégration. Il pose également la question de la transmission et de la mémoire des pieds-noirs.
Le projet a démarré en janvier 2022, année de commémoration du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.
Pour écouter les épisodes déjà parus : https://podcast.ausha.co/et-de-nous-qui-se-souviendra

“Le BASTION DES LARMES” par Abdellah Taïa, Julliard, 2024
Celui qui fut jadis ou naguère un jeune Marocain en exil à Paris y est maintenant devenu un écrivain reconnu et particulièrement apprécié semble-t-il pour son dernier et tout récent roman*. Les raisons pour lesquelles il a quitté le Maroc ne sont que trop claires et il n’a cessé de s’en expliquer : ouvertement homosexuel, il a subi dans son pays d’origine tant de mépris et d’humiliations que la situation était difficilement tenable. Et c’est encore de cela qu’il parle dans « Le Bastion des larmes » dont le personnage principal, Youssef, né à Salé en 1973, comporte une part d’autobiographie, aménagée comme c’est la coutume des romanciers. Youssef lui aussi finit par quitter Salé et vient vivre comme professeur à  Paris, cependant, ce dont parle « Le Bastion des larmes » avec de nombreux retours en arrière jusqu’à son enfance, est de la vie marocaine et non pas parisienne. Et dans cette vie marocaine, ce dont il est principalement question est l’homosexualité, qui semble être restée pour l’auteur une véritable obsession, mais si l’on peut dire une obsession volontaire car le livre qu’il veut écrire est pour une bonne part une dénonciation de ce qu’il en était au Maroc pendant l’enfance et l’adolescence de Youssef, sous le règne du Roi Hassan II. Comme il le dit lui-même à la fin du livre, il est impossible pour l’auteur de pardonner, jamais il n’oubliera (c’est évidemment impensable) ce que lui-même et ses semblables ont subi dans leur pays, au vu et au su de tout le monde, et sans que personne fasse la moindre tentative pour venir en aide aux victimes. Le rejet, les brimades, l’exclusion commencent au sein des familles ; dans le cas de Youssef, celle-ci comporte six filles, qui sont toutes des sœurs aînées, et deux autres garçons. Mis à part ses deux frères, qui d’une manière ou de l’autre sont absents de sa vie (le plus jeune, Karim, part en Suède dès qu’il le peut, définitivement et sans un adieu),Youssef ne trouve pas le moindre appui auprès de ses sœurs, bien au contraire. Et son sort ne fait que reproduire, avec quelques années d’écart, celui de son ami Najib, un peu plus âgé que lui, et qui fut le grand amour de sa vie jusqu’au moment où il a « trahi » leur amitié— c’est ainsi que Youssef ressent et exprime ce qui s’est passé.
Paris, cependant, ce dont parle « Le Bastion des larmes » avec de nombreux retours en arrière jusqu’à son enfance, est de la vie marocaine et non pas parisienne. Et dans cette vie marocaine, ce dont il est principalement question est l’homosexualité, qui semble être restée pour l’auteur une véritable obsession, mais si l’on peut dire une obsession volontaire car le livre qu’il veut écrire est pour une bonne part une dénonciation de ce qu’il en était au Maroc pendant l’enfance et l’adolescence de Youssef, sous le règne du Roi Hassan II. Comme il le dit lui-même à la fin du livre, il est impossible pour l’auteur de pardonner, jamais il n’oubliera (c’est évidemment impensable) ce que lui-même et ses semblables ont subi dans leur pays, au vu et au su de tout le monde, et sans que personne fasse la moindre tentative pour venir en aide aux victimes. Le rejet, les brimades, l’exclusion commencent au sein des familles ; dans le cas de Youssef, celle-ci comporte six filles, qui sont toutes des sœurs aînées, et deux autres garçons. Mis à part ses deux frères, qui d’une manière ou de l’autre sont absents de sa vie (le plus jeune, Karim, part en Suède dès qu’il le peut, définitivement et sans un adieu),Youssef ne trouve pas le moindre appui auprès de ses sœurs, bien au contraire. Et son sort ne fait que reproduire, avec quelques années d’écart, celui de son ami Najib, un peu plus âgé que lui, et qui fut le grand amour de sa vie jusqu’au moment où il a « trahi » leur amitié— c’est ainsi que Youssef ressent et exprime ce qui s’est passé.
Mais avant d’en arriver là, il faut s’arrêter à la relation si belle et si forte qui unit les deux garçons, et qui permet de comprendre l’un des deux aspects de l’homosexualité marocaine au sens où Abdallah Taïa en prend la défense et en fait l’apologie. L’amour que se portent Najib et Youssef est aussi mystique que physique, il est leur unique raison de vivre et trouve son expression dans la poésie arabe classique qui les éblouit ; sans doute faudrait-il aussi remonter à la Grèce antique, au siècle de Périclès, pour en trouver des équivalents. Et c’est cet amour-là que l’hétérosexualité dominante et triomphante dans le royaume d’Hassan pourfend avec férocité. Pourtant du côté de cette hétérosexualité apparente et proclamée, Taïa n’a aucun mal à faire apparaître, en soulevant le voile de l’hypocrisie, des pratiques d’autant plus odieuses qu’elles impliquent souvent la pédophilie et le viol de très jeunes enfants. Il en donne un exemple dans une scène de hammam où la victime est un garçon de huit ans, qu’un vieillard répugnant souille de ses attouchements, sous les yeux de tous ceux qui pourraient voir s’ils ne préféraient détourner les yeux. Youssef prend l’enfant avec lui pour le protéger mais il s’avère que sa mère, prostituée, est parfaitement au courant et ne voit aucun moyen d’épargner à son fils (qu’elle aime) ce qu’elle considère comme un inévitable apprentissage de la vie.
Pourtant du côté de cette hétérosexualité apparente et proclamée, Taïa n’a aucun mal à faire apparaître, en soulevant le voile de l’hypocrisie, des pratiques d’autant plus odieuses qu’elles impliquent souvent la pédophilie et le viol de très jeunes enfants. Il en donne un exemple dans une scène de hammam où la victime est un garçon de huit ans, qu’un vieillard répugnant souille de ses attouchements, sous les yeux de tous ceux qui pourraient voir s’ils ne préféraient détourner les yeux. Youssef prend l’enfant avec lui pour le protéger mais il s’avère que sa mère, prostituée, est parfaitement au courant et ne voit aucun moyen d’épargner à son fils (qu’elle aime) ce qu’elle considère comme un inévitable apprentissage de la vie.
Il ressort du livre de Taïa que l’homosexualité est omniprésente au Maroc, du moins dans le Maroc dont il parle et à cette époque, évoquée avec précision dans l’histoire de Najib et de sa « trahison » remarquablement analysée : âgé de 24 ans et sans la moindre perspective d’échapper à la plus extrême pauvreté, Najib devient l’amant d’un colonel de l’armée marocaine, Toufik, et part vivre avec lui dans le nord du pays près de Tétouan. Toufik est très riche parce que trafiquant de drogue à un niveau international, « et il faut dire qu’il n’était pas le seul dans l’armée marocaine ». A la mort de son protecteur, Najib comprend que celui-ci l’a utilisé plus qu’il ne l’a aimé mais il reconnaît aussi que la réciproque était vraie. Et pourtant ils ont vécu en couple pendant des années, sans qu’on puisse prétendre qu’il n’y avait pas entre eux des liens puissants. Plus tard Najib est revenu vivre à Salé, et grâce à tout son argent (il était trafiquant lui aussi), il est devenu le protecteur des pauvres dans son quartier—vénéré à ce titre et considéré par tous comme un véritable saint.
Youssef est revenu lui aussi pour régler des questions d’héritage familial, ce qui entraîne de sa part une sorte de réévaluation de ce qu’a été sa vie avant qu’il ne quitte Salé pour Paris. Ses sœurs ont beaucoup changé, elles expriment même du regret pour leur conduite d’autrefois. Youssef lui-même se rend compte qu’il a vécu dans cette famille des moments inoubliables, notamment parce que le partage du quotidien était aussi celui de rituels que rien, semble-t-il, ne peut remplacer désormais. Pour autant, il n’est pas question de pardonner mais de nuancer et de comprendre la complexité et l’ambiguïté de la vie qui est faite de contradictions. On peut aimer plus que tout ce qui vous a fait du mal, là est la tragédie—serait-ce celle de l’auteur ?
Denise Brahimi
*En ce mois d’octobre 2024, Abdellah Taïa vient de recevoir le Prix de la langue française
“COEUR D’AMANDE” par Yasmina Khadra, roman, éditeurs Mialet-Barrault, 2024
Contrairement à certains romans de cet auteur prolixe (il en a déjà écrit une trentaine), celui-ci ne prétend pas présenter dans une fiction un lieu et les problèmes tragiques qui s’y posent (Bagdad, Jérusalem, Kaboul etc.), il rejoint une autre lignée un peu plus autobiographique sans l’être complétement (telle qu’elle apparaît par exemple dans « L’écrivain »),et qui y ici concerne moins les faits que les pensées ou réflexions du personnage principal—les autres, pas tellement secondaires, ne se privant pas d’y ajouter les leurs. Le livre se présente donc comme un ensemble fourni et récurrent de sentences ou d’aphorismes qui expriment avec force des règles de conduite et même une vision de la vie en général, applicable à chaque vie en particulier ; on peut en donner un exemple qui semble être une véritable profession de foi de la part de Yasmina Khadra : « Si on arrive à se convaincre qu’on est l’être le plus précieux sur terre, qu’on est essentiel en toute circonstance, on supplantera à coup sûr ce qui nous réduit à nos blessures, à nos doutes et à nos angoisses (…)Il n’est pas de plus légitime ivresse que d’être épris de sa propre personne, et de plus heureuse transcendance que de se fiche éperdument de ce que  pensent de nous les autres. » Ces déclarations qui pourraient paraître outrecuidantes trouvent pourtant leur explication dans le roman, elles sont l’expression du dur combat qu’a dû mener leur auteur, Nestor Landiras, qui est un nain, abandonné dès la naissance par sa mère et socialement très marginal. Il ne doit qu’à un immense effort personnel la résilience dont ces propos font état. Et c’est en ce sens qu’il est digne d’admiration. Même lorsqu’il semble rejoindre, par la voix de son ami Léon, qui est gay, une pensée politiquement correcte, il faut voir que ses acolytes les plus habituels ont été élevés dans des préjugés inverses et ignorent tout de la revendication que leur oppose Léon : « Il n’y a rien de contre-nature en amour. Lorsque deux adultes sont consentants, ils emmerdent pape et consorts (…)Ce qui est contre-nature, ce sont les essais nucléaires, la déforestation, la pollution, la famine, les guerres. »
pensent de nous les autres. » Ces déclarations qui pourraient paraître outrecuidantes trouvent pourtant leur explication dans le roman, elles sont l’expression du dur combat qu’a dû mener leur auteur, Nestor Landiras, qui est un nain, abandonné dès la naissance par sa mère et socialement très marginal. Il ne doit qu’à un immense effort personnel la résilience dont ces propos font état. Et c’est en ce sens qu’il est digne d’admiration. Même lorsqu’il semble rejoindre, par la voix de son ami Léon, qui est gay, une pensée politiquement correcte, il faut voir que ses acolytes les plus habituels ont été élevés dans des préjugés inverses et ignorent tout de la revendication que leur oppose Léon : « Il n’y a rien de contre-nature en amour. Lorsque deux adultes sont consentants, ils emmerdent pape et consorts (…)Ce qui est contre-nature, ce sont les essais nucléaires, la déforestation, la pollution, la famine, les guerres. »
Cependant le livre est aussi un roman et les formules dont on vient de donner l’exemple s’accrochent à des situations qui sont parmi les plus connues ou les plus inévitables au cours de toute vie quelle qu’elle soit : le handicap, qui est une donnée incontournable pour Nestor et pour Léon, la mort des êtres proches qui pour Nestor est celle de Mamie, le seul être qu’il ait aimé d’amour, tandis que pour Léon c’est la mort accidentelle de ses parents jeunes et beaux dont il ne parviendra jamais à faire le deuil. Le handicap, la mort, l’acharnement du sort qui accable les plus faibles et les brimades en tout genre qu’ils reçoivent de la vie en société font partie des aspects négatifs de la vie que compensent à l’inverse des trésors qui n’ont pas de prix, et c’est bien le cas de le dire, car Nestor le pauvre et le démuni prouve en mainte occasion qu’il n’a que mépris pour l’argent. En revanche les deux immenses trésors qu’il prise par-dessus tout sont d’une part l’amitié et la solidarité agissante des copains qui surmontent ses rebuffades de nain parfois grincheux (oui, comme dans « Blanche-Neige ») et d’autre part l’écriture d’un livre qui va être la grande affaire de sa vie, car ce roman qui a la chance d’être publié est bientôt couronné d’un grand succès public, dont Nestor est absolument ravi, sans réserve et même sans tentative de tempérer sa joie par la modestie. Il faut encore ajouter, du côté positif de tout ce qui aide à supporter la vie et même à l’aimer, à savoir le rêve dont le roman jusqu’à sa dernière ligne célèbre la toute puissance comme Mamie le faisait déjà au temps où elle transmettait son savoir à Nestor. Le rêve a un pouvoir merveilleux parce qu’il est le lieu qui donne toute sa place à l’amour, si souvent contredit ou absent dans la réalité. Or le mot amour, même s’il n’est pas employé fréquemment dans le roman, en est pourtant le mot clef et c’est pourquoi il figure dès le titre sous la forme du mot cœur : Cœur-d’amande, transcription en français de ce qui se dit en arabe algérien Qalb Llouz, n’est pas là pour évoquer matériellement ce gâteau de semoule et de miel grand favori au temps du ramadan, il est là comme symbole de la douceur, de la tendresse et de tout ce qui fait du bien. Cette dernière expression, très simple, sert aussi à désigner toute une catégorie de romans aimés du public, littérature « feel-good » comme on dit en anglais. Le sentiment de bien-être que donnent de tels livres commencent par le fait qu’ils se lisent très facilement, et c’est incontestablement ce qui caractérise « Cœur d’amande », à ranger de ce fait dans la littérature populaire, dont Yasmina Khadra apparaît comme un maître. Nestor Landinas, nain et héros de « Cœur d’amande » n’est pas destiné à séduire des lecteurs élitistes, et son créateur a fait un autre choix : il assure son succès auprès d’un vaste public en reprenant un style qui a fait ses preuves aux beaux jours de Frédéric Dard, pour prendre un exemple aujourd’hui oublié mais célèbre en son temps. C’est une sorte de gouaille émaillée d’images drôles et crues, supposée propre à un milieu de marginaux, de truands peut-être, et l’on peut constater que Yasmina Khadra s‘y exerce dans ce roman non sans succès. Les dialogues, parfois sentencieux, sont aussi pleins de verve et d’invention langagière. L’auteur en s’engageant dans cette voie, confirme son goût déjà plusieurs fois manifesté pour une littérature dite populaire qui correspond sans doute à un certain besoin des lecteurs.
Il faut encore ajouter, du côté positif de tout ce qui aide à supporter la vie et même à l’aimer, à savoir le rêve dont le roman jusqu’à sa dernière ligne célèbre la toute puissance comme Mamie le faisait déjà au temps où elle transmettait son savoir à Nestor. Le rêve a un pouvoir merveilleux parce qu’il est le lieu qui donne toute sa place à l’amour, si souvent contredit ou absent dans la réalité. Or le mot amour, même s’il n’est pas employé fréquemment dans le roman, en est pourtant le mot clef et c’est pourquoi il figure dès le titre sous la forme du mot cœur : Cœur-d’amande, transcription en français de ce qui se dit en arabe algérien Qalb Llouz, n’est pas là pour évoquer matériellement ce gâteau de semoule et de miel grand favori au temps du ramadan, il est là comme symbole de la douceur, de la tendresse et de tout ce qui fait du bien. Cette dernière expression, très simple, sert aussi à désigner toute une catégorie de romans aimés du public, littérature « feel-good » comme on dit en anglais. Le sentiment de bien-être que donnent de tels livres commencent par le fait qu’ils se lisent très facilement, et c’est incontestablement ce qui caractérise « Cœur d’amande », à ranger de ce fait dans la littérature populaire, dont Yasmina Khadra apparaît comme un maître. Nestor Landinas, nain et héros de « Cœur d’amande » n’est pas destiné à séduire des lecteurs élitistes, et son créateur a fait un autre choix : il assure son succès auprès d’un vaste public en reprenant un style qui a fait ses preuves aux beaux jours de Frédéric Dard, pour prendre un exemple aujourd’hui oublié mais célèbre en son temps. C’est une sorte de gouaille émaillée d’images drôles et crues, supposée propre à un milieu de marginaux, de truands peut-être, et l’on peut constater que Yasmina Khadra s‘y exerce dans ce roman non sans succès. Les dialogues, parfois sentencieux, sont aussi pleins de verve et d’invention langagière. L’auteur en s’engageant dans cette voie, confirme son goût déjà plusieurs fois manifesté pour une littérature dite populaire qui correspond sans doute à un certain besoin des lecteurs.
Denise Brahimi
“L’AGRAFE” par Maryline Desbiolles, roman, Sabine Wespieser éditeur, 2024
Maryline Desbiolles est devenue une écrivaine connue grâce à son livre de 2023 qui raconte une des premières grèves de femmes , autour de l’année 1868, et comme il s’agit de jeunes ouvrières travaillant dans la soierie lyonnaise, Coup de soleil au pays des canuts ne peut que se sentir concerné. « L’agrafe » en revanche nous rapproche du pays niçois, où vit actuellement la romancière. Et il s’agit d’une histoire beaucoup plus récente, à dire vrai très actuelle puisqu’au cœur du récit ou plutôt à l’arrière-plan de celui-ci il y a le racisme anti-arabe se rattachant à des souvenirs de la Guerre d’Algérie, même s’il ne s’agit là que de circonstances ponctuelles, s’inscrivant dans un contexte plus vaste et notamment dans une attitude très actuelle de rejet de l’immigration. Cependant la romancière n’a pas voulu que son histoire soit enfermée dans un cadre idéologique et politique, voire historique, elle a centrée le récit sur son héroïne féminine, Emma Fulconis, et l’on peut en effet employer le mot « héroïne » au sens plein du mot car cette jeune personne est pourvue dès l’enfance d’une présence étonnante, ou même d’une omniprésence due à sa caractéristique essentielle qui est une manière de virevolter et d’être comme le vent partout à la fois. Elle aime courir et le fait constamment, c’est une athlète déjà et sans doute une championne en puissance jusqu’au jour où…se produit un effroyable accident, la morsure d’un molosse puissant qui lui fait perdre l’usage d’une de ses jambes : qu’adviendra-t-il désormais de ce qu’elle était, le feu follet virevoltant ?
Cependant la romancière n’a pas voulu que son histoire soit enfermée dans un cadre idéologique et politique, voire historique, elle a centrée le récit sur son héroïne féminine, Emma Fulconis, et l’on peut en effet employer le mot « héroïne » au sens plein du mot car cette jeune personne est pourvue dès l’enfance d’une présence étonnante, ou même d’une omniprésence due à sa caractéristique essentielle qui est une manière de virevolter et d’être comme le vent partout à la fois. Elle aime courir et le fait constamment, c’est une athlète déjà et sans doute une championne en puissance jusqu’au jour où…se produit un effroyable accident, la morsure d’un molosse puissant qui lui fait perdre l’usage d’une de ses jambes : qu’adviendra-t-il désormais de ce qu’elle était, le feu follet virevoltant ?
En pensant à son roman précédent dont les héroïnes sont quatre jeunes ouvrières venues travailler à Lyon au temps des canuts, on se dit que Maryline Desbiolles éprouve une véritable empathie pour les jeunes créatures féminines pleines de vie que les avatars auxquelles elles sont soumises vont briser dans leur élan. Il y a donc deux fils conducteurs qui s’emmêlent dans « L’agrafe », l’un qui est à peine dit et tient en une phrase mais qui pourtant irradie dans tout le récit en l’imprégnant d’une sensation d’effroi : « Mon chien n’aime pas les Arabes », a dit le propriétaire de celui qui a massacré la jambe d’Emma. Et l’autre fil se déroule selon ce qu’il en sera dans la suite de la résilience d’Emma, de sa manière de survivre quoi qu’il en soit.
Compte tenu de la durée des soins très lourds qu’elle a dû subir, sa tentative de retour à la vie ne se fait que près d’un an après l’agression par le chien. Elle retrouve alors un oncle, Akim venu de Kabylie en 1962, et qui de ce fait est du groupe qu’on appelle harkis. Il y en avait justement un camp tout près de Nice, là où se passent les événements racontés dans le récit. Et c’est l’occasion pour la romancière d’évoquer la vie des harkis qu’Emma elle-même a connue lorsqu’elle a partagé quelque temps le groupe familial, en remontant jusqu’à ses grands parents—ceux par lesquels elle se trouve apparentée au groupe des Arabes comme disait le maître du molosse, pour stigmatiser collectivement les habitants du camp.
Certes il y aura plus tard, et la romancière nous fait y assister, des tentatives officielles pour réhabiliter la population des harkis si malmenés pendant tout ce temps qu’on leur a fait passer dans les camps. Mais ni Akim ni Emma ne sont prêts à collaborer avec les administrations diverses qui déploient de tels efforts de réconciliation ; et leurs corps même—c’est particulièrement évident dans le cas d’Emma—se refusent à cette volonté d’oubli. Cependant Emma est capable de réinventer autrement ce qu’elle a pourtant irrémédiablement perdu. Ce sont les tâtonnements de cette quête et de cette reconstruction d’elle-même que le texte se met à mimer lorsqu’il procède par courts fragments, comme autant de pistes esquissées, peut-être même suivies mais pas durablement. Une voie pourtant sera la bonne pour Emma une fois qu’instinctivement elle l’aura trouvée. Elle passe par le chant et la danse, de manière très intime, sans impliquer d’abord nul autre qu’elle-même. Il lui fallait en effet, sans que rien ni personne puisse le faire à sa place, retrouver sa mobilité.
Cependant Emma est capable de réinventer autrement ce qu’elle a pourtant irrémédiablement perdu. Ce sont les tâtonnements de cette quête et de cette reconstruction d’elle-même que le texte se met à mimer lorsqu’il procède par courts fragments, comme autant de pistes esquissées, peut-être même suivies mais pas durablement. Une voie pourtant sera la bonne pour Emma une fois qu’instinctivement elle l’aura trouvée. Elle passe par le chant et la danse, de manière très intime, sans impliquer d’abord nul autre qu’elle-même. Il lui fallait en effet, sans que rien ni personne puisse le faire à sa place, retrouver sa mobilité.
A défaut de pouvoir courir, elle invente des chansons qui la font danser et cette danse est sa nouvelle façon d’être « transportée par le vent », comme l’affirment les derniers mots du livre.
Grâce à la danse, elle trouve le moyen et l’énergie de rejoindre la ville de Lyon dont elle fait l’éloge pour finir, rejoignant par là son précédent roman. Le Rhône est pour elle le symbole du flux et du mouvement, et c’est celui-ci qui l’emporte dans son livre, contre toutes les immobilisations auxquelles elle refuse de se laisser condamner. Lorsqu’elle a vingt ans et le bac, Emma quitte tout ce qui serait pour elle un risque ou même une certitude d’enfermement—n’importe qu’on l’accuse de trahir les siens. Ce départ, avec les ruptures qu’il implique, est la condition de son renouveau.
Denise Brahimi
« L’ECONOMIE ALGERIENNE DE L’INDEPENDANCE AU HIRAK » de Abdelhamid Merad Boudia 2023 Editions Campus Ouvert Grenoble
Ambitieuse entreprise que celle à laquelle s’est attelé Abdelhamid Merad Boudia, professeur d’Université qui a exercé successivement à l’Université de Constantine, puis à celle d’Alger et enfin à celle de Grenoble-Alpes. Et voici un nouvel ouvrage bien intéressant à mettre à l’actif de la maison d’édition Campus Ouvert dont nous avons fait auparavant la chronique de plusieurs autres livres.
Le survol des différentes phases traversées par l’économie algérienne sur près de 60 ans est fait de manière très documentée, associant analyse des éléments statistiques et factuels et synthèse pour donner un sens à l’ensemble. L’auteur découpe en cinq périodes cette description de l’évolution de l’économie algérienne, périodes qui correspondent à des étapes politiques qui ont ponctué l’histoire de ce pays depuis son indépendance.
Pour clarifier les enjeux que doit affronter le nouveau régime pour bâtir une économie nouvelle, l’auteur se livre à une synthèse très claire de ce qu’a été l’économie coloniale. Principalement agricole, avec une prédominance de la viticulture dont les exploitations sont pour plus de la moitié concentrées entre les mains de grands propriétaires (1/4 des exploitants possèdent 87 % des terres), elle n’a connu un début de diversification qu’à la toute fin de la période, avec le Plan de Constantine de 1958. La paysannerie algérienne pratique une économie de subsistance sur des terres pauvres et des exploitations trop petites, dépourvues de toute mécanisation. Le chômage et la misère sont élevés, provoquant la migration vers les villes, et l’émigration. L’économie coloniale était fondée sur l’exclusivité des exportations vers la Métropole, et la quasi exclusivité des importations.
C’est donc à une transformation radicale de la structure économique nationale que doivent se consacrer les nouveaux dirigeants. L’auteur construit son historique de l’économie algérienne en cinq périodes, qui sont autant d’étapes où alternent les inspirations organisant l’économie et les aléas des marchés pétroliers qui obligent le pays à des voltes-faces successives. Étapes également marquées par des transitions politiques plus ou moins violentes.
L’auteur construit son historique de l’économie algérienne en cinq périodes, qui sont autant d’étapes où alternent les inspirations organisant l’économie et les aléas des marchés pétroliers qui obligent le pays à des voltes-faces successives. Étapes également marquées par des transitions politiques plus ou moins violentes.
La première période, 1962/1965 est intitulée par l’auteur « Path dependency ». Elle voit l’Algérie, une fois Ahmed Ben Bella au pouvoir mettre en place dans un laps de temps très court les instrument nouveaux d’une gouvernance souveraine de l’économie. Création de l’institut d’émission, la Banque Centrale de l’Algérie, institution de la devise nationale, le dinar algérien, définie non par rapport au franc mais par rapport à un poids d’or. La création de multiples organes de gestion de l’économie défile à une cadence impressionnante, la caisse algérienne de développement, la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance, puis au début de la période suivante, la création de trois banques nationales consécutive à la nationalisation des banques privées étrangères. La SONATRACH est créée en 1963, avec pour premier chantier la construction de l’oléoduc stratégique Haoud el Hamra/Arzew. Ce premier acte vers la souveraineté sur la ressource pétrolière est suivi de nombreux autres, fondateurs pour l’établissement de l’indépendance économique de l’Algérie, touchant notamment le secteur minier, les entreprises industrielles… A côté de ces secteurs stratégiques, l’Algérie prend possession des terres délaissées par les colons européens, 2,4 millions d’hectares de bonnes terres, ainsi que des petites industries, dont la mise en valeur va s’appuyer dans un premier temps sur un système autogestionnaire. Du reste la première opposition va voir le jour entre ce choix innovant de l’autogestion (« idée-force mobilisatrice », « modernisation par le bas »), et une bureaucratie naissante, aux options centralisatrices « modernisation par le haut », ou, dans le domaine agricole, les régions où prédomine une petite paysannerie indépendante, lui préférant une redistribution des terres. En termes de résultats, cette première et courte période de l’Algérie indépendante rencontre peu de succès, à l’exception du secteur des hydrocarbures. Pénurie de cadres et de techniciens, héritage peu glorieux de la colonisation, crise des débouchés et des productions agricoles, chute des investissements et baisse des productions industrielles, dépendance de la France pour les débouchés. L’enthousiasme des premières années permet d’éviter la catastrophe, avec des récoltes agraires exceptionnelles en 1962 et 1963, des rentrées scolaires assurées, grâce à l’appui des coopérants étrangers, notamment français… En peu de temps des centaines de milliers d’emplois sont créés, préfigurant la constitution d’une nouvelle élite nationale.
Avec le renversement de Ben Bella par Houari Boumediene en 1965 s’ouvre une nouvelle période de l’histoire tout court et de l’histoire économique en particulier qui va jusqu’en 1978, date de la mort du Président Boumediene. L’auteur l’intitule « Accumulation étatiste et capitalisme d’État ». 1966 voit définie une Stratégie de développement global à long terme, à l’horizon 1980. Une planification est mise en place avec l’appui de différents pays, se traduisant par 3 plans successifs, 1967/69, 1970/73 et 1974/77). Un investissement public industriel massif caractérise cette période, au détriment de l’agriculture et des infrastructures sociales. Le secteur des hydrocarbures en est le principal bénéficiaire, suivi par celui des biens intermédiaires (sidérurgie, cimenteries, énergie…). C’est le triomphe du modèle des « industries industrialisantes », prôné par le professeur grenoblois Destanne de Bernis ; visant à sortir des conséquences de la domination coloniale en construisant une structure industrielle cohérente. Le résultat en terme de création d’emplois est spectaculaire, le chômage tombant de 25 à 19 % sur la période, pourtant marquée par un accroissement de la population active. La déception vient d’une régression de l’efficacité du capital massif investi, d’une chute de la productivité par travailleur, d’une faible montée en production. Les responsables politiques invoquent les difficultés à « piloter la machinerie humaine », l’auteur ajoutant les conditions de vie difficiles des travailleurs, et une bipolarisation aux extrêmes, nombreux ouvriers sans qualification à la base, gonflement d’un encadrement moyen et supérieur sans expérience industrielle ni tradition ouvrière. De plus, cet effort de financement considérable repose principalement sur un recours massif à la dette extérieure, avec surtout un ratio du service de la dette en constante augmentation, ce qui ne manquera pas de soumettre le pays à une situation explosive dans la période suivante.
Le portage de ce modèle doit beaucoup à un groupe de responsables que l’auteur appelle les « Industrialistes », mais avec un système de tutelle administrative des industries d’État par les différents ministères, « la prépondérance des instances de programmation sectorielle et la faiblesse des instances horizontales de coordination ». Ceci se traduit par des rivalités au sein de la technobureaucratie algérienne, représentée par l’auteur en trois blocs, la haute hiérarchie militaire, la technocratie illustrée notamment par Belaïd Abdesslam, et la haute bureaucratie administrative et politique.
Ajoutons tout de même dans cette période la création d’un secteur industriel privé, dans les transports, le BTP, les plastiques, l’agriculture, totalisant 30 % de la valeur ajoutée globale en 1980. Notons que nombre des ces investisseurs sont des cadres de l’État,du FLN, de l’armée : « La bourgeoisie algérienne est née des entrailles de l’État socialiste et de l’économie administrée ». Celle ci devient « un centre de formation (dans tous les sens du terme) des capitalistes privés ». Notons aussi la place importante prise paradoxalement par la finance et les firmes occidentales, en terme de récolte de marchés directs, mais aussi d’influence sur les décisions… L’auteur note enfin que le procès de travail au sein des entreprises nationales s’inspire de celui des firmes capitalistes, séparant travail manuel et intellectuel, avec un système hiérarchique affirmé.
Le décès prématuré du Président Boumediene en 1978 fait entrer l’Algérie dans une troisième période (1979/1988) qui va prendre dans bien des cas le contre-pied de la période précédente. Une Synthèse de bilan économique et social de la décennie 1967/1978 élaborée par des cadres du Ministère du Plan et de l’aménagement du territoire sert de base au 4ème congrès extraordinaire du FLN en 1980 et inspire le projet de plan quinquennal 1980/85. Le contexte de son élaboration est celui d’une forte hausse du prix des hydrocarbures…qui sera suivie quelques années plus tard d’un dégringolade de ces même prix. La stratégie retenue est quelque peu malthusienne, restreignant les quantités exportées en recherchant le meilleur prix. De grands projets sont abandonnés, à la faveur d’une baisse du taux d’investissement et la réorientation de son utilisation vers l’agriculture, l’hydraulique et les infrastructures. Ceci se traduit par une diminution de la création d’emplois, que la chute des recettes d’exportation d’hydrocarbures va accentuer. Dans le même temps, le gouvernement opère une restructuration des grandes entreprises nationales, produisant une forme d’atomisation du secteur public. Le pouvoir de l ‘administration centrale se renforce, tandis que les compétences gestionnaires se dispersent, et que l’éclatement du monopole du commerce extérieur affaiblit le pouvoir de négociation sur les marchés extérieurs. La restructuration financière tourne court, sur 400 entreprises étatiques, 70 seulement ont un budget équilibré. Nouvelle priorité, le secteur agricole voit restructurée l’affectation des terres. Une Banque de l’agriculture et du développement rural est créée. Les capitaux étrangers sont sollicités à investir.
Pour « faire passer » ces mesures, un plan anti pénurie ouvre l’importation de petits matériels, électro ménager…, et une loi permet la cession de bien immobiliers d’État à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal.
Ces orientations nouvelles vont être confrontées à une crise importante, la chute des recettes d’exportation des hydrocarbures, de plus de 40 % (95 % des recettes en devises!). Dans le même temps, le poids du service de la dette s’accroît, même si l’Algérie n’est considérée que comme modérément endettée. Le ratio du service de la dette sur les recettes d’exportation dépasse 80 % en 1993, trois fois plus que le seuil de gravité de ce ratio, retenu internationalement. La baisse des importations rendue indispensable pour honorer les échéances assèche les capacités productives de l’industrie, et font régresser en conséquence les créations d’emplois…
La fin de cette période est marquée par les grandes manifestations de 1988. L’appel au président Boudiaf amène aux commandes du gouvernement M. S A Ghozali , puis après l’assassinat du Président en 1992, M. B Abdesselam.
La baisse des importations se poursuit, dans un contexte d’une nouvelle baisse des prix des hydrocarbures, le ratio de remboursement de la dette atteint 86 %. Le gouvernement Abdesselam chute, remplacé par celui de M. Reda Malek. L’Algérie est désormais contrainte d’en passer par un Plan d’ajustement structurel sous contrôle du FMI, humiliant pour ce pays qui a placé sa souveraineté et son indépendance au sommet de ses principes directeurs. L’approche libérale du FMI est bien connue, priorité au marché, libéralisation, suppression des secteurs subventionnés… L’impact sur les ratios indiquant une maîtrise des grands équilibres apparaît rapidement : le ratio service de la dette est ramené à 29,8 % en 1997, les réserves de change dépassent 8 milliards de $ dans le même temps. L’inflation retombe, le déficit budgétaire retombe à moins de 1 %.
La restructuration des outils de gestion fait en parallèle disparaître les prix subventionnés, favorise la privatisation. L’Algérie demande son adhésion à l’OMC, ouvre des négociations avec l’Union Européenne pour un accord bilatéral de libre-échange…
Mais structurellement, cette période ne change rien aux fondamentaux : une croissance tirée par le secteur des hydrocarbures, et l’agriculture(en 1995 et 1996) mais une baisse du reste de l’économie. Le rééchelonnement de la dette provoque un accroissement des importations, et le renforcement d’une « bougeoisie compradore . Ce que l’auteur qualifie d’ajustement par le bas, reprenant en cela les critiques néo-structuralistes sur ces politiques du FMI.
Curieusement, cependant, M. Merad Boudia s’en tient pour cette décennie à une analyse exclusivement économique, alors que les Algériens ont eu à vivre des événements autrement tragiques. Qui ont peut-être aussi un effet sur l’économie ?
Advient alors une cinquième période 1999/2019, qui se conclut par le Hirak, et voit se dérouler les 4 mandats du président Abdelaziz Bouteflika. Intitulée par l’auteur « Un capitalisme de connivence ».
Elle est rythmée comme les autres par une alternance de prix hauts des hydrocarbures jusqu’en 2014, puis une chute de 60 % de ces prix.
L’épisode de prix élevés est mise à profit pour rétablir une situation sociale stable, avec une Réconciliation nationale. Et concomitamment d’allouer la nouvelle manne pétro-gazière à la réduction de la dette extérieure, et à la multiplication par quatre des importations. Ce qui favorise un lobby pro-importation dissuadant l’émergence d’une économie productive locale. Le gouvernement se livre aussi à un ambitieux plan d’investissements en infrastructures, à la création de nombreux emplois, à de conséquentes augmentations de salaires, à la réduction des personnes vivant sous le seuil de pauvreté.
Conséquence collatérale, on assiste plus que jamais à l’émergence d’une oligarchie en collusion étroite avec le Pouvoir, ce capitalisme de connivence que dénonce l’auteur. La période sera ponctuée de nombreux scandales (Khalifa, affaire BRC, Sonatrach 1, 2, 3, 4…).
Malgré ses succès ce système entre en crise après 2014, avec une nouvelle chute des prix du pétrole. La crise est temporairement contrôlée en puisant dans le bas de laine constitué dans la période antérieure. Dès qu’un responsable envisage de réformer un tant soit peu le système, il est rapidement limogé, comme le premier ministre Tebboune en 2017, ce qui ne nuira pas à la suite de sa carrière… L’opinion est depuis longtemps en surchauffe avec de multiples manifestations. Quand les dirigeants décident de présenter A Bouteflika pour un cinquième mandat, en présentant le portrait d’un président qu’on n’a plus entendu s’exprimer depuis son accident cérébral , on entre dans cette étonnante période du hirak, où tout un peuple fait la leçon à ses dirigeants, en évitant tous les pièges de la violence et des provocations.
L’ouvrage s’achève sur cet épisode que l’auteur qualifie de « convergence de tous les segments de la société qui fait communauté nationale, la renforce et l’enrichit d’une modernité inédite ».
Il est difficile de commenter un tel ouvrage sans risque de paraphrase. Le lecteur sort éclairé de sa lecture, le survol presque exclusivement consacré à l’économie algérienne permet de mieux s’approprier une réalité complexe, faite d’ambition et d’innovation, mais aussi d’erreurs de choix, et de détournements multiples. Puisse t il inspirer une nouvelle approche, mieux inspirée, et bénéfique pour ce pays, notamment avec la dernière phrase de sa conclusion : L’Algérie est naturellement belle…Dieu est beau et aime la beauté ».
Michel Wilson.
“BARBES BLUES” par Hajer Ben Boubaker, éditions du Seuil, 2024
Ce récit multiple, de forme atypique, est l’œuvre d’une historienne indépendante qui brasse une masse considérable d’informations, mais à sa manière qui ne s’inspire pas du modèle universitaire habituel. Son sous-titre : « Une histoire populaire de l’immigration maghrébine » revendique certes l’apport historique qui en effet se déroule en 5 chapitres selon l’ordre chronologique en commençant avant la première guerre mondiale pour nous conduire jusqu’aux années-sida, c’est-à-dire aux deux dernières décennies du 20e siècle. Mais le récit est loin d’être linéaire, il est sans doute trop foisonnant pour cela, porté par l’enthousiasme de l’auteure pour un sujet qui lui tient à cœur et par le choix non dissimulé de ses partis-pris : cette histoire populaire est celle des mouvements d’émancipation à l’égard du colonialisme aussi longtemps que les pays du Maghreb n’ont pas été indépendants, et celle des réactions de la population immigrée à un racisme parfois virulent, en tout cas omniprésent ; c’est dire que l’auteure est amenée mainte fois à faire  le récit d’émeutes et bien évidemment celui de la répression policière qu’elles ont suscitée ; c’est particulièrement vrai au moment de la guerre d’Algérie, transposée en France avec d’autres formes d’action : si histoire il y a, elle est tout sauf un long fleuve tranquille et l’on a plusieurs fois l’impression que Hajer Ben Boubaker a participé elle-même aux événements qu’elle raconte, avec une sorte d’ardeur qui continue à l’animer.
le récit d’émeutes et bien évidemment celui de la répression policière qu’elles ont suscitée ; c’est particulièrement vrai au moment de la guerre d’Algérie, transposée en France avec d’autres formes d’action : si histoire il y a, elle est tout sauf un long fleuve tranquille et l’on a plusieurs fois l’impression que Hajer Ben Boubaker a participé elle-même aux événements qu’elle raconte, avec une sorte d’ardeur qui continue à l’animer.
Cependant il serait faux de considérer que cette histoire est essentiellement celle des actes de résistance opposés par les Maghrébins de Paris à l’oppression de l’Etat français. En fait, c’est bien davantage une présentation très animée de la vie quotidienne menée dans certains quartiers situés au nord et nord-est de la capitale, tels que Barbès dont il est question dans le titre et plus spécialement la Goutte d’or, dans le 18e arrondissement, tout près de la butte Montmartre, haut lieu de l’immigration maghrébine (c’est là que l’auteure elle-même a grandi).
Cette spécialisation n’empêche pas la population d’être variée. Peut-être parce que sa famille est d’origine tunisienne, Hajer Ben Boubekeur connaît particulièrement cette composante du quartier, elle insiste sur l’importance qu’y prennent notamment les Juifs tunisiens, et rappelle qu’en effet ils sont à l’origine de cette institution célèbre qui pendant des années, de 1945 aux années 1980, a connu le plus grand succès : le ou les magasins Tati qui ont pratiquement assuré le monopole du commerce dans les milieux de l’immigration, notamment pour les articles textiles, vendus à très bas prix.
Côté algérien, nombreux sont les Kabyles et notamment dans l’un des domaines auquel Hajer Ben Boubaker s’intéresse avec prédilection, à savoir la musique. Dans un quartier comme Barbès, celle-ci est l’art populaire par excellence et culmine dans la chanson. Le livre de Hadjer Ben Boubekeur fait défiler un certain nombre de chanteurs adulés du public, il y est aussi question de la manière dont leurs œuvres ont été diffusées et par exemple du rôle joué par certains disquaires. Ceux-ci rejoignent l’intense activité commerciale qui caractérise ces quartiers. De manière non systématique mais très efficace, l’auteure du livre fait défiler tout ce qui y compose le tissu de la vie quotidienne, le chapardage qui est quasi systémique, le racolage qui ne l’est pas moins et au sein duquel elle met en valeur la personnalité très affirmée d’un certain nombre de prostituées—d’autant qu’elles ont parfois laissé leur trace sous la forme de récits écrits. L’époque couverte par « Barbès blues » ne va pas jusqu’aux années contemporaines et l’on croit comprendre qu’il y a à cela plusieurs raisons. La plus tragique et désolante est l’usage de la drogue, la très redoutable héroïne qui a décimé en partie la population. En tout cas, ce n’est pas pour rien que le livre s’intitule « Barbès blues » : le mot « blues » comporte une part de regret et de nostalgie pour des formes de vie qui ne sont plus ce qu’elles étaient. Venu de la population afro-américaine des Etats-unis, le blues pourrait être lié aussi dans la musique de l’immigration maghrébine à un sentiment de ségrégation sociale, mais il semble qu’Hajer Ben Boubaker fait surtout du mot un usage personnel, pour dire ses propres sentiments. Elle a aimé d’amour ces quartiers dont elle parle, elle n’y trouve plus ce qu’elle y trouvait. Son livre comporte une évocation des meilleurs moments, c’est pourquoi il n’est pas misérabiliste ni chargé d’amertume et de revendication. C’est aussi une très belle histoire sans que pour autant soit oublié ni oubliable le racisme qui lui est consubstantiel. Sa participation affective à ce qu’elle évoque n’est pas une idéalisation, les mouvements anticolonialistes et indépendantistes ont toute son adhésion sans que pour autant elle héroïse les personnages qui en sont les acteurs. Le plaisir que donne son livre vient du fait qu’il est un mélange où l’on trouve à la fois des anecdotes, presque des faits divers et des regards avertis sur une histoire encore récente, qu’elle nourrit de précieux renseignements. On y trouve évoqués des faits comme la création de la grande Mosquée de Paris et son inauguration en 1926 ou des épisodes comme les tentatives (inabouties) de rapprochement entre la gauche française, ici les « Maos », avec les milieux de l’immigration. On est au cœur de l’Histoire en train de se faire, dans sa chair dirait-on.Denise Brahimi
De manière non systématique mais très efficace, l’auteure du livre fait défiler tout ce qui y compose le tissu de la vie quotidienne, le chapardage qui est quasi systémique, le racolage qui ne l’est pas moins et au sein duquel elle met en valeur la personnalité très affirmée d’un certain nombre de prostituées—d’autant qu’elles ont parfois laissé leur trace sous la forme de récits écrits. L’époque couverte par « Barbès blues » ne va pas jusqu’aux années contemporaines et l’on croit comprendre qu’il y a à cela plusieurs raisons. La plus tragique et désolante est l’usage de la drogue, la très redoutable héroïne qui a décimé en partie la population. En tout cas, ce n’est pas pour rien que le livre s’intitule « Barbès blues » : le mot « blues » comporte une part de regret et de nostalgie pour des formes de vie qui ne sont plus ce qu’elles étaient. Venu de la population afro-américaine des Etats-unis, le blues pourrait être lié aussi dans la musique de l’immigration maghrébine à un sentiment de ségrégation sociale, mais il semble qu’Hajer Ben Boubaker fait surtout du mot un usage personnel, pour dire ses propres sentiments. Elle a aimé d’amour ces quartiers dont elle parle, elle n’y trouve plus ce qu’elle y trouvait. Son livre comporte une évocation des meilleurs moments, c’est pourquoi il n’est pas misérabiliste ni chargé d’amertume et de revendication. C’est aussi une très belle histoire sans que pour autant soit oublié ni oubliable le racisme qui lui est consubstantiel. Sa participation affective à ce qu’elle évoque n’est pas une idéalisation, les mouvements anticolonialistes et indépendantistes ont toute son adhésion sans que pour autant elle héroïse les personnages qui en sont les acteurs. Le plaisir que donne son livre vient du fait qu’il est un mélange où l’on trouve à la fois des anecdotes, presque des faits divers et des regards avertis sur une histoire encore récente, qu’elle nourrit de précieux renseignements. On y trouve évoqués des faits comme la création de la grande Mosquée de Paris et son inauguration en 1926 ou des épisodes comme les tentatives (inabouties) de rapprochement entre la gauche française, ici les « Maos », avec les milieux de l’immigration. On est au cœur de l’Histoire en train de se faire, dans sa chair dirait-on.Denise Brahimi
« LES ALGERIENS EN FRANCE Une histoire de générations » de Benjamin Stora et Nicolas Le Scanff La découverte 2024
Après leur « Histoire dessinée des juifs d’Algérie »(2021), déjà commentée dans notre lettre 68 l’historien et le dessinateur se retrouvent pour une autre œuvre ambitieuse : survoler plus d’un siècle de présence algérienne en France. Pourtant, comme le souligne l’historienne Naima Huber Yahi, qui préface l’ouvrage, à l’heure où certains responsables politiques remettent en cause l’appartenance de ces millions de Français d’origine algérienne à la communauté nationale en parlant de « Français de papier », seule une absence de reconnaissance et de transmission peut permettre ce déni. Voilà un défi relevé, auquel contribue cet album. C’est par les luttes sociales que le livre entre dans le sujet. Trois participants de la Marche pour l’Egalité, Samia, de SOS Minguettes, Farid et Rachid sont interrogés sur Radio Beur sur l’itinéraire de leurs parents.
C’est par les luttes sociales que le livre entre dans le sujet. Trois participants de la Marche pour l’Egalité, Samia, de SOS Minguettes, Farid et Rachid sont interrogés sur Radio Beur sur l’itinéraire de leurs parents.
Puis on suit ces personnages jusqu’à aujourd’hui.
Dès lors, ces récits de vie permettent d’explorer les lieux, les événements petits ou grands qui jalonnent ces parcours d’immigration. Chaque épisode de ces aventures est expliqué par une double page évoquant certains lieux emblématiques de la migration, ou certains personnages qui ont compté dans cette histoire . Le port de Marseille, la Kabylie, les cafés-hôtels, la Grande Mosquée de Paris, la manifestation du 14 juillet 1953 déjà durement réprimée (7 morts, 50 blessés), la place de l’Etoile en fête après la victoire de la coupe du Monde de football en 1998 ; la commémoration du 17 octobre 1961, en 2021 au Pont de Bezons par le Président de la République…
D’autres grandes pages viennent apporter des explications sur des personnages ou des faits politiques, Messali Hadj, les militants nationalistes algériens et les militants français qui les soutiennent pendant l’entre deux guerres, puis les soutiens pendant la guerre d’Algérie d’intellectuels français, et quelques figures du FLN en France, les 30 glorieuses, 1973 l’année sanglante… Figurent aussi la mort de Khaled Kelkal, les émeutes après la mort de Zied et Bouna…
Figurent aussi la mort de Khaled Kelkal, les émeutes après la mort de Zied et Bouna…
Mentionnons la mise en valeur de la création du Bondy blog après les émeutes de 2005…
Au fil de l’album, les parcours des 3 amis et leur récit familial permet de traverser tous ces moments clés de l’immigration algérienne, et en même temps, au-delà de cette grande histoire, se dessinent les portraits de vrais personnages dont on s’attache à suivre la vie.
Farid raconte le parcours de son père, venu de Kabylie, avec son ami Abdel, d’abord à Alger en 1926, puis à Hispano Suiza à Bois-Colombes. Ils sont syndicalistes, militants messalistes. Au cours d’un repas des 3 amis chez le père de Farid, on découvrira que son ami Abdel a été abattu comme membre du MNA avec la complicité du père de Rachid, membre du FLN. Farid deviendra journaliste, d’abord dans des radios locales, puis à l’AFP.
Rachid est de Marseille, où ses parents sont implantés de longue date, le grand-père tenant un café dans le quartier de Noailles où son père est venu courtiser sa mère. Celle-ci fera de la prison aux Baumettes où elle sera maltraitée pour son militantisme FLN. Le père, d’abord ouvrier dans les raffineries de l’Etang de Berre, en est licencié, mais est aidé par son syndicat pour devenir taxi, un vrai Marseillais. Rachid fait du foot au club des Caillols, et est bien entendu un fervent supporter de l’OM. Il quittera Marseille, fera son droit à Paris, et devient avocat. Ce qui l’amènera à défendre les jeunes manifestants de 2005, amis d’Abdel, le fils de Farid, qui porte le nom de l’ami de son père.
 Samia est née à Vénissieux. Amir, son père est arrivé d’Algérie en 1947, il a épousé la mère de Samia en 1956, qui est venue le rejoindre à Lyon. D’abord logés dans une seule pièce, ils obtiennent l’appartement HLM rêvé en 1965. Amir est ouvrier à la SNCF, militant syndicaliste actif, devenu un de ces chibani comme le portrait mural leur rendant hommage à Malakoff au travers du visage de Mohand Dendoune, ancien cheminot algérien. Samia fait des études de médecine, s’engage au Parti Socialiste en 1988. Elle épouse Vincent.
Samia est née à Vénissieux. Amir, son père est arrivé d’Algérie en 1947, il a épousé la mère de Samia en 1956, qui est venue le rejoindre à Lyon. D’abord logés dans une seule pièce, ils obtiennent l’appartement HLM rêvé en 1965. Amir est ouvrier à la SNCF, militant syndicaliste actif, devenu un de ces chibani comme le portrait mural leur rendant hommage à Malakoff au travers du visage de Mohand Dendoune, ancien cheminot algérien. Samia fait des études de médecine, s’engage au Parti Socialiste en 1988. Elle épouse Vincent.
Leur vie et leurs rencontres successives ponctuent des moments clés de l’histoire franco-algérienne, ou de la difficile insertion dans la société française, même si le choix des auteurs porte sur des parcours de réussite sociale et familiale. Mentionnons au passage l’accueil en France de Malik, un ami kabyle de Farid, venu se réfugier après que son village ait subi un massacre en 1996.
Le livre se termine par la mort de Farid, d’un cancer. Ses amis et leurs enfants prennent ensemble le bateau pour l’Algérie, et se rendent dans son village natal pour y planter un frêne en souvenir. C’est ce même Malik qui les pilote jusqu’à Beni Douala, d’où est originaire la famille de Farid.
On ferme ce livre avec une forme d’attachement pour ces personnages à qui les auteurs ont su donner vie tout en en faisant les témoins engagés de cette riche et complexe histoire de l’immigration algérienne en France, pan inséparable de l’histoire de notre pays…
Michel WILSON

Note
Saint-Paul-Trois-Châteaux, situé dans la Drôme, appartient à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voici le programme du festival de cinéma, sous la direction artistique de Marion Pasquier, qui s’y est tenu pendant ce mois d’octobre, comportant plusieurs films en provenance du monde arabe :
Voici le programme du festival de cinéma, sous la direction artistique de Marion Pasquier, qui s’y est tenu pendant ce mois d’octobre, comportant plusieurs films en provenance du monde arabe :
No Other Land, doc palestinien à Bollène dans le cadre d’une séance “hors les murs”
La mer au loin, de Said Hamich, en sa présence jeudi 17 octobre 21h
Voyage à Gaza, de Piero Usberti, en sa présence jeudi 17 octobre 18h30
Everybody Loves Touda, de Nabyl Ayouch, vendredi 18 octobre 20h30
Rabia film français qui se passe en Syrie, dimanche 20 octobre 18h en présence de la réalisatrice
Save Our Souls se passe sur un bateau de sauvetage de migrants au large de la Lybie, vendredi 18 octobre 18h en présence du réalisateur.
Les organisateurs revendiquent un événement culturel d’envergure qui célèbre le septième art et les valeurs universelles des droits humains.
Note : « Ulysse de Taourirt », mise en scène de Abdelwaheb Sefsaf
Ce créateur a des domaines d’action multiples, aussi bien la poésie que le théâtre et la musique et les projections vidéo. Les habitants de la région Aura ont plus d’une raison de s’intéresser à lui, car il y a été très présent de plusieurs manières : formé à l’Ecole nationale supérieure d’art dramatique de Saint-Etienne (ville où il est né en 1976), il a été directeur du Théâtre de Roanne et a beaucoup joué encore récemment à Bourg-en-Bresse et à Villefranche-sur-Saône.
Les habitants de la région Aura ont plus d’une raison de s’intéresser à lui, car il y a été très présent de plusieurs manières : formé à l’Ecole nationale supérieure d’art dramatique de Saint-Etienne (ville où il est né en 1976), il a été directeur du Théâtre de Roanne et a beaucoup joué encore récemment à Bourg-en-Bresse et à Villefranche-sur-Saône.
Nous avions commenté dans notre Lettre 85 son splendide spectacle de Théâtre musical “Kaldun”, qui passait au Théâtres des Célestins à Lyon.
Il a opéré une montée brillante au sein de la création dramatique nationale (il dirige actuellement le Théâtre de Sartrouville, dans les Yvelines), et sans aucun doute grâce à l’originalité de son propos. Elle apparaît dans cette pièce intitulée «Ulysse de Taourirt » dont le récit lui a été inspiré par la vie de son père Arezki, originaire de la région de Béjaia en Algérie et venu en France en 1948 à l’âge de 16 ans pour participer à la reconstruction de ce Pays après la Seconde guerre mondiale.
Sur cette sorte de migration des Algériens vers la France, nombreux sont les témoignages de type historique et sociologique ainsi que les récits autobiographiques des intéressés ou de leurs enfants, dits « de la deuxième génération ». Mais le point de vue adopté par Abdelwaheb Sefsaf est tout différent, comme le prouve la présence du nom d’Ulysse dans son titre. Le mouvement des Algériens vers la France, à partir des régions rurales de leur Kabylie originelle, appartient aux grandes migrations dont on trouve la trace dans les épopées, inspirées à la fois par des faits collectifs et des destins individuels. Ce que ces derniers nous apprennent a des traces à Mycènes, aujourd’hui petit village rural d’Argolide en Grèce mais aussi bien en Algérie à Taourirt, d’où cette formule remarquable de l’auteur : « Mon père, héros antique caché sous l’apparence d’un ouvrier ordinaire ».
Denise Brahimi
Note : Aldéhyde, restaurant tunisien Aldéhyde, ce nom surprenant, désigne la molécule qui donne son arôme à la coriandre. Cette note est donc un clin d’œil complice à tous les gourmands et gourmandes que réjouira l’ouverture d’un nouveau et bon restaurant tunisien—malheureusement à Paris et pas à Lyon—ce qui n’empêche pas de saliver à l’é vocation d’une cuisine savoureuse, celle de Youssef Marzouk, qui a eu plusieurs fois l’occasion de travailler avec des chefs étoilés. On parle de ses carottes au cumin, servies en entrée sous diverses formes. Pour ce qui est de ses plats principaux, mieux vaut citer les paroles enthousiastes d’un chroniqueur gastronomique, qui dit le ravissement que lui ont fait éprouver « l’agneau confit sur purée de navets boules d’or et son jus au ras-el-hanout, dressé tel un dessert de palace, et le poisson nacré en médaillon au fenouil et beurre blanc». Il évoque des influences tunisiennes, beaucoup à Coup de soleil auront plaisir à les reconnaître.
Aldéhyde, ce nom surprenant, désigne la molécule qui donne son arôme à la coriandre. Cette note est donc un clin d’œil complice à tous les gourmands et gourmandes que réjouira l’ouverture d’un nouveau et bon restaurant tunisien—malheureusement à Paris et pas à Lyon—ce qui n’empêche pas de saliver à l’é vocation d’une cuisine savoureuse, celle de Youssef Marzouk, qui a eu plusieurs fois l’occasion de travailler avec des chefs étoilés. On parle de ses carottes au cumin, servies en entrée sous diverses formes. Pour ce qui est de ses plats principaux, mieux vaut citer les paroles enthousiastes d’un chroniqueur gastronomique, qui dit le ravissement que lui ont fait éprouver « l’agneau confit sur purée de navets boules d’or et son jus au ras-el-hanout, dressé tel un dessert de palace, et le poisson nacré en médaillon au fenouil et beurre blanc». Il évoque des influences tunisiennes, beaucoup à Coup de soleil auront plaisir à les reconnaître.
Denise Brahimi
Note sur Mohammed Harbi : (information transmise par l’universitaire historien et juriste Tahar Khalfoune)
(information transmise par l’universitaire historien et juriste Tahar Khalfoune)
L’historien Mohammed Harbi, auteur de nombreux et excellents travaux de recherche sur l’histoire de l’Algérie, dont notamment “Le FLN mirage et réalité”, Editions jeune Afrique 1981, ouvrage de 446 pages tiré de sa thèse de doctorat d’Etat, vient d’annoncer la publication en tamazight (berbère) de son livre “Une vie debout”, Editions Koukou 2024, et prend sa retraite politique
25 octobre 2024.
Note : Aldéhyde, restaurant tunisien Aldéhyde, ce nom surprenant, désigne la molécule qui donne son arôme à la coriandre. Cette note est donc un clin d’œil complice à tous les gourmands et gourmandes que réjouira l’ouverture d’un nouveau et bon restaurant tunisien—malheureusement à Paris et pas à Lyon—ce qui n’empêche pas de saliver à l’é vocation d’une cuisine savoureuse, celle de Youssef Marzouk, qui a eu plusieurs fois l’occasion de travailler avec des chefs étoilés. On parle de ses carottes au cumin, servies en entrée sous diverses formes. Pour ce qui est de ses plats principaux, mieux vaut citer les paroles enthousiastes d’un chroniqueur gastronomique, qui dit le ravissement que lui ont fait éprouver « l’agneau confit sur purée de navets boules d’or et son jus au ras-el-hanout, dressé tel un dessert de palace, et le poisson nacré en médaillon au fenouil et beurre blanc». Il évoque des influences tunisiennes, beaucoup à Coup de soleil auront plaisir à les reconnaître.
Aldéhyde, ce nom surprenant, désigne la molécule qui donne son arôme à la coriandre. Cette note est donc un clin d’œil complice à tous les gourmands et gourmandes que réjouira l’ouverture d’un nouveau et bon restaurant tunisien—malheureusement à Paris et pas à Lyon—ce qui n’empêche pas de saliver à l’é vocation d’une cuisine savoureuse, celle de Youssef Marzouk, qui a eu plusieurs fois l’occasion de travailler avec des chefs étoilés. On parle de ses carottes au cumin, servies en entrée sous diverses formes. Pour ce qui est de ses plats principaux, mieux vaut citer les paroles enthousiastes d’un chroniqueur gastronomique, qui dit le ravissement que lui ont fait éprouver « l’agneau confit sur purée de navets boules d’or et son jus au ras-el-hanout, dressé tel un dessert de palace, et le poisson nacré en médaillon au fenouil et beurre blanc». Il évoque des influences tunisiennes, beaucoup à Coup de soleil auront plaisir à les reconnaître.
Denise Brahimi

“DE L’AUTRE CÔTE DE LA MER”, film de Dominique Cabrera 1997
En ce début d’octobre 2024, Coup de soleil AURA a consacré des journées de réflexion à ceux qu’on appelle les Pieds Noirs et l’on a pu voir ou revoir à cette occasion, quoique dans des conditions techniques difficiles, un remarquable film de la réalisatrice Dominique Cabrera dont c’était alors, en 1997, le premier long métrage.  Les excellents acteurs qu’elle avait su réunir pour la circonstance, Claude Brasseur, Roschdy Zem, Sid Ahmed Agoumi et beaucoup d’autres, n’ont pas suffi à assurer au film un succès immédiat, sans doute parce qu’il arrivait à un moment où le public n’était pas ou plus disposé à se poser les problèmes qu’il soulevait : le rapatriement des Pieds noirs en 1962, un peu avant et un peu après l’indépendance de l’Algérie, était sans doute un problème rebattu et dont plus personne n’avait envie de parler encore après 35 ans, pas même ou surtout pas les principaux intéressés dont plus d’une génération avait permis tant bien que mal l’intégration en territoire français. Pour la réalisatrice en revanche, il semble (et elle le prouve) qu’elle se sentait désormais apte à poser avec beaucoup de subtilité le problème très complexe d’une appartenance qu’on n’appelait pas encore identitaire et qui n’en était pas moins problématique voire paradoxale.
Les excellents acteurs qu’elle avait su réunir pour la circonstance, Claude Brasseur, Roschdy Zem, Sid Ahmed Agoumi et beaucoup d’autres, n’ont pas suffi à assurer au film un succès immédiat, sans doute parce qu’il arrivait à un moment où le public n’était pas ou plus disposé à se poser les problèmes qu’il soulevait : le rapatriement des Pieds noirs en 1962, un peu avant et un peu après l’indépendance de l’Algérie, était sans doute un problème rebattu et dont plus personne n’avait envie de parler encore après 35 ans, pas même ou surtout pas les principaux intéressés dont plus d’une génération avait permis tant bien que mal l’intégration en territoire français. Pour la réalisatrice en revanche, il semble (et elle le prouve) qu’elle se sentait désormais apte à poser avec beaucoup de subtilité le problème très complexe d’une appartenance qu’on n’appelait pas encore identitaire et qui n’en était pas moins problématique voire paradoxale.
L’emploi qu’elle fait du mot « autre », apparemment si simple, suffit à soulever des questions qu’elle sait rendre urgentes voire insolubles ou dont en tout cas elle maintient jusqu’au bout, comme une sorte d’énigme portant son film, l’absence de solution. Avec ce mot « autre », tout est dit de la problématique du film, l’autre n’a pas de définition objective, il ne peut prendre sens que par un choix volontaire, qui consiste à définir comme autre le lieu où l’on n’est pas et où l’on ne veut pas être. C’est ainsi que pour le Pied-Noir Georges Montero (joué par Claude Brasseur) qui a décidé de rester en Algérie après l’indépendance, l’autre ne peut être que la France, où pourtant toute sa famille est venue s’installer et le somme d’en faire autant. Tandis que pour ladite famille, l’autre est évidemment l’Algérie qui fut sienne mais qu’elle a décidé d’oublier. L’autre n’est donc pas seulement une réalité géographique comme dans « l’autre côté », c’est aussi une réalité temporelle qui sépare le présent du passé : l’autre est ce qui n’est plus.
 La définition de l’autre est sans doute plus difficile pour les Algériens, en passe de devenir des Français d’origine algérienne, et qui sont nombreux à vivre en France, en fait à Paris où on les voit dans leur milieu professionnel, café, boucherie en gros etc. On serait tenté de dire qu’ils n’ont pas d’autre côté mais plutôt qu’ils en ont deux, la France et l’Algérie—ou bien encore qu’ils n’en ont aucun, et c’est de cela que nous parle la réalisatrice à travers le personnage de Tarik Timzert (joué par Roschdy Zem). Ce jeune ophtalmologue, chirurgien à l’hôpital, vit avec une femme française et leur petit garçon. S’il se posait la question il se sentirait sans doute français, sans lien en tout cas avec l’Algérie dont il ne sait rien, même pas la langue. Il est vrai que l’irruption dans sa vie de Georges qui par hasard est devenu son patient, le perturbe et le déstabilise mais il semble bien que personne et surtout pas lui même ne puisse définir Tarek par rapport à ce que serait l’autre pour lui. A la question du choix, Tarek est incapable de répondre alors que Georges ne répond que trop, beaucoup trop affirmativement. Quoi qu’il en soit l’échantillon humain que le film réunit montre bien que le choix d’un côté de la Méditerranée plutôt que d’un autre n’a rien à voir ni avec la nature, c’est-à-dire l’origine biologique, ni avec la culture, contrairement à ce que semble dire Georges, qui revendique son appartenance à une culture algérienne supposée inchangée depuis 35 ans.
La définition de l’autre est sans doute plus difficile pour les Algériens, en passe de devenir des Français d’origine algérienne, et qui sont nombreux à vivre en France, en fait à Paris où on les voit dans leur milieu professionnel, café, boucherie en gros etc. On serait tenté de dire qu’ils n’ont pas d’autre côté mais plutôt qu’ils en ont deux, la France et l’Algérie—ou bien encore qu’ils n’en ont aucun, et c’est de cela que nous parle la réalisatrice à travers le personnage de Tarik Timzert (joué par Roschdy Zem). Ce jeune ophtalmologue, chirurgien à l’hôpital, vit avec une femme française et leur petit garçon. S’il se posait la question il se sentirait sans doute français, sans lien en tout cas avec l’Algérie dont il ne sait rien, même pas la langue. Il est vrai que l’irruption dans sa vie de Georges qui par hasard est devenu son patient, le perturbe et le déstabilise mais il semble bien que personne et surtout pas lui même ne puisse définir Tarek par rapport à ce que serait l’autre pour lui. A la question du choix, Tarek est incapable de répondre alors que Georges ne répond que trop, beaucoup trop affirmativement. Quoi qu’il en soit l’échantillon humain que le film réunit montre bien que le choix d’un côté de la Méditerranée plutôt que d’un autre n’a rien à voir ni avec la nature, c’est-à-dire l’origine biologique, ni avec la culture, contrairement à ce que semble dire Georges, qui revendique son appartenance à une culture algérienne supposée inchangée depuis 35 ans.
C’est du moins ce qu’il affirme mais nous n’avons aucun moyen de le constater de visu, le film se passant entièrement à Paris où il a en effet été tourné, et ne nous donnant aucun moyen de nous représenter la vie quotidienne en Algérie. En fait, ce que nous pouvons imaginer à ce propos à partir de quelques indices est bien loin d’une sorte de paradis pied-noir qui se serait idéalement maintenu. D’ailleurs, symboliquement, chaque fois que Georges cherche à joindre par téléphone son fidèle adjoint Ali qui gère la situation sur place pendant son séjour à Paris, la communication est aussitôt coupée et ne reste que l’inquiétude de savoir comment les choses se passent là-bas !
Mais bien plus gravement ce séjour permet à Georges de découvrir ce qu’il n’a pas vu ou pas voulu voir jusque là et c’est évidemment ainsi qu’on peut interpréter ses problèmes de vue ! En fait dès son arrivée dans le bistrot de Belka (joué par Sid Ahmed Agoumi), on est entré avec lui dans un imbroglio financier d’où il ressort que lassés d’attendre son départ d’Algérie certains ont déjà fait main basse sur ses biens et l’en ont dépossédé à son insu, profitant de son opiniâtre refus de voir les réalités nouvelles du pays. Celles-ci sont expliquées, de manière un peu piètre et pitoyable mais que l’on sent pleine de vérité par un autre personnage, algérien également très présent à Paris, Boualem (joué par Slimane Benaïssa). Pas forcément fier de lui, celui-ci estime pourtant qu’il ne fait que suivre un certain ordre des choses, un transfert des biens qui découle inévitablement du transfert politique opéré par l’indépendance. L’obstination de Georges ne peut empêcher que le monde ait changé. Entêté mais tout sauf bête il l’a sans doute finalement compris. Habilement, Dominique Cabrera maintient jusqu’au bout l’énigme de son choix.
Denise Brahimi
“DANS LE SILLAGE DE FRANTZ FANON”, documentaire de Mehdi Lallaoui, 2024
Ce très récent documentaire de 56 minutes a été présenté au public (et à son auteur même qui ne l’avait encore jamais vu sur grand écran !) dans la belle salle de l’Opéra Underground de Lyon, en préambule à la journée du 12 octobre 2024 consacrée à « Frantz Fanon et Lyon ». Et il est vrai que ce travail ou ces travaux sont très bienvenus du fait qu’ils concernent une période encore assez peu étudiée dans la vie de Frantz Fanon, période pourtant déterminante puisque c’est le moment où il s’est formé à la fois à la pratique psychiatrique et à la pensée politique, non sans qu’il laisse des témoignages écrits de ce qu’était alors sa réflexion. On ne saurait minimiser ce qu’il en a été de son passage par Lyon, du fait qu’il a duré 6 ans, de 1946 à 1952, ce qui est beaucoup dans une vie écourtée par sa mort prématurée en 1961. Frantz Fanon est venu à Lyon juste après la seconde guerre mondiale, alors qu’il était âgé d’une vingtaine d’années, puisque né en 1925, et son but était d’y faire des études de médecine, ce qu’il a fait effectivement mais pas seulement, comme on sait.
On ne saurait minimiser ce qu’il en a été de son passage par Lyon, du fait qu’il a duré 6 ans, de 1946 à 1952, ce qui est beaucoup dans une vie écourtée par sa mort prématurée en 1961. Frantz Fanon est venu à Lyon juste après la seconde guerre mondiale, alors qu’il était âgé d’une vingtaine d’années, puisque né en 1925, et son but était d’y faire des études de médecine, ce qu’il a fait effectivement mais pas seulement, comme on sait.
Sur ce qu’était sa réflexion à cette époque, il a écrit deux livres publiés à la fin de son séjour lyonnais, l’un bien connu puisqu’il fait partie du corpus de ses grandes œuvres connues passées à la postérité : il s’agit de « Peau noire, masques blancs » (1952) et, daté de la même année, « Le Syndrome Nord-africain »dont cette journée sur Frantz Fanon et Lyon permet de découvrir l’importance.
Pour Mehdi Lallaoui, qui a désormais réalisé un nombre considérable de documentaires, celui-ci n’a pas été une découverte du personnage de Frantz Fanon, à la personne (sinon au personnage) duquel il a déjà consacré un premier documentaire en 2021, « Sur les traces de Frantz Fanon ». Nombreux sont ses travaux sur le monde ouvrier, l’immigration en France et le racisme inhérent aux situations coloniales ou post-coloniales. Mehdi Lallaoui est connu aussi pour sa participation à diverses formes d’action telles que la Marche des Beurs en 1983, qu’il a contribué à organiser, et on peut supposer que de là datent ses liens ou leur renforcement avec le Lyonnais Christian Delorme, dont la présence est très importante dans le documentaire dont nous parlons. Celui-ci, prêtre catholique actuellement en retraite est très connu à Lyon, dont il est une haute figure tutélaire, à la fois familière et prestigieuse. Il a beaucoup œuvré pour aider les jeunes des banlieues, expression très concrète qui convient mieux pour le dire qu’une formule un peu rebattue telle que « le rapprochement entre chrétiens et musulmans ». D’ailleurs l’un des intérêts du documentaire de Mehdi Lallaoui est de montrer que ce n’est nullement d’un affrontement religieux qu’il s’agit, contrairement à ce qu’on aurait tendance à croire aujourd’hui. Pour évoquer de manière vivante la présence de Frantz Fanon à Lyon, le réalisateur ne pouvait se contenter d’images d’archives enfermant son personnage dans un passé déjà lointain. C’est en cela que la participation de Christian Delorme à son film lui a été précieuse, car celui-ci a l’art de restituer la figure bien vivante de celui qu’il fait déambuler dans les rues de Lyon et de lieux en lieux, que tous les Lyonnais évidemment reconnaîtront. Et l’on ne peut manquer de s’associer au désir qu’il exprime de voir un jour une plaque sur l’une des maisons en tout cas où a vécu Frantz Fanon, celle qu’il a habité le plus longtemps.
Pour évoquer de manière vivante la présence de Frantz Fanon à Lyon, le réalisateur ne pouvait se contenter d’images d’archives enfermant son personnage dans un passé déjà lointain. C’est en cela que la participation de Christian Delorme à son film lui a été précieuse, car celui-ci a l’art de restituer la figure bien vivante de celui qu’il fait déambuler dans les rues de Lyon et de lieux en lieux, que tous les Lyonnais évidemment reconnaîtront. Et l’on ne peut manquer de s’associer au désir qu’il exprime de voir un jour une plaque sur l’une des maisons en tout cas où a vécu Frantz Fanon, celle qu’il a habité le plus longtemps.
Christian Delorme est remarquablement efficace pour restituer ce qui fut vivant. Mais il n’est pas le seul, ni le seul procédé, auquel Mehdi Lallaoui a recours. Le réalisateur a en effet imaginé de montrer tout au long du film un personnage qui reste muet mais qui symbolise par sa peau noire et son regard de Noir ce qu’a pu éprouver et faire éprouver Frantz Fanon lui-même déambulant dans Lyon. Ce rapport à la population locale a joué un rôle déterminant notamment dans l’élaboration de « Peau noire, masques blancs » parce qu’il n’a cessé de lui montrer de la manière la plus indubitable, à quel point cette proximité immédiate avec un Noir ne pouvait manquer d’être ressentie comme intrusion. Il faut pour le comprendre se souvenir qu’à la fin des années quarante, le nombre de Noirs dans une ville comme Lyon restait minime au point de provoquer l’étonnement (la peur ?) des petits enfants blancs.
Il serait certainement trop fort d’employer pour le dire des mots tels que « rejet » ou a fortiori « hostilité ». Il s’agit d’un sentiment réciproque, qui n’est certainement pas fait d’immédiate sympathie et qui s’explique entre autres, si l’on pense a à ce qu’a pu ressentir Fanon lui-même, par le fait que Lyon à l’époque n’était pas une ville aussi attrayante qu’elle ne l’est actuellement. Tous ceux qui s’en souviennent disent à quel point elle était sombre, du fait des bâtiments très noirs et de nombreuses zones laissées dans l’obscurité.
Cependant, Fanon n’est pas de ceux qui cultivent le sentiment d’étrangeté, dont il connaît trop bien les méfaits, à l’origine d’un certain nombre de troubles psychiatrique. Tout l’effort qu’il considère comme nécessaire, de manière plus générale, comme il le fera pendant tout le reste de sa vie, consiste au contraire à affirmer l’unité du genre humain, dont la conséquence est que les Noirs sont des hommes comme les autres, qui loin d’avoir pour arme la violence ne peuvent au contraire qu’en souffrir.
Denise Brahimi
Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.
 – Utiles
– Utiles
de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun
Cliquez ici pour voir le film et le mot de passe utilesjoussour

–Entre nos mains
de Leila Saadna
Cliquez ici pour voir le film, puis mot de passe utilesjoussour
Et sa bande-annonce, cliquez ici

- Lundi 4 novembre intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie au Lycée Claude Bernard de Villefranche sur Saône
- Jeudi 7 novembre rencontre de l’auteur de BD Salim ZERROUKI à la Librairie Traits d’Union à Lyon
- Vendredi 8 novembre à Lyon, Bourdieu et la Kabylie, par Tassadit YACINE à la Mairie du 1er arrondissement (FORSEM)
- Samedi 9 novembre à Grenoble Soirée Réfractaires à la guerre d’Algérie: “Les soldats du refus” (Collectif 17 octobre)
- mercredi 13 novembre, à la Médiathèque Léonard de Vinci de Vaulx en Velin, Conférence de Stanislas FRENKIEL sur l’histoire du sport dans l’Algérie coloniale
- Jeudi 14 novembre à l’Espace culturel saint Marc à Lyon, Gisèle Halimi avocate insoumise par Nadia LARBIOUENE Compagnie Novecento.
- Vendredi 22 novembre aux Amphis de Vaulx en Velin projection du Film La belle équipe du FLN d’Eric CANTONA, en présence de deux deux anciens joueurs
N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.