« 1994 », roman par Adlène Meddi, Alger, Barzakh, 2017
L’auteur n’en est pas à son coup d’essai et pour ceux qui auront lu La Prière du Maure (2008), il sera évident que 1994 est écrit en continuité avec ce livre désigné comme « Polar » qui revenait déjà sur l‘incroyable mélange de toute puissance et d’anarchie sanglantes provoqué par la lutte anti-terroriste pendant une dizaine d’années.
 Adlène Meddi, né en 1975, a donc à peu près l’âge d’Amin fils de Zoubir, le personnage principal de 1994. Ce dernier est encore un lycéen qui n’a pas vingt ans lorsque se passent les événements principaux du livre, à la date du titre. Il choisit cette année-là parce qu’elle est au cœur de la terrible « décennie noire », manière de désigner une guerre civile d’une effroyable cruauté.
Adlène Meddi, né en 1975, a donc à peu près l’âge d’Amin fils de Zoubir, le personnage principal de 1994. Ce dernier est encore un lycéen qui n’a pas vingt ans lorsque se passent les événements principaux du livre, à la date du titre. Il choisit cette année-là parce qu’elle est au cœur de la terrible « décennie noire », manière de désigner une guerre civile d’une effroyable cruauté.
Des deux partis en présence, le seul qu’on voie, et de très près, dans le roman d’Adlène Meddi, est celui du pouvoir d’Etat, y compris et surtout les « services spéciaux », liés à l’armée non sans luttes fratricides et féroces, alors que les terroristes eux-mêmes n’y sont jamais présents ni vraiment décrits, sinon par de brèves allusions. Etant bien clair pour tous ses lecteurs que le terrorisme a sévi en Algérie pendant cette décennie, le romancier a choisi de représenter ceux qui se sont donné pour tâche (et finalement victorieusement) de lutter contre lui, et c’est peu de dire qu’ils l’ont fait par tous les moyens—en sorte que, si terrorisme il y a eu, la terreur profondément ressentie par les lecteurs (ainsi que par certains personnages du livre) vient de cette répression d’une violence inouïe, exercée notamment par le déjà nommé Zoubir, qui appartient aux services secrets. Bien qu’il y occupe un poste très élevé, il n’en est pas moins contrôlé par quelques personnages aussi mystérieux qu’effrayants placés encore plus haut que lui dans cette redoutable hiérarchie de la lutte anti-terroriste.
Adlène Meddi s’est sans doute inspiré de modèles réels, d’ailleurs il l’a dit lui-même et de toute façon on sent bien qu’il ne parle pas au hasard. Cependant, il ajoute à cette information précise une qualité littéraire qui rend certains passages de son roman tout à fait saisissants. Il veut et sans doute n’a-t-il pas tort, faire de la décennie et plus spécialement de l’année 1994 une sorte d’Apocalypse réalisée au présent. On s’y trouve transporté par delà le bien et le mal car il est évident qu’aucune notion morale n’apparaît où que ce soit, et aussi si l’on peut dire par delà la vie et la mort car on ne voit pas très bien où viendrait se loger quelque respect de la vie dans ce massacre quotidien dont personne ne semble concevoir ni envisager la fin.
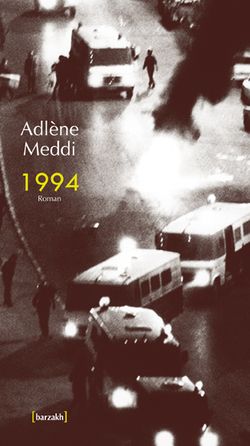 La tragédie qui est au cœur du livre est d’ailleurs une conséquence de ce dernier point. Zoubir est le père d’Amin mais il comprend trop tard que celui-ci avec quelques-uns de ses camarades, un surtout, prénommé Sidali, se croit autorisé et même appelé lui aussi à tuer parce que rien n’a prémuni ces jeunes garçons contre l‘influence mortifère du milieu ambiant. Ils constituent un groupe autoproclamé et évidemment clandestin de quatre garçons, ce qui n’est pas sans rappeler les quatre compagnons dont parle Kateb Yacine dans Nedjma. Et cette ressemblance ou influence se trouve renforcée à plusieurs reprises par la manière d’écrire d’Adlène Meddi, qui ne pratique la narration linéaire qu’à de courts moments, préférant le plus souvent parsemer son récit, longtemps un peu obscur, d’allusions à des événements qui ne prennent forme que peu à peu dans l’esprit du lecteur. Comme dans Nedjma, le récit qui semble concerner principalement les jeunes gens ne se comprend en fait que si on l’étend sur deux générations, celle des pères et celle des fils, et l’on peut tout à fait reprendre la formule connue selon laquelle les ancêtres redoublent de férocité à propos du redoutable Zoubir, lourdement chargé d’ambiguïtés. Le lien avec la période dont parle Kateb Yacine est assuré en ce sens que Nedjma se passe juste avant le début de la Guerre d’Algérie alors que 1994 nous fait remonter jusqu’à la fin de cette même guerre, celle pendant laquelle les pères comme Zoubir et Farès père de Sidali se sont battus côte à côte (non sans rivalités et haines inexpiables) et ont mis au point les méthodes qu’ils réutilisent pendant la décennie. D’ailleurs le style enflammé d’Adlène Meddi, nourri de visions épiques, doit certainement beaucoup à un certain héritage reçu de Kateb Yacine. Et comme cet encore jeune auteur trouve dans la littérature algérienne un véritable fonds culturel propre à nourrir son inspiration, on peut certainement dire que la relation entre Amin et la psychiatre qui le soigne à l’hôpital de Blida rappelle ce qu’il en est dans La Répudiation de Rachid Boudjedra, y compris pour le procédé narratif qui permet de revenir sur certains événements à travers le prisme d’une sensibilité aiguisée par la maladie et la douleur.
La tragédie qui est au cœur du livre est d’ailleurs une conséquence de ce dernier point. Zoubir est le père d’Amin mais il comprend trop tard que celui-ci avec quelques-uns de ses camarades, un surtout, prénommé Sidali, se croit autorisé et même appelé lui aussi à tuer parce que rien n’a prémuni ces jeunes garçons contre l‘influence mortifère du milieu ambiant. Ils constituent un groupe autoproclamé et évidemment clandestin de quatre garçons, ce qui n’est pas sans rappeler les quatre compagnons dont parle Kateb Yacine dans Nedjma. Et cette ressemblance ou influence se trouve renforcée à plusieurs reprises par la manière d’écrire d’Adlène Meddi, qui ne pratique la narration linéaire qu’à de courts moments, préférant le plus souvent parsemer son récit, longtemps un peu obscur, d’allusions à des événements qui ne prennent forme que peu à peu dans l’esprit du lecteur. Comme dans Nedjma, le récit qui semble concerner principalement les jeunes gens ne se comprend en fait que si on l’étend sur deux générations, celle des pères et celle des fils, et l’on peut tout à fait reprendre la formule connue selon laquelle les ancêtres redoublent de férocité à propos du redoutable Zoubir, lourdement chargé d’ambiguïtés. Le lien avec la période dont parle Kateb Yacine est assuré en ce sens que Nedjma se passe juste avant le début de la Guerre d’Algérie alors que 1994 nous fait remonter jusqu’à la fin de cette même guerre, celle pendant laquelle les pères comme Zoubir et Farès père de Sidali se sont battus côte à côte (non sans rivalités et haines inexpiables) et ont mis au point les méthodes qu’ils réutilisent pendant la décennie. D’ailleurs le style enflammé d’Adlène Meddi, nourri de visions épiques, doit certainement beaucoup à un certain héritage reçu de Kateb Yacine. Et comme cet encore jeune auteur trouve dans la littérature algérienne un véritable fonds culturel propre à nourrir son inspiration, on peut certainement dire que la relation entre Amin et la psychiatre qui le soigne à l’hôpital de Blida rappelle ce qu’il en est dans La Répudiation de Rachid Boudjedra, y compris pour le procédé narratif qui permet de revenir sur certains événements à travers le prisme d’une sensibilité aiguisée par la maladie et la douleur.
Il y a semble-t-il chez Adlène Meddi le sentiment que sa génération a été sacrifiée—encore une—et encore une fois parce que les pères n’ont eu en tête que le souci d’affirmer leur pouvoir au moyen d’une guerre qui finalement les a avalés et détruits eux aussi. Zoubir, remarquable d’intelligence, sent très bien que les victoires qu’il remporte sont payées au prix fort, par son fils mais déjà par lui-même auparavant. Qu’il en soit conscient ou pas ne change rien, les bourreaux sont aussi des victimes c’est pourquoi on ne peut les haïr, comme il ressort de ce livre où l’on sent passer ce mélange de terreur et de pitié qui sont à la base du sentiment tragique selon Aristote.
1994 a quelques aspects d’un roman policier mais bien davantage ceux d’un « roman noir », genre qui ne répond à aucune définition précise et répertoriée mais qui correspond admirablement à certains milieux et à certaines époques. Adlène Meddi n’a pas besoin d’avoir lu Dashiell Hammett (s’il l’a lu tant mieux) car mieux vaut dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets : La violence dont il parle se situe entièrement dans un milieu urbain (est-ce la fin du roman paysan si représenté chez les premiers maîtres de la littérature algérienne ?), on ne voit guère dans quels repères la société mise en cause pourrait être ancrée, et s’agissant de littérature, il est évidemment très important que le romancier reproduise ou réinvente la langue de ses personnages, grossière, argotique, pittoresque aussi et l’on oserait dire talentueuse, en sorte qu’il n’est pas interdit d’en rire, au cœur même d’effroyables situations.
Denise Brahimi
(texte provenant du N° 24, Juillet 2018, Lettre franco-maghrébine de Coup de soleil section Rhône-Alpes)


