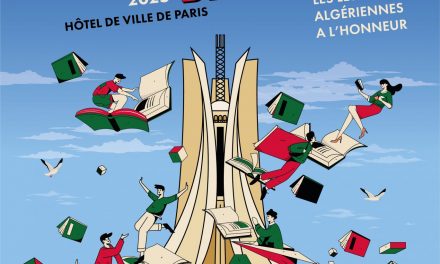« La Belle et la meute », film tunisien, de Kaouther Ben Hania 2017
Il paraît difficile de ne pas être ému, choqué, indigné par ce film d’une Tunisienne qui d’ailleurs n’en est pas à son coup d’essai puisque, âgée d’une quarantaine d’années, elle en a déjà plusieurs autres à son actif dont Le Challat de Tunis en 2013, qui  illustrait, avec humour et originalité, le machisme régnant en Tunisie. Inutile de dire que la Tunisie n’a hélas pas le monopole des comportements dénoncés mais c’est en tout cas un pays où l’on n’a pas peur de parler et de montrer (à la différence de l’Algérie si l’on en croit ce que dit Kamel Daoud qui est bien placé pour déplorer les silences et les occultations pratiqués dans son propre pays).
illustrait, avec humour et originalité, le machisme régnant en Tunisie. Inutile de dire que la Tunisie n’a hélas pas le monopole des comportements dénoncés mais c’est en tout cas un pays où l’on n’a pas peur de parler et de montrer (à la différence de l’Algérie si l’on en croit ce que dit Kamel Daoud qui est bien placé pour déplorer les silences et les occultations pratiqués dans son propre pays).
Cependant, il importe de préciser d’emblée ce que signifie « montrer » dans le film de Kaouther Ben Hania. Car c’est une histoire de viol où le viol lui-même n’est jamais montré tant il est vrai qu’il faut surtout éviter le voyeurisme latent, une dérive toujours possible quand il s’agit de comportements sexuels surtout violents. Le seul moment où l’on croit apercevoir le viol dont il est constamment question est une image d’une seconde à peine et qu’on pourrait dire subliminale, aperçue sur le téléphone portable d’un des violeurs qui a jugé bon et plaisant d’enregistrer son forfait sans doute pour s’en vanter et pour continuer à en jouir. Kaouther Ben Hania, elle, ne montre rien, d’une part parce que l’état dans lequel est la jeune femme Mariam immédiatement après le viol suffit largement à évoquer ce qu’elle a subi et d’autre part parce que le propos du film est justement de déplacer le lieu de la violence —viol et violence étant évidemment les mots les plus proches qui soient—pour le situer partout où Mariam, pendant une interminable nuit, va essayer de se faire entendre et de faire reconnaître officiellement ce dont elle a été victime. On assiste consterné à cette sorte de dissémination et de démultiplication du fait initial, qui était physique et sexuel, sous des formes apparemment autres mais qui en fait sont de même nature que le viol, le prolongent et l’amplifient. La société toute entière, en tout cas dans ses institutions les plus connues et auxquelles Mariam essaie d’abord naïvement d’avoir recours, devient une sorte de caisse de résonance qui amplifie l’horreur ressentie par la jeune femme violée ; elle est bousculée, y compris physiquement, au point qu’à la fin de la nuit  elle est couverte de meurtrissures qu’elle n’avait pas après le viol lui-même. En dehors des coups qu’elle reçoit (qui n’autorisent pas à parler de torture au sens premier du mot mais qui pourtant vont jusqu’à lui faire perdre connaissance), elle subit un matraquage moral et psychique, rejets sans ménagements, chantage, menaces, injures, qui dure bien plus longtemps que le viol lui-même et qui est le fait d’un nombre bien plus grand de « violenteurs » sinon de violeurs : ils étaient deux, ce qui était évidemment plus qu’assez pour rendre toute résistance impossible, mais au cours de son horrible nuit, il y a un nombre bien plus important de policiers qui la malmènent, sans parler de tous ceux et de toutes celles qu’elle supplie en vain de l’aider, et qui se réfugient pour refuser de le faire derrière un ensemble d’impossibilités réelles ou supposées.
elle est couverte de meurtrissures qu’elle n’avait pas après le viol lui-même. En dehors des coups qu’elle reçoit (qui n’autorisent pas à parler de torture au sens premier du mot mais qui pourtant vont jusqu’à lui faire perdre connaissance), elle subit un matraquage moral et psychique, rejets sans ménagements, chantage, menaces, injures, qui dure bien plus longtemps que le viol lui-même et qui est le fait d’un nombre bien plus grand de « violenteurs » sinon de violeurs : ils étaient deux, ce qui était évidemment plus qu’assez pour rendre toute résistance impossible, mais au cours de son horrible nuit, il y a un nombre bien plus important de policiers qui la malmènent, sans parler de tous ceux et de toutes celles qu’elle supplie en vain de l’aider, et qui se réfugient pour refuser de le faire derrière un ensemble d’impossibilités réelles ou supposées.
Cette description consternante qui fait la matière du film n’est pas présentée sous la forme d’une longue litanie et déploration et l’on comprend que la réalisatrice voulait justement éviter cela, d’où le fait qu’elle utilise un procédé radical et en effet très efficace de découpage de l’action : le résultat en est une succession d’épisodes assez courts voire elliptiques, neuf en tout, qui sont numérotés et défilent à un rythme soutenu, de manière à ne garder que des temps forts, que le spectateur doit subir comme une sorte de harcèlement incessant. Ce n’est pas exactement un effet répétitif qui est cherché parce qu’en fait chaque nouvel épisode est comme une variation à partir d’un ensemble, mais de toute manière, la réalisatrice fait en sorte qu’on ressente à peu près la même chose que son héroïne, un effet punching ball si l’on peut dire les choses ainsi, c’est-à-dire que sitôt un coup reçu sur la tête, au propre comme au figuré et sans qu’on ait le temps de reprendre son souffle, le coup suivant est porté ; comme ces gifles qui claquent tantôt d’un côté tantôt de l’autre, escomptant la soumission d’une victime forcément « sonnée »—pour continuer l’image du sac de frappe utilisé par les boxeurs. Chacun des neuf épisodes est ressenti comme un coup de poing.
Cependant, grâce aux blancs qui séparent les temps forts, le film donne l’impression qu’il ne cherche pas à engluer le spectateur dans les méandres d’une narration unique et linéaire. Et d’autre part il y a toujours, en mineur, le fil parfois ténu d’un humanisme presque improbable (dans la possibilité de ses effets) mais qu’il est essentiel de ne pas lâcher : une infirmière qui cherche à être secourable et à accompagner la victime, un vieux policier qui l’encourage de son mieux à ne pas « craquer » et à garder sa détermination. Ce fil si mince qu’il soit fait que la Belle et la meute n’est pas un film désespéré—on dirait même l’inverse lorsque cette horrible histoire touche à son dénouement (provisoire en tout cas). Objectivement en effet, c’est Mariam qui a gagné, à sa propre surprise, lorsque ses deux ou trois derniers bourreaux se voient obligés de la relâcher.
Mais surtout, et c’est là le plus important, elle a fait en elle-même ou vis à vis d’elle-même un parcours auquel on n’avait pas forcément pensé tant elle paraissait d’abord superficielle et frivole, jolie d’une manière enfantine et très peu consciente des réalités. Or sa détermination à porter plainte, qui pourrait ressembler d’abord à un entêtement irréfléchi, apparaît bientôt comme un véritable courage, dont on est d’autant plus convaincu qu’il se forge par étapes, non sans rechute parfois, mais suivant pourtant la ligne générale d’une affirmation de soi et d’un souci grandissant de vérité. Le moment décisif à cet égard est celui où Mariam décide de téléphoner elle-même à son père pour lui dire ce qui s’est passé, alors qu’elle avait depuis le début supplié les policiers de ne pas prévenir sa famille ; ce qu’ils ne souhaitaient pas faire de toute façon mais leur permettait d’exercer sur elle un chantage et une intimidation. De manière imprévue, les suites du viol ont rendu Mariam consciente d’elle-même, violée certes mais pas seulement victime.
Denise Brahimi
(cet article provient du site de Coup de soleil Rhône-Alpes http://www.coupdesoleil-rhonealpes.fr/category/lire-ecouter-voir