Bien que ce livre soit désigné comme roman par son auteure, il ne l’est que très partiellement et s’appuie sur une documentation recueillie sur place à Lodève lorsque Roseline Villaumé y habitait en 2012. On sait que Lodève, dans le département de l’Hérault, possède une annexe de la Manufacture nationale de la Savonnerie et qu’on y fabrique des tapis de haut niveau. Les ouvriers (faut-il dire artisans ? ou artistes ?) qui travaillent à cette fabrication, sont appelés liciers, ou licières s’il s’agit de femmes et c’est justement le cas dans l’histoire racontée par Roseline Villaumé, dont la fiction donne vie à trois d’entre elles. Elles s’appellent Alice, Leïla et Fadhila, ce qui indique pour les deux dernières une origine algérienne. Et c’est en effet l’originalité de cette histoire que de trouver son origine à la fin de la guerre d’Algérie lorsqu’on a cherché à implanter en France, en leur donnant du travail, les harkis ramenés par l’armée française, avec femmes et enfants.
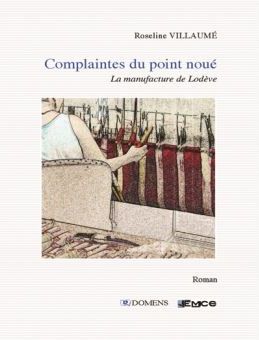 Pour les femmes, c’était une bonne idée que d’utiliser leur connaissance du tissage en créant un atelier où elles pourraient tirer parti de cette pratique traditionnelle, non sans la reconvertir évidemment. Roseline Villaumé a dû apprendre elle aussi quelques notions techniques et le vocabulaire nécessaire pour parler de ce métier. Elle le fait avec précision et de manière intéressante mais ce n’est pas l’essentiel ou pas seulement de ce qu’elle a voulu mettre en valeur dans son roman puisque roman il y a. Habituée à fréquenter les textes littéraires, elle s’intéresse à ce qu’on pourrait appeler du terme le plus banal qui soit « la vie des gens »et ici en particulier à la relation de ces femmes entre elles, chacune ayant comme on s’en doute une histoire particulière, pour les Algériennes lourdement chargée d’événements traumatisants.
Pour les femmes, c’était une bonne idée que d’utiliser leur connaissance du tissage en créant un atelier où elles pourraient tirer parti de cette pratique traditionnelle, non sans la reconvertir évidemment. Roseline Villaumé a dû apprendre elle aussi quelques notions techniques et le vocabulaire nécessaire pour parler de ce métier. Elle le fait avec précision et de manière intéressante mais ce n’est pas l’essentiel ou pas seulement de ce qu’elle a voulu mettre en valeur dans son roman puisque roman il y a. Habituée à fréquenter les textes littéraires, elle s’intéresse à ce qu’on pourrait appeler du terme le plus banal qui soit « la vie des gens »et ici en particulier à la relation de ces femmes entre elles, chacune ayant comme on s’en doute une histoire particulière, pour les Algériennes lourdement chargée d’événements traumatisants.
Le cas d’Alice est le moins problématique, même s’il n’était pas facile à cette jeune femme française formée à Paris de trouver sa place parmi des Algériennes dont la sympathie ne lui était certes pas acquise d’emblée. Timide, elle sort d’une rupture sentimentale qui l’a incitée à s’éloigner, et elle souffre de se sentir si peu apte à communiquer. Pour Fadhila il y a un obstacle supplémentaire dû au fait que cette vieille femme (mais pas si vieille peut-être) ne parle à peu près pas le français. Mais ce n’est clairement pas le seul nœud contre lequel il lui faut se battre, le mot « nœuds » étant porteur de la métaphore qui est au cœur de tout le livre : au sens premier, ce sont les nœuds du tapis de laine qui est tissé selon la technique dite du « point noué », au sens second il s’agit des nœuds qui étranglent et génèrent une angoisse difficilement surmontable à chaque instant et dans toutes les circonstances de la vie au quotidien.
 Leïla est une forte femme, qui finalement s’impose par sa compétence et parvient à la direction de l’atelier. Mais à quel prix ! Sans doute toutes les femmes qui travaillent et élèvent en même temps leurs enfants connaissent-elles ce genre de fatigue et la lutte à mener contre l’épuisement. Mais Leïla vit dans un milieu encore traditionnel où les femmes ne trouvent pas d’aide pour mener leur double tâche. Elle était encore une fillette lorsque sa famille a débarqué à Lodève, après le passage par un camp de transit, en novembre 1964. Elle a vu le courage et la patience qu’il a fallu à sa mère pour s’initier à un genre de tapis si différent de ceux qu’elle fabriquait en Algérie. A l’âge de 16 ans Leïla est entrée pleinement dans la vie de l’atelier, et n’en a jamais connu d’autre. Promue chef d’atelier, elle vit dans une sorte de crispation continuelle, qui lui interdit tout relâchement, tout moment de tranquillité. Elle fait partie de ce qu’on peut considérer comme une deuxième génération, celle dont la vie a commencé à peu près avec l’installation en France et dont le travail, au sens professionnel du mot, a toujours été le seul horizon. Devenue une femme dure, elle n’est certes pas dans la plainte ou la « complainte » dont parle le titre du livre, et ne peut surtout pas ni ne veut s’y adonner. C’est à propos d’autres femmes dont elle évoque le passé algérien et la rupture déchirante avec leur ancien monde que l’auteure du livre est tentée d’employer ce mot. S’agissant de Leïla, elle nous donne à comprendre ce qu’il y a en elle de tension, douloureuse sans doute, comme s’il n’y avait pas de place dans sa vie pour la tendresse et le laisser aller. Peut-on parler à son propos d’intégration réussie ou de réussite sociale ? Selon les apparences, certains répondraient oui sans hésiter mais le livre de Roseline Villaumé nous incite pour le moins à éviter ce genre de langage. Mieux vaut le laisser aux Officiels parisiens venus récupérer le magnifique tapis désormais achevé pour que s’ouvrent à lui les fastes de l’Elysée.
Leïla est une forte femme, qui finalement s’impose par sa compétence et parvient à la direction de l’atelier. Mais à quel prix ! Sans doute toutes les femmes qui travaillent et élèvent en même temps leurs enfants connaissent-elles ce genre de fatigue et la lutte à mener contre l’épuisement. Mais Leïla vit dans un milieu encore traditionnel où les femmes ne trouvent pas d’aide pour mener leur double tâche. Elle était encore une fillette lorsque sa famille a débarqué à Lodève, après le passage par un camp de transit, en novembre 1964. Elle a vu le courage et la patience qu’il a fallu à sa mère pour s’initier à un genre de tapis si différent de ceux qu’elle fabriquait en Algérie. A l’âge de 16 ans Leïla est entrée pleinement dans la vie de l’atelier, et n’en a jamais connu d’autre. Promue chef d’atelier, elle vit dans une sorte de crispation continuelle, qui lui interdit tout relâchement, tout moment de tranquillité. Elle fait partie de ce qu’on peut considérer comme une deuxième génération, celle dont la vie a commencé à peu près avec l’installation en France et dont le travail, au sens professionnel du mot, a toujours été le seul horizon. Devenue une femme dure, elle n’est certes pas dans la plainte ou la « complainte » dont parle le titre du livre, et ne peut surtout pas ni ne veut s’y adonner. C’est à propos d’autres femmes dont elle évoque le passé algérien et la rupture déchirante avec leur ancien monde que l’auteure du livre est tentée d’employer ce mot. S’agissant de Leïla, elle nous donne à comprendre ce qu’il y a en elle de tension, douloureuse sans doute, comme s’il n’y avait pas de place dans sa vie pour la tendresse et le laisser aller. Peut-on parler à son propos d’intégration réussie ou de réussite sociale ? Selon les apparences, certains répondraient oui sans hésiter mais le livre de Roseline Villaumé nous incite pour le moins à éviter ce genre de langage. Mieux vaut le laisser aux Officiels parisiens venus récupérer le magnifique tapis désormais achevé pour que s’ouvrent à lui les fastes de l’Elysée.
Denise Brahimi (repris de la Lettre culturelle franco-maghrébine N° 36, septembre 2019)

