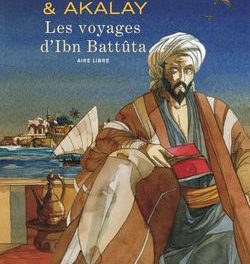Editorial
Qu’est-ce que la fin de l’année ? C’est de toute évidence le moment de penser, sans plus attendre, à ce que sera la suivante, de quoi elle sera faite, c’est-à-dire, s’agissant de la Lettre de Coup de soleil, quelles lectures et quels spectacles elle nous fera connaître : pour le Nouvel An, n’est-ce pas le plus précieux des cadeaux ?
Coup de soleil prépare depuis longtemps déjà une opération groupée autour de la judéité maghrébine, ce qui se manifeste ici par la présentation de deux récits, « L’enfant qui se taisait » de Marie-Claude Akiba Egry et « L’enfant de l’entre-deux » par Marc Sadoun ; et aussi d’un essai, consacré par Francine Kahn, aux juifs du nord du Maroc, « La demeure et l’exil ».
Côté cinéma nous vous proposons d’enrichir cette thématique grâce au récent film de Gad El Maleh, « Reste un peu », qui connaît un grand succès.
Côté théâtre, nous avons la chance que le metteur en scène lui-même, Dominique Lurcel, nous aide à apprécier le spectacle qu’il a consacré au « Journal » de Mouloud Feraoun, assassiné avec d’autres aux derniers jours de la Guerre d’Algérie. Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, il y a peut-être encore une petite chance d’y assister.
Même Le Progrès, journal attitré des Lyonnais, a eu l’idée de leur faire un cadeau de fin d’année : un livre riche de très nombreuses photos et documents d’archives, consacré aux rapports nombreux et variés entre la ville de Lyon et l’Algérie, avant, pendant et après la guerre d’indépendance de celle-ci.
Mais s’il est un cadeau qui sera particulièrement apprécié, c’est celui que nous fait Michel Wilson en présentant la célèbre BD de Riad Sattouf, « L’Arabe du futur » ! Que commence la nouvelle année…
Denise Brahimi
Puisque nous sommes entrés dans la période des cadeaux, peut-être souhaitez-vous faire un don à notre association, pour contribuer à notre fonctionnement? Et notamment au coût de réalisation de cette Lettre?
Vous en avez la possibilité en cliquant ICI. Merci d’avance et joyeuses fêtes!

« L’ENFANT QUI SE TAISAIT » par Marie-Claude Akiba Egry, récit, Gallimard 2021
L’enfant du titre n’est autre que l’autrice elle-même, qui a perdu son père alors qu’elle était petite fille dans des circonstances particulièrement effroyables : aux tout derniers jours de la Guerre d’Algérie, juste avant l’indépendance , il a disparu soudainement enlevé par un commando dont on comprendra très vite qu’il l’a assassiné avant de jeter son corps dans un puits —peut-être, ceci n’ayant jamais pu être prouvé. Cette scène terrible se passe à proximité d’un lieu où l’autrice enfant vivait alors avec ses parents. Il s’agit d’un village du Titteri, dans la steppe algérienne aux confins du désert, région de hauts plateaux où circulent des bergers arabes. La narratrice, qui est à la fois l’enfant de 1962 et l’écrivaine qui se remémore les faits après plusieurs décennies insiste sur le fait que cette famille juive était particulièrement bien intégrée au reste de la population et ne manquait pas de points communs, culturellement, avec les Arabes. Tous les gens du village où s’est passé le drame de l’enlèvement ont dit qu’ils n’y étaient pour rien. En fait, bien que la vérité n’arrive jamais à se faire complétement, on découvre assez vite que le crime a été commis par des hommes appartenant plus ou moins clairement au FLN, le groupe en train de prendre le pouvoir et se croyant tout permis, d’autant plus que les indépendantistes du village ont toujours été des Messalistes, groupe rival que le FLN a voulu combattre jusqu’à sa complète extermination.
Cette scène terrible se passe à proximité d’un lieu où l’autrice enfant vivait alors avec ses parents. Il s’agit d’un village du Titteri, dans la steppe algérienne aux confins du désert, région de hauts plateaux où circulent des bergers arabes. La narratrice, qui est à la fois l’enfant de 1962 et l’écrivaine qui se remémore les faits après plusieurs décennies insiste sur le fait que cette famille juive était particulièrement bien intégrée au reste de la population et ne manquait pas de points communs, culturellement, avec les Arabes. Tous les gens du village où s’est passé le drame de l’enlèvement ont dit qu’ils n’y étaient pour rien. En fait, bien que la vérité n’arrive jamais à se faire complétement, on découvre assez vite que le crime a été commis par des hommes appartenant plus ou moins clairement au FLN, le groupe en train de prendre le pouvoir et se croyant tout permis, d’autant plus que les indépendantistes du village ont toujours été des Messalistes, groupe rival que le FLN a voulu combattre jusqu’à sa complète extermination.
Sur les faits historiques qui entourent le drame familial, on n’a d’autre point de vue que celui de la narratrice, mais on voit bien qu’elle a voulu étayer son récit sur des informations recueillies après coup, d’ailleurs corroborées par nombre d’autres témoignages sur cette époque particulièrement troublée et dangereuse pour beaucoup de gens. Faute de pouvoir parler de son père autrement qu’à travers les souvenirs vagues, en partie rêvés et fantasmés par une petite enfant, la narratrice consacre la plus grande partie de son récit à la figure de la mère et nous la montre comme une femme particulièrement impressionnante du fait de son incroyable acharnement et obstination à vouloir reconnaître et faire reconnaître toute la vérité sur la mort de son mari. Il paraît impossible qu’elle n’ait pas cru à sa mort alors que toutes les sources officielles les plus fiables lui ont assuré le fait comme indubitable. Cependant, cette femme étonnante, pendant des mois, n’a pas cessé de réclamer le corps du disparu, seule preuve après laquelle on pourrait envisager la fin de l’enquête mais certainement pas auparavant. La narratrice elle-même a vu vivre sa mère à cette époque du fait qu’elle la suivait physiquement accrochée à elle dans tous les lieux où elle menait sa recherche jour après jour inlassablement. Et pourtant lorsqu’elle découvre les dossiers d’archives concernant la mort de son père, c’est-à-dire une vingtaine d’années plus tard, elle reste stupéfaite par le nombre incroyable de lettres envoyées par sa mère à toutes les instances imaginables pour répéter sa demande, on pourrait même dire sa supplique et réclamer les restes physiques de son mari, qu’elle considère comme son dû. Le récit dit la stupéfaction de son auteure, il ne s’engage pourtant que très peu dans l’explication du comportement maternel, sans doute parce que lorsque la quête a finalement cessé on n’en a plus parlé dans la famille. Et d’ailleurs la narratrice veut aussi restituer ce qu’étaient ses ignorances d’enfant, ou plus généralement ce qu’a été cette enfance si particulière et si étrange qu’elle a vécue. Pour le lecteur, elle parvient en effet à suggérer les bouleversements délirants des premiers temps ou de la première année de l’indépendance, pour tous ceux qui voyaient littéralement s’effondrer et disparaître ce qui avait été leur vie auparavant. Ainsi peut s’expliquer le besoin à la fois éperdu et opiniâtre de s’accrocher à une volonté devenue le seul élément stable d’une vie par ailleurs en pleine dérive. Si l’on était tenté de parler à propos de la mère d’une sorte de folie (obsessionnelle) il faudrait étendre ce concept de folie à la plupart des faits justifiant l’emploi du mot révolution pour dire l’état de l’Algérie à cette époque ; la narratrice en décrit d’ailleurs quelques aspects dans son livre. De manière assez remarquable elle n’accable personne , on est même étonné de l’accueil reçu par sa mère (et de ce qu’elle en sait par les dossiers d’archives) de la part des autorités qui auraient pu non sans raison avoir le sentiment qu’elle les harcelait : beaucoup ont essayé de l’aider et quand ils n’ont rien fait, c’est qu’il n’y avait rien à faire.
Le récit dit la stupéfaction de son auteure, il ne s’engage pourtant que très peu dans l’explication du comportement maternel, sans doute parce que lorsque la quête a finalement cessé on n’en a plus parlé dans la famille. Et d’ailleurs la narratrice veut aussi restituer ce qu’étaient ses ignorances d’enfant, ou plus généralement ce qu’a été cette enfance si particulière et si étrange qu’elle a vécue. Pour le lecteur, elle parvient en effet à suggérer les bouleversements délirants des premiers temps ou de la première année de l’indépendance, pour tous ceux qui voyaient littéralement s’effondrer et disparaître ce qui avait été leur vie auparavant. Ainsi peut s’expliquer le besoin à la fois éperdu et opiniâtre de s’accrocher à une volonté devenue le seul élément stable d’une vie par ailleurs en pleine dérive. Si l’on était tenté de parler à propos de la mère d’une sorte de folie (obsessionnelle) il faudrait étendre ce concept de folie à la plupart des faits justifiant l’emploi du mot révolution pour dire l’état de l’Algérie à cette époque ; la narratrice en décrit d’ailleurs quelques aspects dans son livre. De manière assez remarquable elle n’accable personne , on est même étonné de l’accueil reçu par sa mère (et de ce qu’elle en sait par les dossiers d’archives) de la part des autorités qui auraient pu non sans raison avoir le sentiment qu’elle les harcelait : beaucoup ont essayé de l’aider et quand ils n’ont rien fait, c’est qu’il n’y avait rien à faire.
Marie-Claude Akiba Egry évite dans son livre deux écueils, le misérabilisme et le folkore. Ce n’est pas le sort de juifs qui excite sa commisération et même lorsqu’elle parle de sa famille, elle ne met jamais en avant cet aspect-là de leurs tribulations. Plus généralement elle ne gémit pas sur le sort des rapatriés à leur retour en France et sur l’accueil souvent très réservé qui leur a été fait. Et pourtant elle ne joue pas pour les rendre sympathiques sur un certain folklore qui en son temps a eu beaucoup de succès. De toute façon, ce n’est pas la question du retour qui l’intéresse. Il se trouve que dans son cas c’est le moment où il lui faut sortir de l’enfance et trouver le moyen de le faire le plus possible normalement, après une sorte de plongée dans l’anormalité. Mieux vaudrait sans doute utiliser le terme d’un auteur africain (Wole Soyinka) confronté à la même période et au même dérèglement : « une saison d’anomie » disait-il. C’est face à cela que « l’enfant qui se taisait est condamnée au silence, jusqu’à ce que l’écriture prenne le relais de la parole pour lui permettre de s’exprimer.
Denise Brahimi
 L’auteur écrit à partir d’un certain nombre de questions qu’il n’a cessé de se poser et qui sont présentes en lui assez vite dans son enfance, c’est-à-dire dès la période algérienne de sa vie. Celle-ci commence en 1944, dans une Algérie dite française et qui le sera jusqu’en 1962, mais dès 1954 et avec une grande lucidité, le père du narrateur est convaincu que lui-même et toute sa famille devront affronter de grands changements, à commencer par le fait de quitter l’Algérie pour la France alors que d’emblée le narrateur nous a fait mesurer l’écart qu’ il y a pour lui entre les deux modes de vie associés à ces deux pays. On a compris dès la première ligne du livre que l’auteur est juif, ce qui est la source principale (mais pas unique) du problème dont son titre fait état : être dans « l’entre-deux », pour un Juif vivant en Algérie dans ce temps-là, veut dire n’être ni français ni arabe, et l’ambiguïté de la situation elle-même est redoublée du fait que le narrateur la vit tout à la fois sans la connaître mais en la connaissant implicitement. Ou bien encore pourrait-on dire qu’il la vit avec naturel mais sans doute avec une très vague conscience de son étrangeté.
L’auteur écrit à partir d’un certain nombre de questions qu’il n’a cessé de se poser et qui sont présentes en lui assez vite dans son enfance, c’est-à-dire dès la période algérienne de sa vie. Celle-ci commence en 1944, dans une Algérie dite française et qui le sera jusqu’en 1962, mais dès 1954 et avec une grande lucidité, le père du narrateur est convaincu que lui-même et toute sa famille devront affronter de grands changements, à commencer par le fait de quitter l’Algérie pour la France alors que d’emblée le narrateur nous a fait mesurer l’écart qu’ il y a pour lui entre les deux modes de vie associés à ces deux pays. On a compris dès la première ligne du livre que l’auteur est juif, ce qui est la source principale (mais pas unique) du problème dont son titre fait état : être dans « l’entre-deux », pour un Juif vivant en Algérie dans ce temps-là, veut dire n’être ni français ni arabe, et l’ambiguïté de la situation elle-même est redoublée du fait que le narrateur la vit tout à la fois sans la connaître mais en la connaissant implicitement. Ou bien encore pourrait-on dire qu’il la vit avec naturel mais sans doute avec une très vague conscience de son étrangeté.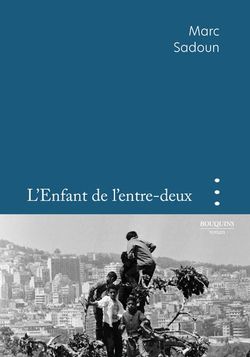 Lorsqu’une forme d’entre-deux vient d’être décrite, on s’aperçoit souvent qu’on est loin d’en avoir fini avec elle parce qu’elle ouvre la voie non pas certes à son propre démenti mais plutôt à une variation inattendue. Par exemple, au cœur de la famille, l’entre-deux auquel le jeune garçon est confronté, et qu’on pourrait dire le plus énorme et le plus évident qui soit, vient de l’appartenance différente de ses deux parents : père juif et maghrébin, mère française, champenoise et catholique, ce n’est pas pour le couple lui-même que l’affaire est compliquée car tout indique qu’ils s’entendent bien, mais elle l’est forcément pour leur fils qui se voit proposer des modèles si différents, opposant le bleu blanc imberbe au hâlé basané poilu. Si la mère est l’incarnation d’une Française de souche, ce qui ne peut manquer de causer chez son fils une prédilection ou un attirance pour les blondes, son père présente avantageusement divers attributs de la virilité maghrébine et les lui a légués. Au risque du cliché, l’entre-deux semble ici bien en place, en toute dualité mais … justement pas, car le hasard et les circonstances amèneront le narrateur à découvrir que le père de sa mère n’était pas celui qu’on croyait et que ce père biologique, un nommé Vidal, était Juif lui aussi !
Lorsqu’une forme d’entre-deux vient d’être décrite, on s’aperçoit souvent qu’on est loin d’en avoir fini avec elle parce qu’elle ouvre la voie non pas certes à son propre démenti mais plutôt à une variation inattendue. Par exemple, au cœur de la famille, l’entre-deux auquel le jeune garçon est confronté, et qu’on pourrait dire le plus énorme et le plus évident qui soit, vient de l’appartenance différente de ses deux parents : père juif et maghrébin, mère française, champenoise et catholique, ce n’est pas pour le couple lui-même que l’affaire est compliquée car tout indique qu’ils s’entendent bien, mais elle l’est forcément pour leur fils qui se voit proposer des modèles si différents, opposant le bleu blanc imberbe au hâlé basané poilu. Si la mère est l’incarnation d’une Française de souche, ce qui ne peut manquer de causer chez son fils une prédilection ou un attirance pour les blondes, son père présente avantageusement divers attributs de la virilité maghrébine et les lui a légués. Au risque du cliché, l’entre-deux semble ici bien en place, en toute dualité mais … justement pas, car le hasard et les circonstances amèneront le narrateur à découvrir que le père de sa mère n’était pas celui qu’on croyait et que ce père biologique, un nommé Vidal, était Juif lui aussi !
 Elle permet parfois de préciser certaines évolutions de manière saisissante, comme Francine Kahn le rappelle à la fin de son livre : « La communauté juive qui reste au Maroc aujourd’hui compte à peine 2400 juifs, la plupart regroupés à Casablanca, pour une population d’environ 300.000 personnes en 1953 ». Il y a de quoi parler comme elle le fait d’un monde englouti et l’on comprend qu’elle ait voulu, comme elle le fait, en recueillir les traces encore visibles et audibles pendant qu’il en est temps.
Elle permet parfois de préciser certaines évolutions de manière saisissante, comme Francine Kahn le rappelle à la fin de son livre : « La communauté juive qui reste au Maroc aujourd’hui compte à peine 2400 juifs, la plupart regroupés à Casablanca, pour une population d’environ 300.000 personnes en 1953 ». Il y a de quoi parler comme elle le fait d’un monde englouti et l’on comprend qu’elle ait voulu, comme elle le fait, en recueillir les traces encore visibles et audibles pendant qu’il en est temps. Pour s’en tenir au plurilinguisme judéo-marocain, la personne qui n’est pas spécialisée dans ce domaine est amenée à découvrir le nombre important de ce que l’auteur appelle des « judéolangues », qui toutes ont été pratiquées à l’occasion par des juifs marocains : judéo-arabe avec ses nombreuses variantes, selon le dialecte arabe sur lequel il vient se modeler, judéo-espagnol qui a été quantitativement le plus important , judéo-portugais etc.
Pour s’en tenir au plurilinguisme judéo-marocain, la personne qui n’est pas spécialisée dans ce domaine est amenée à découvrir le nombre important de ce que l’auteur appelle des « judéolangues », qui toutes ont été pratiquées à l’occasion par des juifs marocains : judéo-arabe avec ses nombreuses variantes, selon le dialecte arabe sur lequel il vient se modeler, judéo-espagnol qui a été quantitativement le plus important , judéo-portugais etc. propre histoire et celle de sa famille. L’objet central de notre Lettre étant le Maghreb et ses créations culturelles et artistiques, ces albums portant sur un récit à cheval entre la Syrie (et même un peu la Libye, au début) et la France n’ont pas a priori vocation à y figurer. Mais ne boudons pas en ce franchissement d’année le plaisir d’un pas de côté. Et puisque Ryad Sattouf a titré son opus « L’Arabe du futur » en mémoire de son père qui avait cette vision universaliste de l’entrée de l’homme arabe dans la modernité, cette histoire transcende les limites de la Syrie.
propre histoire et celle de sa famille. L’objet central de notre Lettre étant le Maghreb et ses créations culturelles et artistiques, ces albums portant sur un récit à cheval entre la Syrie (et même un peu la Libye, au début) et la France n’ont pas a priori vocation à y figurer. Mais ne boudons pas en ce franchissement d’année le plaisir d’un pas de côté. Et puisque Ryad Sattouf a titré son opus « L’Arabe du futur » en mémoire de son père qui avait cette vision universaliste de l’entrée de l’homme arabe dans la modernité, cette histoire transcende les limites de la Syrie. livre, la présence imaginaire du père, représenté dans des bulles rouges au dessus de la tête de Riad avec un visage intangible de jeune homme, ponctue les différentes étapes de sa vie, le plus souvent de manière critique ou ironique. Il faut dire que celui qui fut un jeune homme révolté, un peu anarchiste quand il vivait en France avec sa femme, est devenu légitimiste et religieux en revenant en Syrie, et l’écart entre père et fils ne cesse de s’élargir, mais cette tutelle imaginaire semble peser sur les épaules du jeune homme. Il lui faut un parcours auprès d’une psychothérapeute Jungienne pour se libérer progressivement des conflits de loyauté qui pèsent sur lui depuis son adolescence. Les scènes auprès de la thérapeute sont à la fois drôles par le portrait qu’il en fait et pénétrantes par la prise de conscience qu’elles lui permettent de nous livrer. Cette sincérité est profondément touchante, et c’est une dimension remarquable de ce livre, plus encore que dans les précédents albums.
livre, la présence imaginaire du père, représenté dans des bulles rouges au dessus de la tête de Riad avec un visage intangible de jeune homme, ponctue les différentes étapes de sa vie, le plus souvent de manière critique ou ironique. Il faut dire que celui qui fut un jeune homme révolté, un peu anarchiste quand il vivait en France avec sa femme, est devenu légitimiste et religieux en revenant en Syrie, et l’écart entre père et fils ne cesse de s’élargir, mais cette tutelle imaginaire semble peser sur les épaules du jeune homme. Il lui faut un parcours auprès d’une psychothérapeute Jungienne pour se libérer progressivement des conflits de loyauté qui pèsent sur lui depuis son adolescence. Les scènes auprès de la thérapeute sont à la fois drôles par le portrait qu’il en fait et pénétrantes par la prise de conscience qu’elles lui permettent de nous livrer. Cette sincérité est profondément touchante, et c’est une dimension remarquable de ce livre, plus encore que dans les précédents albums. Et en effet, on ferme ce livre avec émotion et une grande reconnaissance à l’auteur qui nous a donné avec sincérité sur plusieurs années à partager ce parcours chaotique familial, fait d’exils, de ruptures, de haines et de guerre, le tout vu à hauteur d’enfant, puis d’adolescent et d’homme, y mêlant un parcours d’apprentissage et d’initiation.
Et en effet, on ferme ce livre avec émotion et une grande reconnaissance à l’auteur qui nous a donné avec sincérité sur plusieurs années à partager ce parcours chaotique familial, fait d’exils, de ruptures, de haines et de guerre, le tout vu à hauteur d’enfant, puis d’adolescent et d’homme, y mêlant un parcours d’apprentissage et d’initiation.
 de Mouloud Feraoun, Tizi-Hibel). Et partout la même émotion et, pour nous, la fierté d’aider à faire connaitre ce témoignage irremplaçable qu’est ce Journal, tenu régulièrement entre le 1er novembre 1955 et le 14 mars 1962, veille de l’assassinat, par l’OAS, de son auteur, le seul écrivain connu de sa génération à avoir passé toute sa vie parmi les siens, partageant les mêmes dangers qu’eux, refusant jusqu’au bout les propositions qui lui étaient faites de quitter l’Algérie.
de Mouloud Feraoun, Tizi-Hibel). Et partout la même émotion et, pour nous, la fierté d’aider à faire connaitre ce témoignage irremplaçable qu’est ce Journal, tenu régulièrement entre le 1er novembre 1955 et le 14 mars 1962, veille de l’assassinat, par l’OAS, de son auteur, le seul écrivain connu de sa génération à avoir passé toute sa vie parmi les siens, partageant les mêmes dangers qu’eux, refusant jusqu’au bout les propositions qui lui étaient faites de quitter l’Algérie. Soixante ans plus tard, son Journal apparait comme la lente érection du tombeau de toutes les illusions : celle du discours « civilisateur », celle de l’impossible entente, celle d’un avenir réconcilié. Mais aussi comme une formidable leçon de courage intellectuel, un garde-fou pour aujourd’hui face à la toute-puissance de l’irrationnel, une parole irréductible à toutes les langues de bois d’où qu’elles viennent, dressée face à tous les silences, toutes les zones d’ombre qui pèsent encore » (1)
Soixante ans plus tard, son Journal apparait comme la lente érection du tombeau de toutes les illusions : celle du discours « civilisateur », celle de l’impossible entente, celle d’un avenir réconcilié. Mais aussi comme une formidable leçon de courage intellectuel, un garde-fou pour aujourd’hui face à la toute-puissance de l’irrationnel, une parole irréductible à toutes les langues de bois d’où qu’elles viennent, dressée face à tous les silences, toutes les zones d’ombre qui pèsent encore » (1)En France, il s’agissait de la faire mieux connaitre. En Algérie, de contribuer à lui donner sa juste place, loin de certains reproches diffusés par les discours officiels. De fait,

Photo datée de 1957 de l’écrivain kabyle Mouloud Feraoun. Né en 1913 à Tizi Hibel, il sera directeur des Centres sociaux d’El Biar en 1960 fondés par Germaine Tillion. Ecrivain et humaniste, il est l’auteur entre autre du « Fils des Pauvres ». Il est assassiné par un commando de l’OAS en 1962. (Photo by STAFF / AFP)
l’adhésion de Feraoun à la cause de l’indépendance a été trop progressive et surtout trop nuancée pour lui permettre de figurer au premier rang des « héros de la libération ». Si Le Fils du pauvre, son œuvre la plus célèbre, figure en édition de poche dans « toutes les bonnes librairies d’Alger », son Journal, lui, sans être interdit, reste quasiment introuvable. Feraoun, homme irrécupérable, reste un gêneur pour le pouvoir en place depuis 1962.

Dominique Lurcel
(c)Essaion
On reconnaît désormais, que les doutes de Feraoun étaient davantage puisés dans la lucidité sur les conditions de la lutte pour l’indépendance, que dans une foi patriotique supposée friable. Si Mouloud Feraoun a été le fruit de l’école française parce qu’il n’était pas possible de faire autrement à l’époque, si en tant qu’instituteur il a immanquablement baigné dans l’univers scolaire français avec ses auteurs et ses références, il n’a jamais pour autant été « assimilé ». Ni dans sa vie privée qui était celle d’un instituteur kabyle, kabyle avant d’être instituteur d’ailleurs, ni dans sa vie d’auteur. Quel « assimilé » aurait pu écrire « Le fils du pauvre », voyons !

« RESTE UN PEU », film de Gad El Maleh avec Gad El Maleh, 2022
 Le film aborde la question de la ou des religions : que signifie le fait d’appartenir à l’une d’elle et peut-on en changer ? Le héros Gad qui est né dans la religion juive découvre à l’âge de 50 ans (mais il le pressentait depuis longtemps) qu’il préférerait être catholique et qu’il souhaite se convertir au culte de la Vierge Marie pour être en accord avec lui-même. Cependant une partie de ce « lui-même » est profondément marquée par son milieu familial qui est juif sépharade et pour lequel le catholicisme est impensable, frappé d’un insurmontable interdit. Gad ne peut rompre avec ses parents, il les aime et voudrait les convaincre, alors qu’il n’ose même pas leur avouer ce projet de conversion qu’il est pourtant venu leur dire, après des années passées aux Etats-Unis. Pour tous les siens autre que lui , la religion juive est une appartenance communautaire, elle définit entièrement la vie de celui qui s’y trouve par naissance et ne peut aucunement mettre ce fait en question. En revanche, pour Gad, la religion n’est pas une appartenance obligatoire, elle est une question de foi et donc de choix personnel, ce qui implique une recherche en vue d’un engagement motivé. C’est un long chemin à parcourir et dont il n’ignore pas les difficultés, il a pourtant la conviction de vouloir s ‘y engager mais dans la mesure où il s’agit de vie intérieure, il ne peut s’appuyer sur des certitudes absolues, d’autant que les chrétiens dont il se sent proche, à la différence de sa famille juive, ne cherchent aucunement à l’influencer pour l’attirer à eux mais lui laissent au contraire son entière liberté de choix. Jusqu’à la fin du film, la question reste posée : va-t-il définitivement franchir le pas et se faire baptiser chrétien (au sens propre et premier du mot baptême, à l’image de ce que fut celui du Christ) ?
Le film aborde la question de la ou des religions : que signifie le fait d’appartenir à l’une d’elle et peut-on en changer ? Le héros Gad qui est né dans la religion juive découvre à l’âge de 50 ans (mais il le pressentait depuis longtemps) qu’il préférerait être catholique et qu’il souhaite se convertir au culte de la Vierge Marie pour être en accord avec lui-même. Cependant une partie de ce « lui-même » est profondément marquée par son milieu familial qui est juif sépharade et pour lequel le catholicisme est impensable, frappé d’un insurmontable interdit. Gad ne peut rompre avec ses parents, il les aime et voudrait les convaincre, alors qu’il n’ose même pas leur avouer ce projet de conversion qu’il est pourtant venu leur dire, après des années passées aux Etats-Unis. Pour tous les siens autre que lui , la religion juive est une appartenance communautaire, elle définit entièrement la vie de celui qui s’y trouve par naissance et ne peut aucunement mettre ce fait en question. En revanche, pour Gad, la religion n’est pas une appartenance obligatoire, elle est une question de foi et donc de choix personnel, ce qui implique une recherche en vue d’un engagement motivé. C’est un long chemin à parcourir et dont il n’ignore pas les difficultés, il a pourtant la conviction de vouloir s ‘y engager mais dans la mesure où il s’agit de vie intérieure, il ne peut s’appuyer sur des certitudes absolues, d’autant que les chrétiens dont il se sent proche, à la différence de sa famille juive, ne cherchent aucunement à l’influencer pour l’attirer à eux mais lui laissent au contraire son entière liberté de choix. Jusqu’à la fin du film, la question reste posée : va-t-il définitivement franchir le pas et se faire baptiser chrétien (au sens propre et premier du mot baptême, à l’image de ce que fut celui du Christ) ?
1-©-Laura-Gilli
Donc le réalisateur Gad El Maleh n’oublie jamais, surtout pas, qu’il est acteur et humoriste, et c’est à partir de là qu’il faut poser la question de la sincérité, cette énigme du film qui préoccupe beaucoup le public si l’on en juge par nombre de réactions et qui n’a aucune chance d’être résolue simplement par oui ou par non, puisque, comme il l’a expliqué lui-même, l’auteur du film lui-même n’a justement pas voulu qu’il se résume à cette question. Il rappelle très justement qu’on ne l’a pas posée pour ses autres personnages, « Chouchou »(2003) par exemple, ou « Coco »(2009), où l’on comprend très bien qu’il s’agit d’un travail d’acteur. Dans « Reste un peu » il joue en tant qu’acteur le rôle d’un homme dont le trait principal est de vouloir être sincère avec lui-même, et l’on ne peut nier en effet que le personnage arrive à nous convaincre de sa sincérité ; nous subissons notamment l’efficacité des gros plans qui nous mettent en contact direct avec son visage et ses yeux : leur émouvante transparence semble supprimer toute possibilité de distance entre lui et nous.
 naïfs, et pas cyniques non plus. Gad El Maleh fait preuve dans ce film d’une remarquable habileté et finalement, comme on peut voir à la fin, il nous laisse face à son absence de choix : toujours tenté par la Vierge Marie mais reculant devant le caractère définitif du baptême (on dirait qu’il n’arrive pas à sentir celui-ci comme pleinement conforme à ses aspirations) ; quittant finalement une famille moins irréductible peut-être mais toujours aussi impropre à accepter une autre voie que la sienne ; partageant équitablement son humour entre les deux camps, car s’il est certain qu’il déplore la fermeture totale de la communauté sépharade à tout autre chose qu’elle-même, la communauté monastique dont il fait l’essai le met presque immédiatement en fuite et c’est un moment drôle du récit. A l’inverse, il trouve partout des gens merveilleux qui le comprennent, parce qu’ils sont bons et intelligents mais finalement, et c’est bien dommage, il constate que cela ne suffit pas à résoudre les problèmes, ses problèmes : ceux-là, chacun les garde pour soi et en fait ce qu’il peut, par exemple un excellent film, si on connaît le métier.
naïfs, et pas cyniques non plus. Gad El Maleh fait preuve dans ce film d’une remarquable habileté et finalement, comme on peut voir à la fin, il nous laisse face à son absence de choix : toujours tenté par la Vierge Marie mais reculant devant le caractère définitif du baptême (on dirait qu’il n’arrive pas à sentir celui-ci comme pleinement conforme à ses aspirations) ; quittant finalement une famille moins irréductible peut-être mais toujours aussi impropre à accepter une autre voie que la sienne ; partageant équitablement son humour entre les deux camps, car s’il est certain qu’il déplore la fermeture totale de la communauté sépharade à tout autre chose qu’elle-même, la communauté monastique dont il fait l’essai le met presque immédiatement en fuite et c’est un moment drôle du récit. A l’inverse, il trouve partout des gens merveilleux qui le comprennent, parce qu’ils sont bons et intelligents mais finalement, et c’est bien dommage, il constate que cela ne suffit pas à résoudre les problèmes, ses problèmes : ceux-là, chacun les garde pour soi et en fait ce qu’il peut, par exemple un excellent film, si on connaît le métier.
Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.
 – Utiles
– Utiles
de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun
Cliquez ici pour voir le film et le mot de passe utilesjoussour

–Entre nos mains
de Leila Saadna
Cliquez ici pour voir le film, puis mot de passe utilesjoussour
Et sa bande-annonce, cliquez ici

Si vous souhaitez aider notre association régionale à développer ses actions, vous avez aussi la possibilité de faire un DON, via Hello Asso. Soyez-en remercié.e.s.
Si vous souhaitez vous investir à nos côtés, nous serions heureux d’accueillir votre adhésion. Il vous est possible de le faire en ligne sur notre site via Hello Asso.

Vous pouvez aussi nous commander notre livre « Algérie à coeur » en envoyant un chèque de 16€, port compris,
chez Michel Wilson 5 rue Auguste Comte 69002 LYON.
Et également vous avez la possibilité de souscrire en ligne sur notre site à l’ultime numéro de la Revue Le Croquant, un hommage à son créateur Michel Cornaton, que nous avons co-édité.
Nous souhaitons aussi contribuer à la diffusion du livre posthume de notre cher Abdelhamid LAGHOUATI, poète, artiste plasticien, ami de Jean Sénac et de tant d’autres. Une souscription est ouverte pour commander son livre par la Maison de la Poésie Rhône-Alpes à Saint Martin d’Hères.
SOUSCRIPTION
BON DE COMMANDE
Je commande .. .. .. .. exemplaire(s) de « Entre cri et passion » de Abdelhamid Laghouati.
Je règle par : ☐ chèque bancaire
☐ autre moyen (sauf carte bancaire)
☐ postal
À l’ordre de :
Maison de la Poésie Rhône-Alpes
33 avenue Ambroise Croizat
38400 Saint-Martin-d’Hères
Date : .. .. / .. .. / .. .. Signature :

- Du 11 au 18 janvier, nous accompagnons une tournée du film « Sous les figues » de Erige SEHIRI sur la région Auvergne Rhône-Alpes, en présence de la réalisatrice. Tournée organisée avec le GRAC et l’ACRIRA, une collaboration Maghreb des Films en Rhône-Alpes/Coup des Soleil en Auvergne-Rhône-Alpes
- Mercredi 11 janvier à 19h au cinéma L’Opéra de Lyon film « Sous les figues » en présence de la réalisatrice
- Jeudi 12 janvier à 20h au cinéma Le Méliès de Caluire et Cuire « Sous les figues »en présence de la réalisatrice
- Jeudi 13 janvier à 14h (scolaires) puis à 18h au cinéma Le Club de Nantua « Sous les figues »en présence de la réalisatrice
- Samedi 14 janvier à 20h au Cinéma Mon Ciné de Saint-Martin d’Hères « Sous les figues »en présence de la réalisatrice
- Mercredi 18 janvier à 20h Salle Gérard Philippe à Vénissieux « Sous les figues »en présence de la réalisatrice
- Vendredi 13 janvier à 18h puis 20h30 au cinéma associatif de Charlieu intervention après la projection des films Moudjahidates et Le coup de sirocco, coopération entre Au fil du temps, ANPNPA et Coup de Soleil AuRA
- Jeudi 19 janvier à 19h, à l’IFCM de Lyon, projection du film « Gardien des mondes » de Leila Chaibi en présence de la réalisatrice
- mercredi 1er février, à 19h au cinéma Opéra de Lyon projection du film « Reinette l’oranaise, le port des amours » de Jacqueline Gozland, en présence de la réalisatrice
- Jeudi 2 février, à l’Hôtel de Ville de Lyon 10h/18h « Juifs d’Algérie, une mémoire qui (en)chante », histoire, mémoires, témoignages, extraits de films, gastronomie…
N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.