Editorial
Les activités de Coup de soleil et ses centres d’intérêt sont décidément très multiples. Et nous tenons beaucoup à cette diversité, pour que des lecteurs aussi différents que possible trouvent leur compte à la lecture de La Lettre. Cependant nous espérons ne jamais céder à une sorte de démagogie qui nous ferait choisir des textes ou des spectacles en fonction de leur facilité d’accès. Et en tout cas, ce n’est pas de cela que sont suspects les deux premiers textes que nous évoquons, dont les sujets sont éminemment sérieux. L’un traite de l’ibadisme, que certains découvriront peut-être à cette occasion (ils ne le regretteront pas), l’autre de la prison de Montluc dont les Lyonnais ont forcément entendu parler, en plusieurs circonstances historiques.
Côté romans, nous en proposons trois, dont l’un est « Saara » le dernier de ce grand auteur mauritanien, Beyrouk, que nous suivons depuis longtemps déjà, avec une fidèle admiration. L’autre qui se situe à Tanger, est une évocation plaisante et bien informée de cette ville et nous y ajouterons le roman d’une Suissesse, « La nièce du Taxidermiste » qui a séduit l’un de nos collaborateurs occasionnels, Claude Bataillon.
Le film de ce mois-ci connaît un beau succès en salle, c’est une comédie intitulée « Youssef Salem a du succès ».
Non seulement Michel Wilson ne nous a pas oubliés mais il nous parle cette fois-ci d’un spectacle théâtral vu à Lyon, qui s’intitule « Mémoires collectées ».
Denise Brahimi
Peut-être souhaitez-vous faire un don à notre association, pour contribuer à notre fonctionnement? Et notamment au coût de réalisation de cette Lettre?
Vous en avez la possibilité en cliquant ICI. Merci d’avance et joyeuses fêtes!

« L’ARCHIPEL IBADITE, UNE HISTOIRE DES MARGES DU MAGHREB MEDIEVAL », par Cyrille Aillet, CIHAM éditions Lyon Avignon 2021
Que nos lecteurs ne soient pas inquiets : le Maghreb médiéval leur paraîtra peut-être un monde aussi lointain qu’obscur et pour comble voilà que l’auteur de ce livre annonce son intention de l’aborder par ses marges, ce qui pourrait ajouter une complication supplémentaire au savoir couramment reçu sur cette période et sur ces lieux. Or ce qui s’impose en premier lieu est une bonne surprise : s’il est vrai que l’auteur de ce travail est d’une minutie extrême et d’un savoir considérable, il est aussi d’une très grande lisibilité, sans doute par la clarté de son écriture et par l’organisation des chapitres, permettant à chaque fois de rebondir et d’enchaîner les faits marquants qui caractérisent l’ibadisme. Ce courant qui paraît aujourd’hui minoritaire et peu représenté ne l’a pas toujours été et ses caractéristiques sont suffisamment intéressantes pour qu’on ait envie de s’y attarder.  L’ibadisme est certainement une des trois composantes du Maghreb médiéval (et tel qu’il s’est prolongé plus ou moins visiblement jusqu’à la période coloniale) incontestablement original par rapport au sunnisme et au chiisme. C’est ici que la notion de marges qui figure au titre du livre doit retenir notre attention. S’il est vrai que l’histoire est souvent racontée par les représentants du courant dominant (à la fois dans l’espace et dans le temps) il y a grand intérêt à renverser cette lecture et à souligner l’existence de divergences notables par rapport à eux , sachant qu’en toute logique ces tendances différentes doivent bien avoir laissé quelques traces contribuant à la complexité d’un monde partiellement oubliée ou occultée.
L’ibadisme est certainement une des trois composantes du Maghreb médiéval (et tel qu’il s’est prolongé plus ou moins visiblement jusqu’à la période coloniale) incontestablement original par rapport au sunnisme et au chiisme. C’est ici que la notion de marges qui figure au titre du livre doit retenir notre attention. S’il est vrai que l’histoire est souvent racontée par les représentants du courant dominant (à la fois dans l’espace et dans le temps) il y a grand intérêt à renverser cette lecture et à souligner l’existence de divergences notables par rapport à eux , sachant qu’en toute logique ces tendances différentes doivent bien avoir laissé quelques traces contribuant à la complexité d’un monde partiellement oubliée ou occultée.
Au risque d’être sommaire, on peut dire que la période où l’ibadisme s’est épanoui dans certaines régions du Maghreb s’étend à peu près du 8e au 13e siècle, et que son apogée a pris la forme d’un Etat centré sur la ville de Tiaret dans l’Algérie actuelle. C’est surtout parmi les populations berbères qu’il s’est développé, nous aidant à définir encore aujourd’hui ce qui pourrait bien être le propre de leurs aspirations spirituelles et de leur organisation sociale. Les traces qu’il en reste encore aujourd’hui se sont maintenues principalement dans trois régions du Maghreb contemporain, Djerba, le Mzab et le djebel Nafusa (en Tripolitaine, région située aux confins de la Tunisie et de la Libye). On ne peut donner qu’une très faible idée des originalités qui ont caractérisé l’ibadisme et sans doute les choisissons-nous parce que la période la plus contemporaine, celle que nous vivons, est justement à la recherche d’alternatives qui pourraient nous aider à trouver une définition de l’Etat et de ses pratiques moins contraignante, moins coercitive et moins centralisée que celles qui dominent dans le Maghreb actuel.
On ne peut donner qu’une très faible idée des originalités qui ont caractérisé l’ibadisme et sans doute les choisissons-nous parce que la période la plus contemporaine, celle que nous vivons, est justement à la recherche d’alternatives qui pourraient nous aider à trouver une définition de l’Etat et de ses pratiques moins contraignante, moins coercitive et moins centralisée que celles qui dominent dans le Maghreb actuel.
Les ibadites au long de leur histoire et malgré le caractère dispersé de leur implantation ont été souvent les acteurs d’une dissidence que certains considéreront peut-être comme typiquement maghrébine par rapport à des formes d’autorité définies en Orient. S’il est vrai qu’il faut employer le terme « démocratie » avec d’infinies précautions et en référence avec des pratiques politiques très précises, on peut cependant être tenté de l’utiliser à propos de l’ibadisme, qui a conçu le pouvoir comme électif et collégial, opposé à toute tyrannie centralisatrice.
Denise Brahimi
« UNE PRISON POUR MEMOIRE MONTLUC, DE 1944 A NOS JOURS » par Marc André, ENS éditions, 2022
On est très impressionné par l’extrême minutie du travail universitaire qui a donné lieu à ce livre (572 pages, c’est une somme !), absolument impeccable par la rigueur de sa méthode et de sa présentation. Certes, ce livre d’histoire suit globalement une chronologie en trois périodes, mais il se veut avant tout une réflexion et pas seulement le retour sur des narrations et des récits historiques de faits plus ou moins connus (la plupart le sont).  C’est plutôt l’enchaînement entre les parties qui a retenu l’attention de l’auteur et il est vrai que le sujet abordé, à certains égards, peut passer pour exemplaire , notamment sur le rôle de la mémoire en histoire. Au lieu que le livre se présente comme une succession de trois moments bien distincts (ceux-ci ayant réellement existé avec des caractéristiques indéniables), il évoque plutôt le glissement de chacun vers les autres et les effets produits par cette sorte de palimpseste et de superposition, le mot palimpseste étant employé par Marc André pour suggérer la porosité de l’histoire toujours plus ou moins empreinte de ce qui précède d’où la difficulté extrême d’en finir avec quoi que ce soit.
C’est plutôt l’enchaînement entre les parties qui a retenu l’attention de l’auteur et il est vrai que le sujet abordé, à certains égards, peut passer pour exemplaire , notamment sur le rôle de la mémoire en histoire. Au lieu que le livre se présente comme une succession de trois moments bien distincts (ceux-ci ayant réellement existé avec des caractéristiques indéniables), il évoque plutôt le glissement de chacun vers les autres et les effets produits par cette sorte de palimpseste et de superposition, le mot palimpseste étant employé par Marc André pour suggérer la porosité de l’histoire toujours plus ou moins empreinte de ce qui précède d’où la difficulté extrême d’en finir avec quoi que ce soit.
La date de départ, 1944, est la fin de la deuxième guerre mondiale, et puisque c’est de la forteresse de Monluc qu’il est question, cette date est donc aussi la fin de l’utilisation de ce lieu comme prison par la Gestapo ou police de l’Etat nazi en France. Evidemment, après la chute de l’Etat nazi, il ne sera plus question d’enfermer les résistants à Montluc mais le travail de Marc André consiste à faire comprendre que pour autant cette signification du lieu est loin d’ être abolie ; et l’on peut même dire que toute une partie de son livre, des plus intéressants et originaux à cet égard, est de montrer qu’il y aura persistance d’une mise en rapport entre les murs de Montluc et la résistance à l’oppression. En effet, la deuxième étape du parcours historique suivi aboutit à une concentration des événements et des mises en question en pleine guerre d’Algérie et aux moments où la répression exercée par l ‘armée française sur la rébellion clandestine des Algériens se montre particulièrement sévère voire meurtrière : 1958-1962. Pour les lecteurs de Marc André le livre est très riche d’informations sur la manière dont les Algériens en France entendent faire avancer leur cause à leurs risques et périls évidemment. Et c’est ici que pour de nombreux Français en principe peu impliqués dans les péripéties de la guerre d’Algérie, la signification prégnante du nom même de Montluc et de ses murailles se trouve réactivée. Bien avant même que l’expression « lieu de mémoire » ait été inventée (on l’attribue généralement à l’éditeur Pierre Nora et à une célèbre collection, datée des années 1980 à 1990), on parlait couramment de « lieux de sinistre mémoire », ce qui pouvait tout à fait être le cas pour le fort de Montluc, tant il est vrai que le souvenir de la Gestapo et de ses méthodes n’était pas des plus faciles à éradiquer.
En effet, la deuxième étape du parcours historique suivi aboutit à une concentration des événements et des mises en question en pleine guerre d’Algérie et aux moments où la répression exercée par l ‘armée française sur la rébellion clandestine des Algériens se montre particulièrement sévère voire meurtrière : 1958-1962. Pour les lecteurs de Marc André le livre est très riche d’informations sur la manière dont les Algériens en France entendent faire avancer leur cause à leurs risques et périls évidemment. Et c’est ici que pour de nombreux Français en principe peu impliqués dans les péripéties de la guerre d’Algérie, la signification prégnante du nom même de Montluc et de ses murailles se trouve réactivée. Bien avant même que l’expression « lieu de mémoire » ait été inventée (on l’attribue généralement à l’éditeur Pierre Nora et à une célèbre collection, datée des années 1980 à 1990), on parlait couramment de « lieux de sinistre mémoire », ce qui pouvait tout à fait être le cas pour le fort de Montluc, tant il est vrai que le souvenir de la Gestapo et de ses méthodes n’était pas des plus faciles à éradiquer.
A partir du moment où Montluc a de nouveau servi de prison et notamment pour les combattants algériens de l’indépendance, sans parler des activistes français engagés à leurs côtés, l’armée qui gère les arrestations et les emprisonnements n’a certes rien à voir avec celle qui auparavant permettait aux nazis d’exprimer leur pouvoir sur la France —sinon pourtant qu’on ne peut éviter des points communs entre les formes de répression. Et d’ailleurs des faits singuliers vont eux-mêmes dans le sens de divers rapprochements forcément choquants ; c’est le cas lorsqu’un ancien détenu de la Gestapo se trouve à nouveau en position de détenu mais cette fois du fait de la répression exercée par une armée bien française, qui se glorifie de défendre la France contre la subversion.
La date de 1962, qui met fin à cette deuxième période recouverte par le livre, ne permet pas d’en finir loin de là, avec toutes les ambiguïtés de la répression exercée par le pouvoir d’Etat.
Et le moins qu’on puisse dire est que militairement, la situation de l’Etat français n’est pas confortable, lorsque très officiellement s’achève la guerre d’Algérie. Le livre de Marc André ne prétend évidemment pas entrer dans le détail des derniers sursauts de l’OAS finalement voués à l’écrasement, mais la prison de Montluc va à nouveau jouer son rôle dans cette affaire, sans que l’image de ses murailles se simplifie une fois pour toute ou s’unifie.
Non seulement l’histoire reste inscrite sous la trame des faits, et réapparaît comme le montre l’image du palimpseste, mais elle peut aussi refaire surface encore bien plus clairement et directement ,comme ce fut le cas en 1983 et 1987 dans l’histoire des procès et détentions de Klaus Barbie. Or, malgré l’évidence massive de la condamnation subie par ce dernier, on ne peut prétendre, ce qui est assez paradoxal, que toute personne de bonne foi se soit ralliée à une interprétation univoque des faits. Il semble qu’il soit impossible d’éliminer tout espèce de trouble ou de gêne lorsque se trouve évoqué et rappelé dans les mémoires le droit exercé par l’Etat d’emprisonner en son nom—et le livre de Marc André fait bien comprendre pourquoi : nombreux ont été les revirements de sens pris par ces emprisonnements et par la définition même de l’Etat, c’est-à-dire des valeurs qu’il défend.
D’une certaine façon, lorsque Montluc a cessé d’être une prison pour devenir un Mémorial (2009-2010), on aurait pu y voir une manière de baisser les bras, c’est-à-dire de renoncer à tirer au clair ce qu’il en est du droit à l’emprisonnement pour raison d’Etat. Cependant un Mémorial lui aussi a besoin d’être défini par son sens, et Marc André montre bien que ce n’est ni plus évident ni plus facile de délimiter (ou pas) celui-ci que le sens d’une prison. Prison ou mémorial, Montluc envoie des signes, spectaculaires et impressionnants …mais pas forcément très clairs : faire signe, c’est déjà beaucoup, signe de quoi : il faut laisser la réponse à chacun.
Denise Brahimi
« SAARA » par Beyrouk, roman, éditions Elyzad, 2022
Les lecteurs fidèles de « La Lettre » de Coup de soleil connaissent déjà Beyrouk, grand écrivain mauritanien, et retrouveront dans ce dernier roman (à la magnifique couverture) ses thèmes habituels, sous une forme sans doute plus violente (faut-il dire moins nuancée) que dans les précédents.
Comme d’habitude et de manière plus tranchée que jamais, il y est question des différentes composantes de la société mauritanienne, malheureusement incompatibles, en sorte que certaines apparaissent ici comme vouées à la disparition. Les formes traditionnelles (ce qui ne veut aucunement dire réactionnaires, car on voit dans le livre qu’elles seraient au contraire susceptibles de s’adapter si elles ne subissaient d’insupportables pressions) ne sont d’ailleurs pas d’un seul modèle et les deux 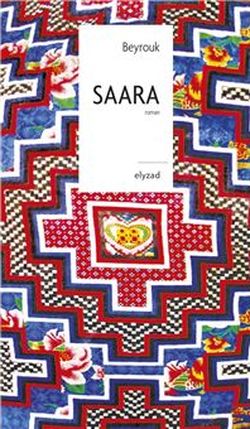 personnages principaux de « Saara » sont la preuve qu’il y en a au moins deux, incarnés l’un par Saara , superbe femme magnifique et libre, et l’autre par le Cheikh, qui se trouve à la tête d’une petite société de croyants attachée au territoire d’une oasis appelée Louad, hors de laquelle elle ne saurait vivre. Sans que l’auteur intervienne directement pour donner son opinion sur cette dualité, on sent bien que son désir profond est une conciliation entre ces deux tendances, qui dans le livre prendrait la forme d’un amour réciproque entre ces deux personnages, aussi séduisants l’un que l’autre pour des raisons bien différentes mais compatibles — c’est du moins ce que l’auteur veut croire. Le malheur des temps veut que ce rapprochement n’ait lieu qu’in extremis dans le livre, alors que l’un et l’autre sont expulsés de Louad comme des proscrits et voués à disparaître par les nouveaux maîtres des lieux qui les traitent sans ménagement—c’est un euphémisme, mieux vaudrait dire avec une implacable et inhumaine férocité.
personnages principaux de « Saara » sont la preuve qu’il y en a au moins deux, incarnés l’un par Saara , superbe femme magnifique et libre, et l’autre par le Cheikh, qui se trouve à la tête d’une petite société de croyants attachée au territoire d’une oasis appelée Louad, hors de laquelle elle ne saurait vivre. Sans que l’auteur intervienne directement pour donner son opinion sur cette dualité, on sent bien que son désir profond est une conciliation entre ces deux tendances, qui dans le livre prendrait la forme d’un amour réciproque entre ces deux personnages, aussi séduisants l’un que l’autre pour des raisons bien différentes mais compatibles — c’est du moins ce que l’auteur veut croire. Le malheur des temps veut que ce rapprochement n’ait lieu qu’in extremis dans le livre, alors que l’un et l’autre sont expulsés de Louad comme des proscrits et voués à disparaître par les nouveaux maîtres des lieux qui les traitent sans ménagement—c’est un euphémisme, mieux vaudrait dire avec une implacable et inhumaine férocité.
La société traditionnelle n’était pas violente, elle cherchait à faire vivre les gens dans la paix du corps et de l’esprit, l’idéal de Saara, pour laquelle l’auteur a décidément beaucoup de tendresse, est que chacun autour d’elle vive dans une jouissance qu’elle est toujours prête à partager généreusement. Il y a sans aucun doute plus d’austérité chez le Cheikh, cependant il ne va pas aussi loin qu’un petit groupe (qu’il respecte) de croyants qui s’est retiré en marge de l’oasis pour vivre dans l’oubli du corps et se consacrer entièrement à la foi. Le Cheikh est un beau personnage parce qu’il concilie parfaitement la religion dont on l’a fait un peu malgré lui le représentant et ce qu’on appellerait en termes plus laïcs et pas nécessairement religieux un humanisme respectueux des choix de vie que chacun doit pouvoir faire librement. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il se trouve pris entre des aspirations variées qui le laissent impuissant contre les agressions de forces très supérieures et brutales. Ces dernières sont d’autant plus imparables qu’elles prétendent représenter l’Etat moderne et sa marche inexorable vers l’avant.
Face à ce qu’on appelle la modernité, la position représentée par le cheikh et les siens (très petit groupe qu’il est facile de considérer comme quantité négligeable) est d’ailleurs très nuancée parce qu’elle est chaque fois et longuement réfléchie. C’est ainsi qu’est acceptée la proposition de créer une école publique (bien que les enfants de l’oasis bénéficient déjà d’un enseignement) parce qu’on peut en attendre du bien, alors qu’en revanche, le petit groupe attaché à l’oasis de Louad refuse avec une entière fermeté le projet dont les autorités l’informent (sans aucune manière lui demander son avis ni le consulter).
C’est le projet de construire un barrage qui évidemment détruirait complétement l’ancienne manière de vivre dans l’oasis et dont les habitants constatent qu’ils n’ont aucun besoin. D’emblée il apparaît que les arguments des modernistes (qui ont toutes les apparences flatteuses d’un plaidoyer en faveur du progrès) sont d’une grande mauvaise foi et qu’en fait il s’agit uniquement d’une affaire d’argent, de profit etc. Bref, ce qu’on connaît de longue date comme la manifestation du capitalisme au service des seuls intérêts privés et sans le moindre souci de l’intérêt général pour reprendre des formules consacrées —mais ici parfaitement adaptées à ce que veut montrer le roman de Beyrouk. Ce n’est donc pas celui-ci qui manque de nuances mais une situation déjà si souvent constatée, analysée, et dénoncée le plus souvent en vain. En tout cas, on a vite fait de comprendre que dans l’oasis, toute tentative est d’avance écrasée. Reste l’initiative individuelle, ici celle d’un mendiant longuement humilié par les riches et décidé à se venger d’eux (en provoquant un énorme incendie qui détruit une partie de leurs biens). On comprend son amère satisfaction—amère parce qu’elle ne répare rien de ce que lui-même et sa mère ont vécu. Ce n’est évidemment pas une solution acceptable et elle n’est pas conforme à l’esprit du roman, qui est un magnifique plaidoyer pour la douceur et la non violence. Mais « Saara » est aussi le constat que celles-ci n’ont aucune chance dans le monde tel qu’il est, ou tel qu’il est en train de devenir même dans des lieux qui semblaient réunir toutes les conditions pour y échapper.
Reste l’initiative individuelle, ici celle d’un mendiant longuement humilié par les riches et décidé à se venger d’eux (en provoquant un énorme incendie qui détruit une partie de leurs biens). On comprend son amère satisfaction—amère parce qu’elle ne répare rien de ce que lui-même et sa mère ont vécu. Ce n’est évidemment pas une solution acceptable et elle n’est pas conforme à l’esprit du roman, qui est un magnifique plaidoyer pour la douceur et la non violence. Mais « Saara » est aussi le constat que celles-ci n’ont aucune chance dans le monde tel qu’il est, ou tel qu’il est en train de devenir même dans des lieux qui semblaient réunir toutes les conditions pour y échapper.
Y aura-t-il encore des oasis dans le monde dit moderne dont l’emprise semble inéluctable ? Le dernier livre de Beyrouk nous dit qu’il n’y croit pas ou qu’il n’y croit plus. Mais on sait aussi tout ce que la littérature gagne à la nostalgie, lorsqu’elle se penche sur ce qui fut la beauté des mondes perdus.
Denise Brahimi
« L’HOMME DE TANGER », roman policier de Gilles Gauthier, éditions Riveneuve, 2023
Quelle bonne idée d’avoir traité ce sujet sous la forme d’un roman policier, avec des personnages innocents ou presque et d’autres au contraire très méchants qui poursuivent les précédents avec les pires intentions. Comme il y a des policiers et même de haut grade des deux côtés, on ne peut accuser l’auteur de la démagogie facile qui consiste à accuser les représentants de l’Etat de tous les maux tandis que la pègre et les hors la loi rayonneraient par la justesse de leur cause. De toute façon le roman n’est pas chargé d’intentions politiques, il est même probable qu’il revendique son titre de « policier »pour signifier d’emblée que son but n’est pas de véhiculer un discours idéologique.
Le sentiment le plus fort qui se dégage du livre concerne la ville de Tanger et c’est un sentiment d’amour pour cette ville, bien qu’elle ne soit l’objet d’aucune idéalisation.  L’auteur prend soi de bien situer son roman dans le temps, pour éviter toute confusion : il ne s’agit plus du Tanger que certains diraient sans doute « de la Belle époque », lorsque le statut international de la ville en avait fait un brillant « melting pot » (creuset), lieu de rencontre de personnages originaux et séduisants voire fascinants, dont beaucoup étaient des écrivains ou des artistes. La ville ayant désormais perdu ce statut singulier depuis 1956 du fait de son rattachement au Maroc devenu indépendant, elle garde certes quelques traces de ce statut exceptionnel ou même quelques présences, mais plus discrètes qu’auparavant. L’auteur nous offre une galerie de personnages étrangers à la ville mais qui ont fait le choix d’y vivre, alors même qu’ils pourraient être plus prestigieux et plus connus ailleurs. La ville de Tanger a encore un certain charme, à travers diverses dégradations , elle a gardé aussi, malgré le changement historique se son statut, sa capacité à accueillir les homosexuels qui apprécient la beauté et la gentillesse de jeunes Marocains, c’est ainsi qu’au-delà de la sexualité il s’y forme des couples amoureux dont Gilles Gauthier parle de manière convaincante.
L’auteur prend soi de bien situer son roman dans le temps, pour éviter toute confusion : il ne s’agit plus du Tanger que certains diraient sans doute « de la Belle époque », lorsque le statut international de la ville en avait fait un brillant « melting pot » (creuset), lieu de rencontre de personnages originaux et séduisants voire fascinants, dont beaucoup étaient des écrivains ou des artistes. La ville ayant désormais perdu ce statut singulier depuis 1956 du fait de son rattachement au Maroc devenu indépendant, elle garde certes quelques traces de ce statut exceptionnel ou même quelques présences, mais plus discrètes qu’auparavant. L’auteur nous offre une galerie de personnages étrangers à la ville mais qui ont fait le choix d’y vivre, alors même qu’ils pourraient être plus prestigieux et plus connus ailleurs. La ville de Tanger a encore un certain charme, à travers diverses dégradations , elle a gardé aussi, malgré le changement historique se son statut, sa capacité à accueillir les homosexuels qui apprécient la beauté et la gentillesse de jeunes Marocains, c’est ainsi qu’au-delà de la sexualité il s’y forme des couples amoureux dont Gilles Gauthier parle de manière convaincante.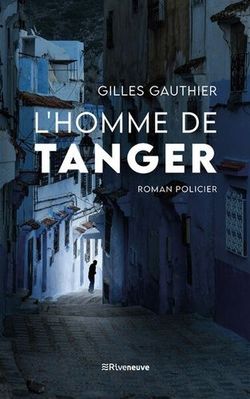 Mais il semble que par ailleurs, Tanger subisse à date récente une évolution inquiétante, du fait que le trafic de drogue serait en train de s’ y développer, et il est vrai que la situation géographique de la ville lui permet de devenir une plaque tournante de ce type de commerce, aux mains d’individus d’autant plus dangereux qu’ils ont su s’assurer des appuis au plus haut niveau du pouvoir marocain. Le résultat est que Tanger qui a été jadis ou naguère une ville extrêmement sûre et sans danger connaît désormais, au moment où se situe le roman (années 70), une criminalité multiforme qui nourrit toute la partie policière du roman : morts et disparitions inexpliquées, menaces de mort, poursuites etc.
Mais il semble que par ailleurs, Tanger subisse à date récente une évolution inquiétante, du fait que le trafic de drogue serait en train de s’ y développer, et il est vrai que la situation géographique de la ville lui permet de devenir une plaque tournante de ce type de commerce, aux mains d’individus d’autant plus dangereux qu’ils ont su s’assurer des appuis au plus haut niveau du pouvoir marocain. Le résultat est que Tanger qui a été jadis ou naguère une ville extrêmement sûre et sans danger connaît désormais, au moment où se situe le roman (années 70), une criminalité multiforme qui nourrit toute la partie policière du roman : morts et disparitions inexpliquées, menaces de mort, poursuites etc.
Cette partie policière n’est pas indigne du genre littéraire que l’auteur a choisi et elle a l’avantage de permettre des déplacements à travers la partie nord du pays, en particulier la région berbère et montagneuse du Rif qui a beaucoup fait parler d’elle quelques décennies auparavant, au moment de la guerre menée par le chef révolutionnaire Abdelkrim contre les puissances alors colonisatrices, la France et l’Espagne. Il se confirme ici que le romancier n’a pas l’intention d’aborder des sujets de cette sorte. En revanche la description des lieux et des paysages sont un apport considérable à son livre et permettent une sorte de contrepoint avec les aspects très urbains de toutes les scènes qui se situent à Tanger.
Sur ces dernières il faut insister car la description des cafés, bars, boîtes de nuit etc. contribue beaucoup au plaisir de lecture que donne « L’homme de Tanger ». A dire vrai, tout ce qui dans le livre ne relève pas de l’intrigue policière est fondé sur une sorte d’imprégnation par l’ambiance de ces lieux auxquels le lecteur s’attache, même lorsque non sans raison, ils deviennent inquiétants. D’ailleurs chez les plus grands auteurs, il y a un moment où cette ambiance compte plus que les faits eux-mêmes : que l’on pense côté français à Jean-Pierre Melville ou à des Américains comme Martin Scorcese. Il est certain que Tanger fournit des lieux propres à susciter des vocations.
Denise Brahimi
« LA NIECE DU TAXIDERMISTE » de Khadija Delaval 2022 Editions Calmann-Levy
La Nièce du Taxidermiste est un premier roman (2022) mais Khadija Delaval n’est pas une toute jeune romancière : Genevoise d’adoption, elle est née en 1973. On n’apprend pas grand chose de plus sur elle sur internet.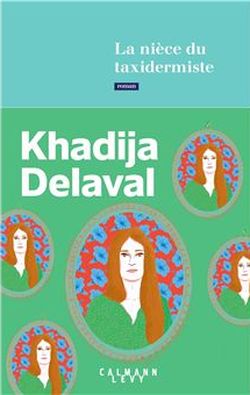 Ce roman a certainement un contenu fortement autobiographique mais rien ne le confirme. Il raconte le passage de la narratrice, Baya, de l’enfance à la puberté, dans une tribu familiale tunisienne aisée et excentrique où les nombreux enfants, cousins et cousines, sont laissés à eux-mêmes sous l’autorité des plus âgés. Citons une description de cette famille: « Ce qui retenait surtout mon attention, c’était cette cohésion dans la pagaille, tel que cela avait été le cas toute la nuit. Ma famille. Une sacrée clique de déglingués. Des voyous, des folles, des ivrognes, des lunatiques, des saintes et des éberlués. Des gros, les grands, des petits, des esquintés, mais tous pareils au fond. Convaincus d’être sortis de la cuisse de Jupiter, Un peu comme leur patriarche, mon grand-père. Tous réunis autour d’une vision commune de leur propre importance, de leur origine plus qu’honorable, faisant fi de toutes limites en toutes circonstances ».
Ce roman a certainement un contenu fortement autobiographique mais rien ne le confirme. Il raconte le passage de la narratrice, Baya, de l’enfance à la puberté, dans une tribu familiale tunisienne aisée et excentrique où les nombreux enfants, cousins et cousines, sont laissés à eux-mêmes sous l’autorité des plus âgés. Citons une description de cette famille: « Ce qui retenait surtout mon attention, c’était cette cohésion dans la pagaille, tel que cela avait été le cas toute la nuit. Ma famille. Une sacrée clique de déglingués. Des voyous, des folles, des ivrognes, des lunatiques, des saintes et des éberlués. Des gros, les grands, des petits, des esquintés, mais tous pareils au fond. Convaincus d’être sortis de la cuisse de Jupiter, Un peu comme leur patriarche, mon grand-père. Tous réunis autour d’une vision commune de leur propre importance, de leur origine plus qu’honorable, faisant fi de toutes limites en toutes circonstances ».
Baya est totalement ignorante de son corps et du sexe. Avec l’apparition de ses règles un été en Tunisie, elle passe brutalement du statut de petite fille à celui de proie et se résigne tout d’abord aux expériences traumatisantes qu’elle subit, son seul souci étant de les cacher aux adultes.
L’autrice fait s’exprimer une jeune fille de ses douze ans à ses quatorze ans en trouvant le ton juste et les réflexions et sentiments vraisemblables pour une enfant de cet âge réfléchissant seule. Même si ce que vit Baya est éprouvant et même inadmissible, le roman se situe toujours du côté de son héroĩne croyant que tout est normal jusqu’à ce qu’enfin elle se révolte et il fait la part belle au cadre méditerranéen euphorique dans lequel elle devient une femme. Sans doute la « bonne société » tunisienne, plus encore que ses homologues marocains ou algériens, s’appuie sur une diaspora internationale particulièrement étendue.
Sans doute la « bonne société » tunisienne, plus encore que ses homologues marocains ou algériens, s’appuie sur une diaspora internationale particulièrement étendue.
Nous avons trouvé ce roman remarquable : son thème est original et très actuel, la manière de le traiter est également très originale et le style, très tenu, est bien au-dessus du lot habituel des premiers romans.
On peut noter, accessoirement, que pour une fois la quatrième de couverture donne une idée fidèle du roman qu’elle incite le lecteur à acheter.
Catherine Giffard, Claude Bataillon
Ecouter l’auteure, ethnologue, à la télévision genevoise:
Et puis chez son éditeur: https://www.leschroniquesdegoliath.com/2022/08/la-niece-du-taxidermiste-de-khadija-delaval/

« MEMOIRES COLLECTEES » Pièce de Théâtre du collectif 81 %, mise en scène Rodolphe Harrot.
Issue d’un travail de collecte d’archives et de recueil de mémoires, auquel certains membres de notre association ont contribué, cette pièce a été représentée au Théâtre des Marronniers de Lyon du 16 au 20 janvier 2023. Il est à souhaiter qu’elle soit programmée à l’avenir dans d’autres théâtres et lieux de diffusion tant ce travail d’écriture et de jeu mérite de trouver ses publics. En particulier, selon nous le public lycéen qui se penche sur la question des mémoires entremêlées de la guerre d’Algérie.

@Jules-Beniaya
Le texte de la pièce, écrit à partir de témoignages recueillis pendant toute une année par ces jeunes artistes, récemment sortis de l’école de théâtre Arts en scène, est l’œuvre de Manon Agostini, une des trois comédiennes qui donnent vie (et quelle vie!) à ce spectacle, aux côtés de Camille Muche-Prieux et Alice Vigneau. Une écriture de plateau, des improvisations dans lesquelles Manon a su trouver la construction d’un récit en puzzle d’où émerge progressivement un récit cohérent.
Fait de scènes successives, dans lesquelles les trois comédiennes jouent tour à tour hommes et femmes, jeunes et vieilles ou vieux, il fait astucieusement progresser une histoire centrale d’une famille d’Algériens, principalement deux frères de Sétif, Ryad et Sofiane Boumedine que la guerre d’Algérie va séparer, mais que bien plus tard, la rencontre fortuite (mais le hasard existe t il?) de leur fille et petite fille va permettre de se retrouver en France. Il faut dire que cet entrelacs de mémoires (le frère harki, la vieille dame pied noir, le grand-père ancien appelé, le couple obligé de fuir l’Algérie pendant la décennie noire…), face à des enfants et petits enfants qui apprennent leur histoire, est sensé se réaliser dans le cadre d’une exposition dans un musée où nous accueille au début de la pièce une guide quelque peu …allumée. Le public est « briefé » comme le groupe d »élèves que leur prof d’histoire emmène faire cette visite, pour y puiser matière à exposé.
Il faut dire que cet entrelacs de mémoires (le frère harki, la vieille dame pied noir, le grand-père ancien appelé, le couple obligé de fuir l’Algérie pendant la décennie noire…), face à des enfants et petits enfants qui apprennent leur histoire, est sensé se réaliser dans le cadre d’une exposition dans un musée où nous accueille au début de la pièce une guide quelque peu …allumée. Le public est « briefé » comme le groupe d »élèves que leur prof d’histoire emmène faire cette visite, pour y puiser matière à exposé.
Le parti pris d’écriture fait que même si elle traverse des scènes dramatiques, cette pièce est pleine d’humour, avec un langage moderne, quelque fois provocateur. Un langage et une façon d’aborder les sujets bien aptes à séduire un public varié, et plus particulièrement les jeunes.
Les différents personnages sont bien dessinés, jamais caricaturaux, et le spectateur s’attache vite à eux. La virtuosité du récit entraîne le spectateur dans différentes situations qui ont été des moments emblématiques de cette guerre, que le récit fait démarrer à Sétif le 8 mai 1945, et qui se prolonge jusqu’à la période contemporaine. Ce qui est frappant c’est que presque tous ces personnages sont des acteurs de leur vie, pas des victimes se complaisant dans la plainte. On peut penser que ce que ces jeunes artistes ont recueilli, et choisi de donner à voir, sont plutôt des attitudes de battants. Par exemple la scène en 1962 où le harki impose à son copain sous-officier de l’armée française de prendre le risque de lui faire quitter l’Algérie est représentative de l’approche dynamique que les acteurs ont choisi d’adopter : ce n’est pas le gentil et brave soldat français qui sauve le pauvre supplétif de l’armée française, mais c’est le harki, qui s’impose à son ami et ce faisant sauve leur amitié.
Les relations entre les jeunes générations et les anciens, porteurs de mémoire, sont elles aussi dynamiques et positives. Les jeunes font accoucher leurs aînés de cette histoire, et s’en emparent à leur façon. Une jolie trouvaille de mise en scène, sur un plateau très sobrement équipé, avec une grande photo du port d’Alger au début du vingtième siècle en fond de scène : un petit tas de sable en bord de scène permet tour à tour d’enfouir ou déterrer des papiers, des photos, des numéros de téléphone… Ce petit monticule symbolise le rapport à la mémoire, fait d’oublis et de resurgissements qui jalonnent le cheminement des protagonistes de cette histoire fracassante, mais quand même une histoire de vies vécues « pour de bon ».
Une jolie trouvaille de mise en scène, sur un plateau très sobrement équipé, avec une grande photo du port d’Alger au début du vingtième siècle en fond de scène : un petit tas de sable en bord de scène permet tour à tour d’enfouir ou déterrer des papiers, des photos, des numéros de téléphone… Ce petit monticule symbolise le rapport à la mémoire, fait d’oublis et de resurgissements qui jalonnent le cheminement des protagonistes de cette histoire fracassante, mais quand même une histoire de vies vécues « pour de bon ».
Voilà plusieurs pièces qui nous ont été données à voir ces dernières années évoquant cette période historique, et bâties sur les mêmes mode d’écriture. Ces « Mémoires collectées » y prennent une place notable et il est souhaitable qu’elles soient vues par des publics variés, en particulier celui des jeunes qui devrait y trouver à la fois du plaisir et la connaissance de jalons historiques.
Michel Wilson

« YOUSSEF SALEM A DU SUCCES » film de Baya Kasmi 2023
Il y a plus d’une raison de voir ce film et d’y prendre plaisir. Comme c’est l’histoire d’un romancier jusque là sans succès et soudain promu jusqu’au Prix Goncourt, il donne l’occasion d’évoluer dans le milieu éditorial parisien, lequel pourrait bien être un véritable vivier de figures pittoresques et vaguement comiques, en tout cas c’est souvent ainsi qu’il est représenté, avec abondance de mondains défraîchis et de vieilles alcooliques 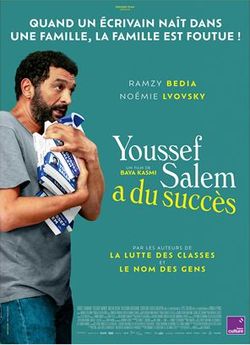 maniérées. Baya Kasmi la réalisatrice ne résiste pas au plaisir de ce spectacle folklorique, mais elle ne mérite que des éloges pour en avoir tiré le cas particulier et différent de Lise, éditrice de Youssef Salem et bouleversée de joie par ce Goncourt inespéré (à l’inverse de son auteur, paniqué par l’événement). L’éditrice est jouée par Noémie Lvovsky, en qui c’est l’occasion de découvrir une très grande actrice (même si on le savait déjà). Il y a un long moment jubilatoire où elle atteint des sommets dans l’art dramatique, ce qui fait espérer que le jury de quelque prochain prix voudra bien s’en aviser.
maniérées. Baya Kasmi la réalisatrice ne résiste pas au plaisir de ce spectacle folklorique, mais elle ne mérite que des éloges pour en avoir tiré le cas particulier et différent de Lise, éditrice de Youssef Salem et bouleversée de joie par ce Goncourt inespéré (à l’inverse de son auteur, paniqué par l’événement). L’éditrice est jouée par Noémie Lvovsky, en qui c’est l’occasion de découvrir une très grande actrice (même si on le savait déjà). Il y a un long moment jubilatoire où elle atteint des sommets dans l’art dramatique, ce qui fait espérer que le jury de quelque prochain prix voudra bien s’en aviser.
Autre milieu, autre folklore, c’est la famille de Youssef, parents, sœurs, conjoints conjointes, une famille maghrébine de France dont on s’attend à ce qu’elle nous soit présentée sur un mode satirique ravageur et digne de Woody Allen. En effet, on apprend très vite que le fameux roman auquel Youssef doit son mirifique succès public est une représentation haute en couleur de son milieu familial ; et s’il est vrai qu’on ne la connaîtra jamais complètement (en fait, on n’en entend qu’un court passage), on peut juger de sa virulence par les effets qu’elle produit : tous les membres de la famille à l’exception des parents sont suffoqués de fureur dès qu’ils lisent le livre (dont il est évident qu’ils sont les personnages à quelques changements près), et lorsque le père le fait à son tour, il en meurt d’une crise cardiaque (il est vrai qu’il était déjà fort mal en point) !
On se dit que toutes les familles sont folkloriques pour qui les regarde avec assez de sens critique, mais l’acte commis par Youssef en faisant de la sienne la matière de son livre est d’autant plus audacieux voire décapant que le propre d’une famille maghrébine comme celle-ci (il semblerait d’ailleurs que ce soit un trait assez général) est de se dissimuler sous des apparences hypocrites, chacun trouvant bienséant de mentir aux autres et de leur cacher la vérité de sa vie intime.
Le sujet du film à partir du moment où on sait en quoi le livre écrit par Youssef est explosif, n’est d’ailleurs pas uniquement la description d’une famille maghrébine vivant en France dans le milieu de l’immigration. Il s’agit plutôt de savoir comment Youssef se situe par rapport à cette famille, la sienne quoi qu’il en soit, même s’il en est à maints égards complètement différent. On a vite fait de comprendre que ce rapport ne va pas sans contradictions et qu’au point où nous mène le film, il n’y pas de moyen de les dépasser. Le jeu de l’acteur Ramzy Bedia qui incarne Youssef Salem est suffisamment fin pour qu’on le suive à travers cette vérité multiple, qui est un refus de tous les clichés—et c’est le côté très salutaire du film—mais qui induit aussi un cheminement très hésitant du personnage à travers des questions qu’il ne résout pas. De la réalisatrice Baya Kasmi on a envie de dire qu’elle en sait sans doute plus long que son personnage mais qu’elle utilise celui-ci pour montrer avec humour et drôlerie ce que c’est qu’un individu empêtré en lui-même et dans ses mensonges, alors même qu’il prétend dénoncer ceux des autres. Ce rôle est forcément un peu prétentieux et toutes les angoisses qui l’assaillent successivement peuvent passer pour la punition de cette prétention — étant entendu que les proches ont largement les moyens de se défendre et qu’il n’y a pas lieu de s’attendrir sur eux. Youssef veut à la fois dénoncer sa famille avec une lucidité sans ménagement mais garder les apparences d’un bon fils aimant et aimé de ses parents. Il leur ment sans vergogne, encore que cette vergogne (un mot qui veut dire la honte) existe aussi en lui et qu’il n’arrive pas à s’en débarrasser.
De la réalisatrice Baya Kasmi on a envie de dire qu’elle en sait sans doute plus long que son personnage mais qu’elle utilise celui-ci pour montrer avec humour et drôlerie ce que c’est qu’un individu empêtré en lui-même et dans ses mensonges, alors même qu’il prétend dénoncer ceux des autres. Ce rôle est forcément un peu prétentieux et toutes les angoisses qui l’assaillent successivement peuvent passer pour la punition de cette prétention — étant entendu que les proches ont largement les moyens de se défendre et qu’il n’y a pas lieu de s’attendrir sur eux. Youssef veut à la fois dénoncer sa famille avec une lucidité sans ménagement mais garder les apparences d’un bon fils aimant et aimé de ses parents. Il leur ment sans vergogne, encore que cette vergogne (un mot qui veut dire la honte) existe aussi en lui et qu’il n’arrive pas à s’en débarrasser.
Lorsqu’en tant que spectateur du film, on trouve juste qu’il soit puni de sa prétention, c’est pour des raisons liées à la nature du personnage comique : on aime les petits malins et leur rosserie à l’égard des autres, mais on trouve juste que les coups de bâton ne leur soient pas épargnés, c’est cet équilibre qui fait la force de la farce chère à Molière.
Mais cette punition, le Youssef de cette farce-là ne peut s’empêcher de la vivre autrement et de lui donner un sens religieux, beaucoup plus troublant. Car il y a en lui un fort sentiment de culpabilité qu’il n’arrive pas à analyser et encore moins à combattre. C’est pourtant ce que l’incite à faire une charmante jeune femme amoureuse de lui, qui voudrait l’aider à se « dés-empêtrer » si l’on peut oser ce néologisme. Baya Kasmi met dans sa bouche les propos d’un grand bon sens qu’elle voudrait faire entendre à son amoureux pour le libérer, le désentraver. Un exemple tout simple lui est fourni au moment où le ciel se remplit d’éclairs et se met à gronder. C’est un orage lui dit-elle, et non le châtiment du ciel auquel il ne peut s’empêcher de penser d’emblée.
La contradiction principale de Youssef est que d’un part il refuse tous les clichés dans lesquels on veut l’enfermer en tant qu’Arabe (à cet égard, les critiques littéraires s’en donnent à cœur joie) mais que lui-même n’arrive pas à se dégager d’une arabité qu’il subit sans l’assumer. Pas simple, mon cher Youssef !
Denise Brahimi
Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.
 – Utiles
– Utiles
de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun
Cliquez ici pour voir le film et le mot de passe utilesjoussour

–Entre nos mains
de Leila Saadna
Cliquez ici pour voir le film, puis mot de passe utilesjoussour
Et sa bande-annonce, cliquez ici

Si vous souhaitez aider notre association régionale à développer ses actions, vous avez aussi la possibilité de faire un DON, via Hello Asso. Soyez-en remercié.e.s.
Si vous souhaitez vous investir à nos côtés, nous serions heureux d’accueillir votre adhésion. Il vous est possible de le faire en ligne sur notre site via Hello Asso.

Vous pouvez aussi nous commander notre livre « Algérie à coeur » en envoyant un chèque de 16€, port compris,
chez Michel Wilson 5 rue Auguste Comte 69002 LYON.
Et également vous avez la possibilité de souscrire en ligne sur notre site à l’ultime numéro de la Revue Le Croquant, un hommage à son créateur Michel Cornaton, que nous avons co-édité.
Nous souhaitons aussi contribuer à la diffusion du livre posthume de notre cher Abdelhamid LAGHOUATI, poète, artiste plasticien, ami de Jean Sénac et de tant d’autres. Une souscription est ouverte pour commander son livre par la Maison de la Poésie Rhône-Alpes à Saint Martin d’Hères.
SOUSCRIPTION
BON DE COMMANDE
Je commande .. .. .. .. exemplaire(s) de « Entre cri et passion » de Abdelhamid Laghouati.
Je règle par : ☐ chèque bancaire
☐ autre moyen (sauf carte bancaire)
☐ postal
À l’ordre de :
Maison de la Poésie Rhône-Alpes
33 avenue Ambroise Croizat
38400 Saint-Martin-d’Hères
Date : .. .. / .. .. / .. .. Signature :

- Mercredi 1er février à 19h au cinéma L’Opéra de Lyon film « Le port des amours Reinette l’Oranaise » en présence de la réalisatrice Jacqueline Gozland
- Jeudi 2 février de 9h à 18h journée Juifs d’Algérie, une mémoire qui (en)chante, à l’Hôtel de Ville de Lyon
- Vendredi 3 février à 18h30 à l’IFCM de Lyon Projection du film Gardien des mondes en présence de la réalisatrice Leila Chaibi
- Samedi 4 février de 17h au Studio 24 du Pôle Pixel à Villeurbanne Rencontre Bande dessinée et guerre d’Algérie en présence de l’historien Tramor Quemeneur et des auteurs de BD Meralli et Deloupy
- Vendredi 24 février intervention témoignages croisés sur la guerre d’Algérie au Lycée Fernand Forest de Saint Priest
N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.


