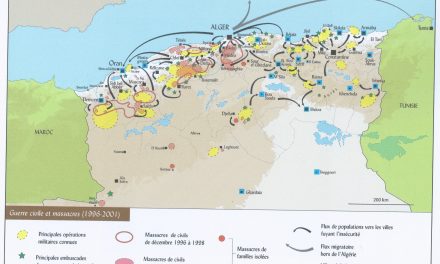« ZABOR OU LES PSAUMES » de Kamel Daoud, (Actes sud, 2017)
Bien que ce livre soit de parution récente, on en a déjà beaucoup parlé, et principalement en tant que deuxième livre d’un auteur qui s’est rendu célèbre par le premier : on se souvient évidemment de Meursault, contre-enquête paru en 2013 et couvert de prix— le livre révolutionnaire en cela qu’il donne un nom à l’Arabe anonyme de Camus !
On peut d’ailleurs regretter que ce nouveau succès dans le genre romanesque détourne un peu l’attention d’un gros livre très remarquable qui l’a précédé de quelques mois seulement et qui donne une idée des qualités de Kamel Daoud en tant que journaliste, ce qui fut son premier métier. Il s’agit de Mes indépendances (Actes Sud, 2017), gros recueil de 182 chroniques parues dans la presse de 2010 à 2016, du New York Times au Point, en passant, pour la plupart, par Le Quotidien d’Oran. Les lecteurs, qui en France du moins privilégient le roman et toute forme de fiction, devraient considérer que ces Chroniques constituent une véritable « roman de formation » de leur auteur pendant les années où il conquiert liberté personnelle et maîtrise de soi.
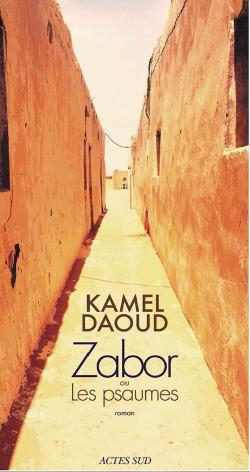 Pour en revenir à Zabor ou les Psaumes il est gênant que la critique, enivrée par le succès grandissant de l’auteur (un succès qu’on pourrait dire acquis quoi qu’il en soit) donne très peu d’informations objectives qui pourraient aider le lecteur. Il le faudrait pourtant, en commençant par le titre qui n’a rien d’évident. Et s’il convient de s’y arrêter un instant, c’est parce que ce serait une erreur de rabattre ici le mot Psaumes sur la Bible, bien qu’il l’évoque inévitablement (le plus grand nombre les Psaumes est attribué à David).
Pour en revenir à Zabor ou les Psaumes il est gênant que la critique, enivrée par le succès grandissant de l’auteur (un succès qu’on pourrait dire acquis quoi qu’il en soit) donne très peu d’informations objectives qui pourraient aider le lecteur. Il le faudrait pourtant, en commençant par le titre qui n’a rien d’évident. Et s’il convient de s’y arrêter un instant, c’est parce que ce serait une erreur de rabattre ici le mot Psaumes sur la Bible, bien qu’il l’évoque inévitablement (le plus grand nombre les Psaumes est attribué à David).
Car il se fait que les psaumes se trouvent aussi dans le Coran, assortis du mot Zabur ou Zabor, qui désigne l’un des trois livres cités par Allah comme antérieurs au Coran lui-même, les autres étant la Tawrat (Torah) et l’Injil (les Évangiles). Cependant, dans le contexte conflictuel qui caractérise l’époque actuelle dès qu’il s’agit de l’islam, beaucoup de lecteurs n’imaginent sans doute pas, du fait qu’il pourfend les islamistes autant qu’il le peut, l’importance des connaissances théologiques dans la formation de Kamel Daoud. D’ailleurs il déplore justement qu’après la disparition des grands savants orientalistes ce genre d’études soit devenu le monopole d’islamistes ignares le plus souvent.
On constate donc que Zabor, qui était un livre, devient le nom du personnage principal et narrateur dans le roman de Kamel Daoud. Ce qui nous amène à ce qui est le thème général de son livre, écrit pour faire l’éloge d’un très grand nombre d’autres livres ainsi que celui de l’écriture, auxquels Zabor son personnage considère qu’il doit tout. Les livres et l’écriture sont doublement au cœur de ce récit. D‘une part, adoptant le ton du conte, un genre dont on sait de quelle faveur il jouit en Orient, l’auteur use du merveilleux et imagine que Zabor son héros dispose d’un don étonnant qui est de pouvoir retarder la mort par son écriture. D’autre part ce même Zabor, dont le portrait en cela est très autobiographique, ne vit que grâce à l’environnement de livres qu’il a su se procurer malgré des conditions très difficiles et se meut grâce à eux dans le libre domaine de l’imaginaire. Souvent, les titres seuls suffisent à son envol et lui permettent de s’approprier des œuvres auxquelles il donne un contenu très personnel. Zabor ne cesse d’écrire, pour faire bon usage d’un don qui lui est propre, mais le romancier ne nous parle pas de ses écrits en tant qu’œuvres originales et personnelles, tout au contraire il mêle son écriture à celle d’un grand nombre d’auteurs ; et loin de cacher la présence de ceux-ci dans son livre, il la revendique et revendique le « vol » comme le plus bel hommage qui puisse leur être rendu.
 La pratique dont il use ainsi abondamment a un nom dans l’histoire récente de la critique littéraire, qui a inventé pour la désigner le mot intertextualité. Si le mot est nouveau, cette façon de faire ne l’est aucunement. Le fait récent est plutôt qu’on ait pris conscience de l’importance de cette notion pour comprendre les textes littéraires. En voici une brève définition canonique : c’est « l’ensemble des textes mis en relation (par le biais par exemple de la citation, de l’allusion, du plagiat, de la référence et du lien hypertexte) dans un texte donné ». Ce qu’on peut dire de Zabor ou les Psaumes est que ce livre est une véritable défense et illustration de l’intertextualité, comme en témoigne l’abondance des titres dont il est parsemé. Cependant le lecteur s’en aperçoit plus ou moins, selon son degré de culture et de connaissances littéraires. De toute manière, il est clair que l’intertextualité dans le livre de Kamel Daoud est un indice de la richesse et de la complexité de la culture ou des cultures dont il s’emploie à nourrir son talent personnel et son goût d’écrire.
La pratique dont il use ainsi abondamment a un nom dans l’histoire récente de la critique littéraire, qui a inventé pour la désigner le mot intertextualité. Si le mot est nouveau, cette façon de faire ne l’est aucunement. Le fait récent est plutôt qu’on ait pris conscience de l’importance de cette notion pour comprendre les textes littéraires. En voici une brève définition canonique : c’est « l’ensemble des textes mis en relation (par le biais par exemple de la citation, de l’allusion, du plagiat, de la référence et du lien hypertexte) dans un texte donné ». Ce qu’on peut dire de Zabor ou les Psaumes est que ce livre est une véritable défense et illustration de l’intertextualité, comme en témoigne l’abondance des titres dont il est parsemé. Cependant le lecteur s’en aperçoit plus ou moins, selon son degré de culture et de connaissances littéraires. De toute manière, il est clair que l’intertextualité dans le livre de Kamel Daoud est un indice de la richesse et de la complexité de la culture ou des cultures dont il s’emploie à nourrir son talent personnel et son goût d’écrire.
On peut déduire de cette pluralité que Kamel Daoud n’est certainement pas l’adepte d’un seul livre, qui dans le contexte musulman ne pourrait être que le Coran. Le moins qu’on puisse dire est qu’il n’est pas de ceux qui prétendent tout trouver dans ce livre, avec majuscule le Livre, et donc se limiter à lui (exigeant qu’il en soit de même pour les autres ! ) A tous égards, Kamel Daoud prône l’ouverture, ce qui signifie particulièrement la liberté de choisir. Cette liberté est essentielle pour lui, elle l’amène à s’inscrire en faux contre le nationalisme voire le chauvinisme qui enferme son pays et l’empêche de se renouveler depuis plusieurs décennies. Il admire en revanche que dans un pays voisin du sien, la Tunisie, des femmes et des hommes luttent courageusement pour donner à leur avenir la forme de leur choix. Lui aussi se bat comme il peut et il célèbre les livres comme les armes principales de son combat.
(Denise Brahimi)
Kamel Daoud nous plonge dans une bourgade où l’on parle arabe, mais à l’ombre de la colonisation : la « maison d’en bas » du héros est modeste, délabrée, « héritée » d’un « colon » sans doute modeste, peut-être un petit fonctionnaire. Le cimetière musulman est mal entretenu, mais le cimetière chrétien plus encore, refuge des amoureux ou des trafiquants de drogue.
Le héros est une sorte de bâtard de la plus puissante famille de la bourgade, persécuté par ses demi-frères. C’est un surdoué qui un moment se jette dans la langue arabe « sacrée », avant de s’immerger dans la langue française : c’est la vraiehistoire de Kamel, qui est libéré, y compris sexuellement, par l’acquisition de la langue de la liberté, le français qu’il acquiert par lui-même, par la lecture et non pas comme les héritiers de la classe aisée algérienne qui est « propriétaire » de cette langue depuis les années 1930. Cette langue, non seulement il se l’est appropriée par lui-même, mais il l’invente à mesure de son apprentissage bricolé, brandissant les titres des livres qu’il ne lira peut-être jamais, sans cesse hanté par une langue qui seule fait que sa bourgade tient ensemble fragilement, puisque tout le monde s’en sert sans la posséder. Cette langue « libre », il veut l’écrire en l’inventant, en la mélangeant de chiffres et de dessins, en choisissant comment la guirlande des phrases va occuper la page.
De ce roman kaleïdoscope, retenons quelques phrases : Sur les rapports entre la langue arabe parlée (darija) et celle de l’école : la langue de Hadjer [la tante qui l’élève], la mienne depuis ma naissance, se révélait insuffisante, pauvre, comme un malade dont les mains ne pourraient saisir les […] choses lointaines ou mal éclairées. […]. Langue recluse, ignorée par les livres et l’école, cachée et interdite. […]La découverte de l’écart misérable entre la langue de Hadjer, mêlée et bâtarde, et la langue de l’école […] Je renonçai, après deux ou trois essais, à écrire les mots de Hadjer et du village avec l’alphabet arabe que l’on m’a enseigné à l’école. Ils avaient l’air guindé de ces paysans arrivés à la ville, bègues et gauches […] Je trouvais étrange que la langue du village n’ait pas de nom, alors que celle de l’école avait des livres, des poèmes et des chants. La langue de Hadjer, on la vivait et on la cachait comme le corps d’une femme, ou comme le sexe. [La langue de l’école] se mit à parler à la place de Dieu et des héros de la guerre de Libération, et je finis par surprendre la faiblesse de cette langue puissante, mais sourde et bavarde : elle comptait beaucoup de mots pour les morts, le passé, les devoirs et les interdits, et peu de mots précis pour notre vie de tous les jours. (p. 138 sq).
Sur l’usage du français : L’émergence de douze livres exactement, avec une langue dont personne n’était gardien, a été l’événement essentiel de ma vie. Mille et un jours, chaque fois […]. Cette langue, celle-ci, à cet instant, fut définitivement marquée par mon corps, mon sexe, la naissance de mon désir. […] J’avais déjà vu un ensemble ficelé de quelques livres jaunis, écornés et ligotés comme des malfrats les mains derrière le dos. […] Je me mis à feuilleter l’un des ouvrages […] Une armée de caractères se déversa alors, fourmilière ordonnée et stricte, pattes maigres en procession, paragraphes en retrait et guillemets agités par des exclamations […] Je déchiffrai, avec application, à peine quelque mots, dans le souvenir de mon alphabet persistant d’écolier [… Il s’empare du polar La chair de l’orchidée] J’en caressai la peau à la fois éternellement jeune et déjà craquelée à cause de l’âge du papier [… p. 256 sq.]. Le temps n’était pas le même en arabe et en français, il était découpé différemment selon la façon d’appréhender l’avenir et de posséder le présent. Je décidai alors d’essayer autre chose pour connaître l’histoire de cette femme : je relus un chapitre en sautant les mots que je ne connaissais pas, pour ne lire que ceux que je déchiffrais. […] Ce fut un début de miracle et les paragraphes s’éclairaient doucement, habités d’ombres lourdes et de chuchotis, laissant entrevoir une brèche, une possibilité de sens, de seins [p. 263-264]. Le français était une langue de la mort, pour ceux qui se souvenaient de la guerre, mais pas une langue morte. Pour les autres, les spectateurs de films, les proches de parents immigrés ou les ambitieux rêvant de quitter le village ou de gagner de l’argent sans suer sous le soleil, cette langue témoignait d’un prestige, elle était la preuve qu’on avait fait un grand voyage même si on n’avait jamais quitté Aboukir [la bourgade du héros, p. 302]
(Claude Bataillon)