Editorial
Une fois n’est pas coutume : La Lettre de ce mois-ci attire l’attention sur autant de films que de livres. Le grand maître du cinéma algérien Merzak Allouache (célèbre depuis « Omar Gatlato » en 1977), fait partie de cette sélection avec un film intitulé « La Famille », tandis qu’Omar Belkacemi, cinéaste d’une nouvelle génération(son premier film date de 2010), propose avec « Rêve » (« Argu ») un cinéma d’une inspiration tout à fait différente, mettant en valeur la beauté poétique de la Kabylie. « Divertimento », film de femme, raconte de manière émouvante et sensible, comment une autre femme, Zahia Ziouani, est devenue une éminente chef d’orchestre. Et c’est encore de musique qu’il est question dans le film consacré à un des grands noms de la musique judéo-arabe « Reinette l’Oranaise » par Jacqueline Gozland .
Même diversité dans les livres auxquels cette Lettre 74 nous invite à nous intéresser. Ils sont parfois sociologiques et sociopolitiques, comme le recueil d’articles intitulé « Comment peut-on être berbère » ; mais dans un genre tout à fait différent c’est à la très grande artiste algérienne Baya qu’est consacré un livre magnifique, en fait le catalogue d’une exposition qu’on peut voir à l’Institut du Monde arabe à Paris et bientôt à Marseille. Un autre hommage, rendu au chercheur et écrivain tunisien Bourkhis, nous a paru être l’occasion d’un retour à Camus qui reste très présent dans les esprits et dans les cœurs. Et l’histoire du Maghreb, encore trop mal connue montre bien tout ce que nous avons encore à découvrir à son sujet, par la place qu’elle occupe dans le livre intitulé « L’Afrique et le monde ».
Histoire encore, au féminin cette fois , dans le livre illustré de très belles aquarelles qu’Halima Guerroumi, « artiste visuelle » consacre à 43 femmes qui ont construit l’Algérie au cours des siècles.
Enfin Michel Wilson a jugé important et significatif le retour en Algérie du chanteur Patrick Bruel, premier retour après son départ en juin 62 à l’âge de 3 ans. C’est aussi l’avis de Kamel Daoud.
Denise Brahimi
Peut-être souhaitez-vous faire un don à notre association, pour contribuer à notre fonctionnement? Et notamment au coût de réalisation de cette Lettre?
Vous en avez la possibilité en cliquant ICI. Merci d’avance et joyeuses fêtes!

« COMMENT PEUT-ON ÊTRE BERBERE? AMNESIE, RENAISSANCE, SOULEVEMENTS », sous la direction de Pierre Vermeren, éditions Riveneuve, 2022
Les articles publiés dans ce livre proviennent essentiellement d’un colloque universitaire de 2015. Il a été dirigé par un professeur spécialiste de l’Algérie et du Maroc, spécialement pour les aspects de leur histoire dont on peut estimer qu’ils ont été occultés voire falsifiés de longue date ; ce qui concerne principalement tout ce qui touche à la population et la culture appelées longtemps berbères, alors qu’on utilise davantage de nos jours le néologisme « amazigh ».
Une autre spécialiste connue des Berbères, Tassadit Yacine, s’interroge : « Pourquoi cette absence ?» et il est vrai que la première partie du livre s’emploie à nuancer les réponses qu’on peut apporter à cet effacement. La suivante évoque au contraire ce qu’il en est de la renaissance culturelle berbère récente et actuelle, même si on ne peut en parler sans évoquer les limites dans lesquelles les Etats s’efforcent de la maintenir. Géographiquement le livre ne se borne pas à l’Algérie et au Maroc, il concerne aussi la Tunisie, la Lybie et l’Azawad peuplé de Berbères Touaregs, non sans y ajouter le fait que les revendications berbères trouvent un écho très important dans le monde de l’immigration. Il fallait évidemment rappeler que, pour prendre cet exemple quantitativement impressionnant, une grande partie de ceux qu’on appelle en France « les Arabes » sont en fait des Berbères, souvent originaires de Kabylie (et que nombre d’entre eux sont arrivés en France sans parler la langue arabe).
Géographiquement le livre ne se borne pas à l’Algérie et au Maroc, il concerne aussi la Tunisie, la Lybie et l’Azawad peuplé de Berbères Touaregs, non sans y ajouter le fait que les revendications berbères trouvent un écho très important dans le monde de l’immigration. Il fallait évidemment rappeler que, pour prendre cet exemple quantitativement impressionnant, une grande partie de ceux qu’on appelle en France « les Arabes » sont en fait des Berbères, souvent originaires de Kabylie (et que nombre d’entre eux sont arrivés en France sans parler la langue arabe).
En fait, le livre ne cache nullement ses intentions qui sont d’expliquer un phénomène relativement récent, la minoration des Berbères au profit de l’arabité qui comporte d’ailleurs plusieurs aspects concomitants : la naissance d’un nationalisme arabe lié aux mouvements anticoloniaux et devenant la pensée unique des pays nouvellement indépendants, la montée en puissance des pays arabes extraordinairement enrichis par la découverte du pétrole et ses effets mondiaux. Plusieurs articles montrent avec quelle force s’est alors exercé le pouvoir du parti nationaliste arabe se concevant comme parti unique, autorisé à s’imposer par une coercition intraitable et souvent féroce. C’est d’ailleurs l’idée très clairement exprimée par Pierre Vermeren dès la première page du livre : « Depuis les années cinquante, le nationalisme arabe a forgé l’horizon d’attente des dirigeants du Maghreb. Ceux-ci ont utilisé les instruments et le pouvoir des Etats bureaucratiques dont ils ont hérité du colonialisme, entre 1956 et 1962, pour amplifier et si possible achever l’arabisation de leurs peuples entamée au Moyen-Age. » Toujours aussi clair et ferme dans ses affirmations, l’auteur revient sur les opinions vraies mais surtout fausses qui ont été répandues pour étayer la politique d’unification menée par les nationalistes arabes à leur profit. Au nom de cette nation qui est leur cheval de bataille (même si on ne sait pas toujours très bien ce qu’il faut entendre par là ni pourquoi la nation ne permettrait pas des diversités culturelles en son sein), ils pratiquent un amalgame qui ne relève que de la mauvaise foi, voire d’une volonté de falsification. Car d’une part il est tout à fait vrai, comme le savent tous les historiens, que le pouvoir colonial a cherché à jouer des divisions ethniques et culturelles en vertu du vieux principe : diviser pour régner. Mais d’autre part il est tout à fait faux que les Berbères aient choisi le camp des colonisateurs lorsque conflits et guerres ont éclaté entre ceux-ci et les populations colonisées. L’exemple de la guerre d’Algérie est flagrant, et il faudrait nier toute évidence pour ne pas reconnaître l’importance considérable de la composante berbère dans les rangs des indépendantistes. Sans multiplier les exemples que tout le monde connaît, Abdelkrim montagnard berbère du Rif marocain est connu pour avoir mené le combat contre l’annexion de son pays par les colonisateurs. Il est stupéfiant de voir en cette affaire comment la propagande l’emporte de manière éhontée sur les faits.
Toujours aussi clair et ferme dans ses affirmations, l’auteur revient sur les opinions vraies mais surtout fausses qui ont été répandues pour étayer la politique d’unification menée par les nationalistes arabes à leur profit. Au nom de cette nation qui est leur cheval de bataille (même si on ne sait pas toujours très bien ce qu’il faut entendre par là ni pourquoi la nation ne permettrait pas des diversités culturelles en son sein), ils pratiquent un amalgame qui ne relève que de la mauvaise foi, voire d’une volonté de falsification. Car d’une part il est tout à fait vrai, comme le savent tous les historiens, que le pouvoir colonial a cherché à jouer des divisions ethniques et culturelles en vertu du vieux principe : diviser pour régner. Mais d’autre part il est tout à fait faux que les Berbères aient choisi le camp des colonisateurs lorsque conflits et guerres ont éclaté entre ceux-ci et les populations colonisées. L’exemple de la guerre d’Algérie est flagrant, et il faudrait nier toute évidence pour ne pas reconnaître l’importance considérable de la composante berbère dans les rangs des indépendantistes. Sans multiplier les exemples que tout le monde connaît, Abdelkrim montagnard berbère du Rif marocain est connu pour avoir mené le combat contre l’annexion de son pays par les colonisateurs. Il est stupéfiant de voir en cette affaire comment la propagande l’emporte de manière éhontée sur les faits.
Il a fallu du temps pour que la revendication berbère parvienne à des résultats, mais ils sont aujourd’hui incontestables. Le livre revient sur quelques étapes de cette renaissance et sur les mouvements populaires qui l’ont rendue possible. Au nombre desquels, évidemment, le printemps berbère de 1980, suite à l’interdiction d’une conférence de l’écrivain Mouloud Mammeri à l’Université de Tizi Ouzou— mais on peut le voir comme la partie émergée d’un iceberg. Très nombreux en effet sont les événements petits ou grands que le livre recense dans plusieurs pages intitulées « Repères chronologiques sur le mouvement amazigh en Algérie, au Maroc et en France ». Les décrets et actes officiels sont d’une importance décisive, mais l’affectivité et les émotions populaires ne le sont pas moins. Il en est ainsi pour l’assassinat du chanteur kabyle Matoub Lounès en 1998, qui fut suivi de remous très violents autour de l’amazighité. A mi-chemin de ces deux forces, l’Etat et le peuple , les affrontements entre partis opposés débouchent parfois sur des prises de position qui sont des avancées importantes dans la marche vers la renaissance berbère. Ce fut le cas au Maroc pour le « manifeste berbère » de 2000 écrit par des intellectuels proches du tout jeune souverain Mohammed VI(beaucoup plus favorable à la culture amazighe qui son prédécesseur le roi Hassan II).
Le moins qu’on puisse dire est que, si renaissance il y a, il a fallu la conquérir de haute lutte. Son ennemi principal, le salafisme (ou fondamentalisme), ne manque pas de ressources ni d’appuis.
Denise Brahimi
« BAYA , FEMMES EN LEUR JARDIN », Institut du Monde arabe, CLEA, Barzakh, Images plurielles 2022
Ce serait mésestimer ce très beau livre que de le présenter comme le catalogue de l’exposition Baya qui a lieu en ce moment et jusqu’au 26 mars 2023 à l’Institut du monde arabe à Paris, avant d’être présenté, pendant l’été qui vient, au Centre de la Vieille Charité à Marseille. Car s’il est vrai que ce livre magnifique et véritablement enchanteur nous est proposé à l’occasion de l’exposition, il est évidemment bien plus qu’un simple catalogue, ne serait-ce que par l’abondance des reproductions qu’il contient (entre 150 et 200) mais aussi par la très riche documentation qu’il a réunie dont un article intitulé modestement « Baya , vie et œuvre» qui regroupe et commente tout ce qu’on peut savoir aujourd’hui sur cette artiste.
Car s’il est vrai que ce livre magnifique et véritablement enchanteur nous est proposé à l’occasion de l’exposition, il est évidemment bien plus qu’un simple catalogue, ne serait-ce que par l’abondance des reproductions qu’il contient (entre 150 et 200) mais aussi par la très riche documentation qu’il a réunie dont un article intitulé modestement « Baya , vie et œuvre» qui regroupe et commente tout ce qu’on peut savoir aujourd’hui sur cette artiste.
La très riche reproduction de son œuvre commence avec ses premiers dessins, de 1944 à 1946, alors qu’elle est encore une très jeune adolescente, sinon une enfant, puisque elle est née en 1931, et elle va jusqu’à ses dernières peintures de l’année 1998, qui est celle de sa mort. S’il est vrai que pour beaucoup de ceux qui la connaissent, son œuvre consiste essentiellement en peintures, le livre montre aussi les sculptures et céramiques qui sont des œuvres de la première partie de sa vie et il permet de suivre de manière très complète ce qui a été son cheminement d’artiste, qui comporte deux périodes séparées par une longue interruption. La première va jusqu’au début des années 50, c’est-à-dire jusqu’au moment où commence la guerre d’indépendance de l’Algérie, tandis que la seconde reprend après la fin de cette guerre et va jusqu’à la mort de Baya à la fin de l’année 1998. De la première période on retient souvent, principalement, ce qui fut le surgissement de la très jeune Baya âgée de 16 ans sur la scène artistique, sorte de petit miracle souvent raconté parce qu’il met en scène des personnages prestigieux, tous français en cette époque où l’Algérie est encore une colonie. Baya est née de parents l’un et l’autre algériens mais celle qui a joué un rôle déterminant dans sa vie à tous égards est sa mère adoptive, Marguerite, qui lui permit de découvrir sa vocation, sans chercher à l’influencer dans le choix de ses sujets et dans l’orientation de son imaginaire. C’est aussi grâce à elle évidemment que Baya est « découverte » par Aimé Maeght qui a une galerie à Paris et y organise en 1947 sa première exposition personnelle. Albert Camus exprime son enthousiasme à cet égard : « J’ai beaucoup admiré l’espèce de miracle dont témoigne chacune de ses œuvres. Dans ce Paris noir et apeuré, c’est une joie des yeux ». Mais c’est surtout l’article d’André Breton et son magnifique éloge poétique qui consacre le génie original de la jeune artiste. Sa belle conclusion est souvent citée : « Baya dont la mission est de recharger de sens ces beaux mots nostalgiques : l’Arabie heureuse. Baya, qui tient et ranime le rameau d’or ».
De la première période on retient souvent, principalement, ce qui fut le surgissement de la très jeune Baya âgée de 16 ans sur la scène artistique, sorte de petit miracle souvent raconté parce qu’il met en scène des personnages prestigieux, tous français en cette époque où l’Algérie est encore une colonie. Baya est née de parents l’un et l’autre algériens mais celle qui a joué un rôle déterminant dans sa vie à tous égards est sa mère adoptive, Marguerite, qui lui permit de découvrir sa vocation, sans chercher à l’influencer dans le choix de ses sujets et dans l’orientation de son imaginaire. C’est aussi grâce à elle évidemment que Baya est « découverte » par Aimé Maeght qui a une galerie à Paris et y organise en 1947 sa première exposition personnelle. Albert Camus exprime son enthousiasme à cet égard : « J’ai beaucoup admiré l’espèce de miracle dont témoigne chacune de ses œuvres. Dans ce Paris noir et apeuré, c’est une joie des yeux ». Mais c’est surtout l’article d’André Breton et son magnifique éloge poétique qui consacre le génie original de la jeune artiste. Sa belle conclusion est souvent citée : « Baya dont la mission est de recharger de sens ces beaux mots nostalgiques : l’Arabie heureuse. Baya, qui tient et ranime le rameau d’or ».
A cette époque et grâce à l’action de Jean Dubuffet, la création de Baya, à tort ou à raison, est souvent rattachée à l’art brut. De manière prévisible on cherche à l’identifier, mais toujours par rapport aux catégories de l’art européen. En fait, c’est dans la seconde partie de son œuvre, après 1962, que Baya s’impose par la splendeur de ses peintures. Elle n’a plus besoin du parrainage des artistes français qui pouvaient difficilement échapper à la vision orientaliste ou orientalisante encore en vogue au moment où ils écrivaient sur elle. Elle est désormais une artiste à part entière, qui impose sa vision du monde, un monde certes idéal, voire paradisiaque, plein d’oiseaux, de fleurs et de papillons, un monde sur lequel règnent des femmes aux robes superbement colorées, et dans lequel la présence d’instruments de musique suggère l’idée d’une harmonie. Ce qui frappe est l’extrême luminosité des couleurs franches et brillantes, suggérant une beauté sans mélange jusqu’au moment où dans ses dernières années, elle passe à une gamme plus sombre ou plus atténuée.
En fait, c’est dans la seconde partie de son œuvre, après 1962, que Baya s’impose par la splendeur de ses peintures. Elle n’a plus besoin du parrainage des artistes français qui pouvaient difficilement échapper à la vision orientaliste ou orientalisante encore en vogue au moment où ils écrivaient sur elle. Elle est désormais une artiste à part entière, qui impose sa vision du monde, un monde certes idéal, voire paradisiaque, plein d’oiseaux, de fleurs et de papillons, un monde sur lequel règnent des femmes aux robes superbement colorées, et dans lequel la présence d’instruments de musique suggère l’idée d’une harmonie. Ce qui frappe est l’extrême luminosité des couleurs franches et brillantes, suggérant une beauté sans mélange jusqu’au moment où dans ses dernières années, elle passe à une gamme plus sombre ou plus atténuée.
Anissa Bouayed, l’auteure du texte intitulé « Baya, vie et œuvre » parle à son propos, pour les années 70 et 80, d’un « art de la plénitude». On peut garder ce mot pour l’image de la femme qui se dégage alors de ses peintures. Au lieu de revendiquer en faveur de la femme en général ou de l’Algérienne en particulier, encore et toujours victime, Baya s’y prend autrement pour parler du féminin, mais non moins efficacement : elle montre ce qu’est ou ce que serait sa puissance et sa beauté, dans un monde où il n’y aurait pas d’obstacle à son épanouissement. C’est évidemment pour éviter toute confusion entre la  vie réelle et la vie rêvée que, en 1990, l’Algérienne et féministe Assia Djebar écrit un article qu’elle intitule « le combat de Baya ». Elle y fait allusion à l’incompréhension rencontrée par l’œuvre de Baya dans les milieux officiels de la peinture algérienne après 1962. Sans doute n’était-il pas politiquement correct de montrer ce qu’aurait pu être la femme si …en tout cas dans un autre monde que celui où on s’appliquait à la confiner. « Femme démunie dans la petite ville de province qui enserre ». C’est ainsi qu’Assia Djebar décrit Baya : par ses tableaux, qui seraient comme un démenti à cette réalité, elle se projette dans l’Algérie heureuse qu’évoquait André Breton.
vie réelle et la vie rêvée que, en 1990, l’Algérienne et féministe Assia Djebar écrit un article qu’elle intitule « le combat de Baya ». Elle y fait allusion à l’incompréhension rencontrée par l’œuvre de Baya dans les milieux officiels de la peinture algérienne après 1962. Sans doute n’était-il pas politiquement correct de montrer ce qu’aurait pu être la femme si …en tout cas dans un autre monde que celui où on s’appliquait à la confiner. « Femme démunie dans la petite ville de province qui enserre ». C’est ainsi qu’Assia Djebar décrit Baya : par ses tableaux, qui seraient comme un démenti à cette réalité, elle se projette dans l’Algérie heureuse qu’évoquait André Breton.
Denise Brahimi
« LA VIE EST UN POEME », Mélanges offerts au professeur Ridha Bourkhis, éditions L’Harmattan, 2022 Ce livre correspond à un usage universitaire selon lequel collègues et amis offrent en commun à l’un d’entre eux, parvenu au terme d’une brillante carrière, un recueil d’hommages plus ou moins longs , sans thème préétabli. Les organisateurs de ce volume l’ont voulu centré sur la poésie, genre très apprécié de l’universitaire tunisien Ridha Bourkhis, écrivain, critique littéraire, esprit ouvert à toutes les formes de littérature.
Ce livre correspond à un usage universitaire selon lequel collègues et amis offrent en commun à l’un d’entre eux, parvenu au terme d’une brillante carrière, un recueil d’hommages plus ou moins longs , sans thème préétabli. Les organisateurs de ce volume l’ont voulu centré sur la poésie, genre très apprécié de l’universitaire tunisien Ridha Bourkhis, écrivain, critique littéraire, esprit ouvert à toutes les formes de littérature.
Beaucoup de ces hommages n’ont rien à voir avec les préoccupations habituelles de Coup de soleil, il était cependant possible d’en choisir au moins un qui nous y ramène, à travers la personne et l’œuvre d’Albert Camus et c’est un plaisir d’y revenir maintenant que l’incroyable vague de popularité que celui-ci a connu récemment semble s’apaiser et retrouver des limites raisonnables.
C’est à cela que nous invitent, semble-t-il, les réflexions du Professeur Georges Zaragoza qui dans ce livre sont intitulées : « La tentation du poétique dans ‘Noces’ et ‘L’été’ de Camus ». On a d’autant plus envie d’en prendre connaissance que tout lecteur de Camus a remarqué un jour ou l’autre la « tentation » exprimée dans ce titre, et généralement pour s’en louer : de toute évidence elle ne s’est pas manifestée au détriment de ses œuvres philosophiques, politiques ou romanesques, et ses effets ont été au contraire pour certaines d’entre elles un avantage supplémentaire. Dans « Noces » et dans « L’été, l’inspiration poétique de Camus se mêle à la pensée que ces essais philosophiques expriment. Georges Zaragoza analyse ce mélange, d’une manière qui le fait entrer en dialogue avec les appréciations du poète Philippe Jaccottet dans un court article paru en 1994 ; et le dialogue est d’autant plus intéressant que Jaccottet se montre assez sévère à l’égard de Camus (il écrit avant cette vague de popularité exaltée et non critique que nous évoquions plus haut, comme propre à la dernière décennie). Georges Zaragoza ne partage pas cette sévérité, cependant son analyse vise à montrer dans l’écriture de ces deux textes de Camus la part d’éléments qui ne sont pas « purement » poétiques, mais il nous incite, (peut-être ?), à penser, que leur beauté n’est pas moins appréciable pour autant.
Georges Zaragoza analyse ce mélange, d’une manière qui le fait entrer en dialogue avec les appréciations du poète Philippe Jaccottet dans un court article paru en 1994 ; et le dialogue est d’autant plus intéressant que Jaccottet se montre assez sévère à l’égard de Camus (il écrit avant cette vague de popularité exaltée et non critique que nous évoquions plus haut, comme propre à la dernière décennie). Georges Zaragoza ne partage pas cette sévérité, cependant son analyse vise à montrer dans l’écriture de ces deux textes de Camus la part d’éléments qui ne sont pas « purement » poétiques, mais il nous incite, (peut-être ?), à penser, que leur beauté n’est pas moins appréciable pour autant.
Si donc on examine de près la particularité de ces textes qu’on appellera philosophico- poétiques (et sans reprendre ici dans toute sa précision le travail d’un éminent spécialiste), on dira qu’ils se caractérisent par le grand soin que Camus apporte à son style, de manière à capter ou à subjuguer le lecteur par des moyens autres que rationnels découlant des idées exprimées et de leur enchaînement. Ce travail sur le volume et le rythme des phrases s’apparente éventuellement à l’art oratoire, et Camus ne recule pas devant des effets qui sont propres à celui-ci —c’est certainement une différence très grande avec l’écriture de Philippe Jacottet.
En fait Georges Zaragoza a recours à une autre comparaison pour nous faire sentir la différence entre la tentation poétique qu’on ressent chez Camus et l’aboutissement poétique ou la poésie « pure » dont il prend un exemple chez René Char— Camus et Char étant liés par ailleurs par une très grande amitié. L’exemple est très bien choisi car la différence en effet ne peut échapper à personne. Mais pour ne pas s’enfermer dans une critique de Camus qui n’est pas son objet, le critique cite aussi un texte de Camus lui-même qui lui est « purement poétique », et très beau. C’est une sorte de cadeau que reçoit en prime le lecteur de cet hommage.
Pour éviter tout sectarisme, et ne pas s’en tenir à une définition rigoriste de la pureté, il faut encore ajouter que les admirateurs de « Noces » — et ils sont légion—ont mille et une excellentes raisons de porter ce texte dans leur cœur et de l’ «aimer sans mesure »— c’est une expression employée par Camus dans « Noces à Tipasa », où il revendique cet amour comme un droit .
Denise Brahimi
« L’AFRIQUE ET LE MONDE: HISTOIRES RENOUEES », sous la direction de François-Xavier Fauvelle et Anne Lafont, éditions La Découverte 2022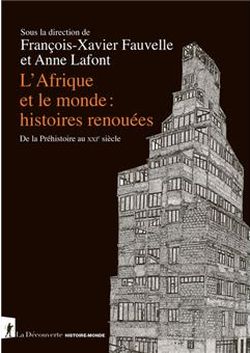 Il est probable qu’on tombera d’abord en arrêt sur un mot de ce titre : que veut dire « renouées » dans l’usage qui en est fait ici ? Il est destiné à détromper les gens qui pensent de manière plus ou moins consciente que l’Afrique et le reste du monde ont toujours eu des histoires séparées, voire fondées sur la violence et le rejet. Il s’agissait donc de montrer au contraire à quel point les échanges n’ont jamais cessé d’être nombreux et variés, autorisant à parler d’une histoire polyphonique et à «éclairer la manière dont les sociétés africaines ont toujours pris part au monde ».
Il est probable qu’on tombera d’abord en arrêt sur un mot de ce titre : que veut dire « renouées » dans l’usage qui en est fait ici ? Il est destiné à détromper les gens qui pensent de manière plus ou moins consciente que l’Afrique et le reste du monde ont toujours eu des histoires séparées, voire fondées sur la violence et le rejet. Il s’agissait donc de montrer au contraire à quel point les échanges n’ont jamais cessé d’être nombreux et variés, autorisant à parler d’une histoire polyphonique et à «éclairer la manière dont les sociétés africaines ont toujours pris part au monde ».
Ce projet est encore nouveau bien qu’il semble intéresser de plus en plus les historiens. S’agissant du Maghreb en tout cas, il entraîne une sorte de décentrement et de changement de perspective, qui met fin à une représentation réductrice et simpliste des relations entre ces trois pays et l’ensemble du continent africain. Dans le livre qui vient d’être publié aux éditions La Découverte, le titre fait référence à l’Afrique subsaharienne, néanmoins on y trouve des indications intéressantes sur les pays situés au nord du continent et en raison de leur originalité, ou de leur rareté, il valait la peine de les prendre en considération.
C’est du Maroc qu’il y est le plus souvent question parce qu’étant donné sa position géographique il a constitué une voie de passage entre le nord et le sud de l’Afrique, usant  également de l’Atlantique qui le longe pour faciliter la circulation entre plusieurs pays. Cette circulation entre le nord de l’Afrique et les pays subsahariens a été notamment celle de l’islam, mais ici encore il faut privilégier les notions nuancées d’échange et de mélange plutôt que de s’en tenir à la vision linéaire trop répandue d’une islamisation venue du nord et soutenue par la violence d’une conquête guerrière.
également de l’Atlantique qui le longe pour faciliter la circulation entre plusieurs pays. Cette circulation entre le nord de l’Afrique et les pays subsahariens a été notamment celle de l’islam, mais ici encore il faut privilégier les notions nuancées d’échange et de mélange plutôt que de s’en tenir à la vision linéaire trop répandue d’une islamisation venue du nord et soutenue par la violence d’une conquête guerrière.
C’est tout l’ensemble des relations entre l’Afrique au nord et au sud du Sahara qui est ou serait à repenser et l’on s’étonne qu’elles l’aient été aussi peu à l’époque coloniale (depuis plus d’un siècle), sans doute parce que selon le vieil adage, on préférait alors diviser pour mieux régner. Malheureusement, la connaissance des sociétés précoloniales, africaines ou maghrébines, n’y a rien gagné.
Il y a pourtant un domaine où la puissance coloniale les a confondues, constituant en une seule doctrine son rapport à la terre africaine, et ce à partir d’une certaine conception de cette nature particulière, exubérante et sauvage : il fut décrété que seule la puissance colonisatrice pouvait en venir à bout à partir de méthodes élaborées par elle et bien différentes de celles qu’avaient en usage les populations indigènes. L’un des effets malheureux fut l’abandon plus ou moins  forcé de celles-ci, dont on a complétement méconnu la raison d’être. Et pourtant il y avait sûrement beaucoup à en apprendre, à condition de ne pas les englober dans une même idée de ce que ne pouvaient manquer d’être la sauvagerie et de ses effets. Il est difficile de comprendre le devenir colonial, et ses aberrations, sans se référer à un certain socle idéologique fondé sur une connaissance sommaire de l’Afrique, subsaharienne ou maghrébine aussi bien, et transportée de l’une à l’autre selon les besoins. La photographie a certainement joué un rôle important dans la constitution des modèles, ou pseudo-modèles mais c’était évidemment le terrain de prédilection de clichés, c’est le cas de le dire, occultant ou refoulant au moins partiellement une vision plus soucieuse d’être fidèle à la réalité.
forcé de celles-ci, dont on a complétement méconnu la raison d’être. Et pourtant il y avait sûrement beaucoup à en apprendre, à condition de ne pas les englober dans une même idée de ce que ne pouvaient manquer d’être la sauvagerie et de ses effets. Il est difficile de comprendre le devenir colonial, et ses aberrations, sans se référer à un certain socle idéologique fondé sur une connaissance sommaire de l’Afrique, subsaharienne ou maghrébine aussi bien, et transportée de l’une à l’autre selon les besoins. La photographie a certainement joué un rôle important dans la constitution des modèles, ou pseudo-modèles mais c’était évidemment le terrain de prédilection de clichés, c’est le cas de le dire, occultant ou refoulant au moins partiellement une vision plus soucieuse d’être fidèle à la réalité.
A propos de la Tunisie, le livre aborde un sujet évidemment épineux mais indispensable à toute espèce d’avancée dans le domaine des relations entre les Afriques, celui de la traite arabo-musulmane. A signaler une initiative tunisienne qui va, indirectement mais judicieusement, contre le silence encore le plus souvent observé : un monument commémore l’abolition de l’esclavage en 1846 (167.000 esclaves auraient été importés dans le pays par la traite saharienne, et le silence n’est sûrement pas la meilleure façon de vivre avec leur souvenir).
Denise Brahimi
« FIGURES ALGERIENNES » de Halima Guerroumi chez Orients Editions 2021
Ce joli petit livre, préfacé par Wassyla Tamzali est une évocation très joyeuse de « femmes inspirantes » algériennes, comme le revendique l’auteure dans son introduction, destinée à transmettre la place éminente prise par les femmes tout au long de l’histoire de cet immense territoire qui allait s’appeler Algérie. C’est un message de femmes à femmes, que ce livre ambitionne d’émettre, prenant la suite des contes qui le portaient il n’y a pas si longtemps. Et ce message, Halima Guerroumi le rédige et l’écrit, certes, mais elle lui 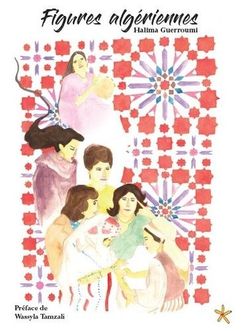 donne une vie très joyeuse dans les dessins colorés qu’elle nous donne à goûter tout au long de l’ouvrage. Des dessins qui secouent la mélancolie qu’y voyait Beaudelaire, et qu’évoque Wassyla Tamzali à propos du célèbre tableau de Delacroix « Les femmes dans un appartement d’Alger ». Elle en conclut qu’on doit à ce tableau une grande part de l’esthétique en Algérie qu’elle juge néo-orientaliste. Esthétique qui selon elle sera combattue par une iconisation de la femme algérienne, héroïne, Nedjma comprise, représentant la Nation, la terre. Cette assignation est aujourd’hui à nouveau remise en question par des créatrices, artistes, qui revendique une tout autre place pour les femmes dans le monde « un chantier de réappropriation de leurs images par les femmes, dans lequel ce livre trouve sa place.
donne une vie très joyeuse dans les dessins colorés qu’elle nous donne à goûter tout au long de l’ouvrage. Des dessins qui secouent la mélancolie qu’y voyait Beaudelaire, et qu’évoque Wassyla Tamzali à propos du célèbre tableau de Delacroix « Les femmes dans un appartement d’Alger ». Elle en conclut qu’on doit à ce tableau une grande part de l’esthétique en Algérie qu’elle juge néo-orientaliste. Esthétique qui selon elle sera combattue par une iconisation de la femme algérienne, héroïne, Nedjma comprise, représentant la Nation, la terre. Cette assignation est aujourd’hui à nouveau remise en question par des créatrices, artistes, qui revendique une tout autre place pour les femmes dans le monde « un chantier de réappropriation de leurs images par les femmes, dans lequel ce livre trouve sa place.
L’auteure a fait sa carrière dans l’Education Nationale française, d’abord comme enseignante en arts appliqués, puis comme Inspectrice.
Le but poursuivi avec ce livre est d’instruire sa fille, et à travers elle les enfants, garçons et filles, dsur la place que les femmes ont prise tout au long de l’histoire de l’Algérie, jusqu’à nos jours. Ce sont 43 femmes qui ont été choisies, et on peut penser qu’elles auraient pu être plus nombreuses.
Toutes les époques sont visitées depuis les héroïnes mythiques comme Tin Hinan, la Kahina, Fatma Tazoughert, aux artistes, chanteuses, écrivaines, aux moudjhidates. Reinette l’Oranaise* salue l’apport de la culture juive, de même que n’est pas oubliée Isabelle Eberhardt ou Taos Amrouche. Des héroïnes de fiction comme Nedjma ou les Ouled Naïl d’Etienne Dinet ont aussi leur place.
 Il faut bien sûr parler des illustrations : des aquarelles très colorées silhouettent toutes ces femmes, reconnaissables sans pourtant qu’il s’agisse de portraits figuratifs. Le livre s’adressant notamment à un public jeune, ses illustrations visent certainement à capter l’intérêt de ce public. Mais elles touchent également bien d’autres publics par leur grâce et leur légèreté. L’auteure indique dans une interview qu’elle a recherché un aspect ludique, joyeux, notamment s’agissant de femmes au destin dramatique. Pari réussi, selon nous : ce livre allie profondeur dans l’ambition qu’il se donne et une joliesse qui capte l’attention. Un manuel féministe à faire connaître.
Il faut bien sûr parler des illustrations : des aquarelles très colorées silhouettent toutes ces femmes, reconnaissables sans pourtant qu’il s’agisse de portraits figuratifs. Le livre s’adressant notamment à un public jeune, ses illustrations visent certainement à capter l’intérêt de ce public. Mais elles touchent également bien d’autres publics par leur grâce et leur légèreté. L’auteure indique dans une interview qu’elle a recherché un aspect ludique, joyeux, notamment s’agissant de femmes au destin dramatique. Pari réussi, selon nous : ce livre allie profondeur dans l’ambition qu’il se donne et une joliesse qui capte l’attention. Un manuel féministe à faire connaître.
Michel Wilson
* C’est en cherchant à illustrer l’annonce de la diffusion de film de Jacqueline Gozland sur Reinette l’Oranaise Le port des amours que nous avons trouvé le dessin qu’en a fait Halima Guerroumi, et découvert son livre à cette occasion.

« LA FAMILLE » film de Merzak Allouache 2021
Peut-être que le commun des spectateurs ne s’y attendait pas, mais Merzak Allouache, grand observateur de la société algérienne à l’œil lucide et souvent malicieux, a plus d’une corde à son arc. La longue période appelée la décennie noire (1990-2000) et ses inévitables suites lui ont fourni le sujet de plusieurs films qui analysent cet ensemble de situations et de faits, mais cette fois ce n’est pas vraiment d’analyse qu’il s’agit, d’autant qu’un certain nombre d’événements et de personnages qui ont été leurs acteurs sont  maintenant connus. Son cadeau, car c’en est un, est une farce, hautement comique même si sur le fond ce qu’elle raconte est tout à fait sinistre. Depuis Omar Gatlato »(1977) qui a été son premier et grand succès, nul n’ignore que Merzak Allouache est un grand maître de l’humour et les Algériens lui ont été extrêmement reconnaissants de les avoir fait rire, rire d’eux-mêmes ce qui est la meilleure sorte d’ humour.
maintenant connus. Son cadeau, car c’en est un, est une farce, hautement comique même si sur le fond ce qu’elle raconte est tout à fait sinistre. Depuis Omar Gatlato »(1977) qui a été son premier et grand succès, nul n’ignore que Merzak Allouache est un grand maître de l’humour et les Algériens lui ont été extrêmement reconnaissants de les avoir fait rire, rire d’eux-mêmes ce qui est la meilleure sorte d’ humour.
Avec « La famille » ce n’est plus vraiment l’humour qui est le procédé choisi, les subtilités de celui-ci seraient mal adaptées à l’énormité de ce dont il s’agit, à savoir les exactions abominables dont se sont rendus coupables un certain nombre des dirigeants au pouvoir pendant la fameuse décennie, jusqu’au moment où l’heure du châtiment sonne pour certains d’entre eux. C’est justement le cas du personnage principal Merouane qui pendant un temps a été ministre—et le moins qu’on puisse dire est qu’il en a bien profité. On voit quelques aspects de son enrichissement personnel, dans le genre appartement de luxe, villa qui ne l’est pas moins, et acquisitions somptueuses dans divers lieux de l’Algérie. Et l’on apprend juste à l’extrême fin du film (moment de la déconfiture absolue !) que sa conduite à l’égard des autres a été parfaitement odieuse pendant toute cette période, brimades diverses et bien pire que cela, dans un arbitraire complet. Ce fut l’exercice d’un pouvoir despotique et corrompu.
Le personnage de l’ex-ministre a des côtés grotesques mais comme il fait aussi un peu peur, ce n’est pas lui le plus comique de la famille mais bien plutôt Madame son épouse Khadidja qui elle est traitée comme une véritable caricature, mégère désopilante, toujours mal peignée, croulant sous la graisse et ridiculement amoureuse de son petit toutou appelé Prince (arrive un moment où on se dit que c’est peut-être la seule forme de tendresse humaine qui reste chez elle, même si elle se manifeste de manière ridicule !).
Il est évident que ce portrait est une charge outrancière pas plus réaliste que celui de Guignol ou de sa commère, c’est un comique qui fait rire à force de grimaces et de coups de bâton. L’épouse de l’ex-ministre, définie principalement par son avidité insatiable, est comme une marionnette agitée par les mains du réalisateur. On peut supposer qu’il a choisi la farce pour désamorcer ce qui a forcément été tragique dans les situations réelles —mais dont il serait tellement pénible de parler sur un mode sérieux qu’il faut absolument écarter le réalisme par l’outrance et la bouffonnerie. Il est évident que Merzak Allouache en cette affaire ne cherche aucune vraisemblance, et surtout pas d’ordre psychologique. S’il avait une idée à faire valoir à cet égard, c’est que le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable. On apprend en effet que l’ex-ministre et son épouse ont été, deux décennies plus tôt, de jeunes militants de gauche comme on en trouvait encore dans les débuts de la présidence Boumédienne. Mais l’avidité, le goût de l’argent et du pouvoir ont eu raison d’eux dès qu’ils ont été en état de les satisfaire. Et ce sont ces traits communs qui les soudent l’un à l’autre de façon indissoluble malgré leurs éternelles chamailleries. On comprend cela mais ce qui importe est de les montrer comme deux pantins qui s’agitent incessamment, tant il est vrai qu’ils ont atteint un stade qui les a complètement déshumanisés. En bon auteur comique (Molière n’est-il pas encore et toujours le modèle ?), le réalisateur veut que son histoire finisse bien, c’est -à-dire mal pour les personnages et bien pour l’exigence morale des spectateurs.
Il est évident que Merzak Allouache en cette affaire ne cherche aucune vraisemblance, et surtout pas d’ordre psychologique. S’il avait une idée à faire valoir à cet égard, c’est que le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable. On apprend en effet que l’ex-ministre et son épouse ont été, deux décennies plus tôt, de jeunes militants de gauche comme on en trouvait encore dans les débuts de la présidence Boumédienne. Mais l’avidité, le goût de l’argent et du pouvoir ont eu raison d’eux dès qu’ils ont été en état de les satisfaire. Et ce sont ces traits communs qui les soudent l’un à l’autre de façon indissoluble malgré leurs éternelles chamailleries. On comprend cela mais ce qui importe est de les montrer comme deux pantins qui s’agitent incessamment, tant il est vrai qu’ils ont atteint un stade qui les a complètement déshumanisés. En bon auteur comique (Molière n’est-il pas encore et toujours le modèle ?), le réalisateur veut que son histoire finisse bien, c’est -à-dire mal pour les personnages et bien pour l’exigence morale des spectateurs.
Il n’est pas interdit de reconnaître au passage quelques aspects de ce que fut la décennie, cette situation historique délétère et toxique : le jeune homme qui a été victime du ministre et qui est prêt à tout pour s’en venger s’acoquine plus ou moins avec des islamistes, ne serait-ce que de se procurer une arme auprès d’eux ; ou parce que de toute façon, dans une situation pareille, il faut choisir son camp.
Le film nous conduit jusqu’aux manifestations du hirak, incluant celles des jeunes féministes et la répression qu’elles subissent. C’est l’occasion de rappeler qu’à peu près au même moment, Merzak Allouache réalise un autre film (qu’on a pu voir à Lyon récemment à l’occasion d’une séance spéciale, unique malheureusement). Ce documentaire, Des femmes (2020) regroupe un nombre important de témoignages variés dont certains remontent jusqu’à la fin des années 80 (et aux manifestations populaires d’octobre 88) pour montrer comment a pris forme peu à peu la lutte difficile des Algériennes contre le patriarcat, au fil d’au moins deux générations et dans des milieux sociaux différents. Des femmes est un film qui donne de l’espoir, quoi qu’il en soit.
Denise Brahimi
« RÊVE » (Argu) film de Omar Belkacemi 2021
Ce qui est remarquable dans ce film algérien est qu’il conjoint un thème hélas à peu près universel dès qu’on parle de société humaine grande ou petite et, dans le traitement qu’il en fait, une très grande originalité propre au lieu où il se situe, un village minuscule dans les montages de Haute Kabylie. Ce thème universel, on le reconnaît d’emblée et malheureusement on ne pourra s’en abstraire à aucun moment du film, c‘est celui de l’exclusion qui fait qu’un groupe, ici une petite communauté villageoise ordinaire, rejette avec violence un individu et veut à toute force le faire disparaître, y compris en le mettant à mort s’il le faut. Omar Belkacemi montre très bien l’incroyable faiblesse des arguments par lesquels le groupe prétend se justifier, en fait il n’y en a qu’un seul et ce n’est pas un argument : celui qui doit être éliminé doit l’être seulement —mais c’est rédhibitoire— parce qu’il n’est pas conforme aux autres, parce qu’il est différent ; et cette différence est le mot clef, alors même que l’exclu n’a jamais fait aucun mal à personne et que son innocence est reconnue. La logique, la raison, devrait s’opposer à la volonté d’exclusion mais celle-ci semble justement d’autant plus opiniâtre qu’elle n’est pas fondée. La différence qui affecte l’exclu, appelé Koukou, consiste principalement dans le fait qu’il laisse flotter sur sa tête une longue chevelure frisée et qu’il joue de la guitare, assis sous un arbre, pendant que les autres vont à la mosquée, ce qui semble d’ailleurs leur seule occupation de la journée, en plus de jouer aux dominos.
Ce thème universel, on le reconnaît d’emblée et malheureusement on ne pourra s’en abstraire à aucun moment du film, c‘est celui de l’exclusion qui fait qu’un groupe, ici une petite communauté villageoise ordinaire, rejette avec violence un individu et veut à toute force le faire disparaître, y compris en le mettant à mort s’il le faut. Omar Belkacemi montre très bien l’incroyable faiblesse des arguments par lesquels le groupe prétend se justifier, en fait il n’y en a qu’un seul et ce n’est pas un argument : celui qui doit être éliminé doit l’être seulement —mais c’est rédhibitoire— parce qu’il n’est pas conforme aux autres, parce qu’il est différent ; et cette différence est le mot clef, alors même que l’exclu n’a jamais fait aucun mal à personne et que son innocence est reconnue. La logique, la raison, devrait s’opposer à la volonté d’exclusion mais celle-ci semble justement d’autant plus opiniâtre qu’elle n’est pas fondée. La différence qui affecte l’exclu, appelé Koukou, consiste principalement dans le fait qu’il laisse flotter sur sa tête une longue chevelure frisée et qu’il joue de la guitare, assis sous un arbre, pendant que les autres vont à la mosquée, ce qui semble d’ailleurs leur seule occupation de la journée, en plus de jouer aux dominos.
A dire vrai, on ne met pas longtemps à découvrir que Koukou se distingue des autres encore autrement, il aime ceux qui souffrent et souffre pour eux, il voudrait les aider ce qui consisterait à changer les mœurs ancestrales qui régissent le pouvoir en invoquant la volonté de Dieu : les forts qui se le sont octroyé l’exercent aux dépens des faibles qui ne peuvent rien opposer à leur domination. Les faibles représentent plus de la moitié de la population puisqu’il s’agit principalement des femmes qui assument à elles seules tout le travail nécessaire pour la vie de la communauté, pendant que les hommes ne font rien. L’exemple le plus frappant de cette sujétion est qu’elles transportent comme des bêtes de somme les fagots de branches feuillues dont se nourrissent les animaux, tandis que les hommes marchent les mains vides à leurs côtés. Pour ce qui est des jeunes filles comme Jura (Djourha ?) la sœur de Koukou, il n’est pas question qu’elles se montrent hors de la cuisine où elles sont enfermées pour trimer. De cette situation traditionnelle et d’ailleurs souvent décrite par les écrivain.e.s, le film ne cherche pas à dire s’il est plus ou moins en train d’évoluer, car tel n’est pas son propos. D’ailleurs il ne donne pas un avis unique, il en propose plutôt deux. Car d’une part on voit une femme, belle, rieuse et en pleine maturité, qui est revenue s’installer au village en tant que « femme libre » (qui ne veut surtout pas se marier !) parce qu’elle espère le faire évoluer. Mais d’autre part, un autre personnage, qu’on voit bien davantage et qui est Mahmoud, le frère de Koukou, est arrivé à une conclusion opposée qui est qu’on ne peut rien faire dans ce village et que la seule solution est d’en partir ; ce qu’il va essayer de faire en deux étapes, une première fois avec Koukou et une deuxième fois en emmenant avec lui sa mère et sa sœur. Mais il faut bien dire que tout projet de sa part est paradoxal car il est profondément nihiliste, voire désespéré, inspiré par Nietzsche (il est professeur de philo à Béjaïa) et persuadé que le bonheur est inaccessible et ne se trouve que dans le rêve, d’où le titre du film. Le rêve, c’est le choix de Koukou, et globalement dans le film on peut dire que le seul refuge contre l’oppression exercée par la société en place est une sorte de mélange compliqué, à la fois exaltant et désespérant, d’amour et de poésie. Koukou a sa guitare pour compagne, Mahmoud a ses  cigarettes et ses très sombres pensées. En vérité, le seul refuge, mais c’est bien davantage, se trouve dans la beauté du monde et le film la montre de manière si admirable, si exceptionnelle, qu’on devrait peut-être commencer par là pour dire ce qu’il est : une présence de la montagne kabyle qui va au-delà de tout ce qu’on peut dire sur la beauté de la nature et les paysages. Ce qu’on en voit submerge la présence humaine à peine suggérée ici ou là par quelques personnages entr’aperçus et qui sont minuscules par rapport à l’amplitude de ce qui est montré. On s’étonnerait presque que celle-ci puisse tenir sur un écran ! Il y a toujours trois au quatre chaînes de montagne qu’on voit à la fois dans la distance, dessinées avec une précision et un raffinement qui pourraient être d’extrême-Orient …s’ils n’étaient kabyles, ce qu’atteste la végétation merveilleusement agitée par un vent léger qui lui donne vie ou plutôt qui en fait l’image même d’un monde vivant.
cigarettes et ses très sombres pensées. En vérité, le seul refuge, mais c’est bien davantage, se trouve dans la beauté du monde et le film la montre de manière si admirable, si exceptionnelle, qu’on devrait peut-être commencer par là pour dire ce qu’il est : une présence de la montagne kabyle qui va au-delà de tout ce qu’on peut dire sur la beauté de la nature et les paysages. Ce qu’on en voit submerge la présence humaine à peine suggérée ici ou là par quelques personnages entr’aperçus et qui sont minuscules par rapport à l’amplitude de ce qui est montré. On s’étonnerait presque que celle-ci puisse tenir sur un écran ! Il y a toujours trois au quatre chaînes de montagne qu’on voit à la fois dans la distance, dessinées avec une précision et un raffinement qui pourraient être d’extrême-Orient …s’ils n’étaient kabyles, ce qu’atteste la végétation merveilleusement agitée par un vent léger qui lui donne vie ou plutôt qui en fait l’image même d’un monde vivant.
Une fois encore, le film arrive à conjuguer deux aspects sans qu’ils soient en conflit, la qualité esthétique continûment assumée et le sens d’une pensée à la recherche d’elle-même, entre métaphysique et poésie. Peut-être faut-il parler encore d’une autre conjonction propre à ce film et qu’on ressent dans un chant longuement reproduit de Taos Amrouche, interprète inimitable des « Chants berbères de Kabylie » : mélange d’inflexions d’une bouleversante douceur et d’une violence inhérente à la géographie et à l’histoire de ce pays. Les historiens diront en effet que nous sommes dans une Kabylie d’après 1871, qui fut sa dernière tentative pour sauver sa force et sa liberté.
Ce film est comme un très beau et très triste chant.
Denise Brahimi
« DIVERTIMENTO » film de Marie-Castille Mention-Schaar, 2023
Ce film est à la fois beau et émouvant, il est consacré à deux sœurs musiciennes dont l’une est cheffe d’orchestre et l’autre violoncelliste, étant parvenues à réaliser ce qui était leur ambition dès leur plus jeune âge, comme on peut voir dans ce film qui commence lorsqu’elles ont dix-sept ans, en 1995. Elle vivent dans une famille modeste de banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis, leurs deux parents sont d’origine algérienne, ce qui ne les empêche pas d’être passionnés par la musique classique, à laquelle les deux jeunes  filles, Zahia et Fettouma Ziouani décident se consacrer leur avenir professionnel. Elles y parviendront et les faits sur lesquels repose le film sont vrais, même s’il a évidemment fallu faire jouer le rôle des sœurs Ziouani par de jeunes actrices, qui sont d’ailleurs excellentes. Cependant il serait injuste de ne pas rendre hommage à la remarquable interprétation par l’acteur Niels Arestrup d’un personnage bien réel lui aussi et qui reste connu aujourd’hui même s’il est moins célèbre qu’il ne le fut en son temps. Il s’agit du musicien et chef d’orchestre Célibidache, d’origine roumaine mais de prestance internationale, étonnant mélange de qualités dont une très grande exigence musicale et de défauts aussi graves à nos yeux d’aujourd’hui que son mépris des femmes et ses sautes d’humeur caractérielles qui sont à deux doigts de décourager son élève et disciple Zahia Zouani.
filles, Zahia et Fettouma Ziouani décident se consacrer leur avenir professionnel. Elles y parviendront et les faits sur lesquels repose le film sont vrais, même s’il a évidemment fallu faire jouer le rôle des sœurs Ziouani par de jeunes actrices, qui sont d’ailleurs excellentes. Cependant il serait injuste de ne pas rendre hommage à la remarquable interprétation par l’acteur Niels Arestrup d’un personnage bien réel lui aussi et qui reste connu aujourd’hui même s’il est moins célèbre qu’il ne le fut en son temps. Il s’agit du musicien et chef d’orchestre Célibidache, d’origine roumaine mais de prestance internationale, étonnant mélange de qualités dont une très grande exigence musicale et de défauts aussi graves à nos yeux d’aujourd’hui que son mépris des femmes et ses sautes d’humeur caractérielles qui sont à deux doigts de décourager son élève et disciple Zahia Zouani.
Cependant Zahia résiste, grâce à un courage et à une exceptionnelle ténacité, grâce aussi à la présence de sa sœur qui veille sur elle et lui assure un soutien constant. A cet égard, le film est un hommage émouvant à la sororité, tant il est vrai que pour surmonter des obstacles aussi considérables il faut avoir au moins quelques atouts comme ceux que Zahia trouve dans sa propre famille, dont l’amour est indéfectible. Comment sont présentés dans le film les obstacles que Zahia doit affronter ? On est très reconnaissant à la réalisatrice de ne pas céder à la facilité qui consisterait à montrer en Zahia une sorte de paria persécutée par le racisme ambiant du fait de son origine. Il est évident que Zahia a deux handicaps considérables, d’une part son origine sociale, face à un rival qui lui au contraire est né dans le sérail et s’en prévaut sans scrupule, et d’autre part le fait d’être une femme, dans un milieu où la formule imparable à chaque instant employée est qu’un chef d’orchestre se doit d’être un homme. On est alors en 1995 et l’on peut espérer que les choses sont maintenant en train de changer, grâce à tous les mouvements qui concernent la place des femmes dans la société. D’ailleurs, au même moment que « Divertimento » sort sur les écrans un autre film « Tàr », américain celui-là, consacré lui aussi à une femme chef d’orchestre. On se dit avec joie qu’un verrou est sans doute en train de sauter.
Comment sont présentés dans le film les obstacles que Zahia doit affronter ? On est très reconnaissant à la réalisatrice de ne pas céder à la facilité qui consisterait à montrer en Zahia une sorte de paria persécutée par le racisme ambiant du fait de son origine. Il est évident que Zahia a deux handicaps considérables, d’une part son origine sociale, face à un rival qui lui au contraire est né dans le sérail et s’en prévaut sans scrupule, et d’autre part le fait d’être une femme, dans un milieu où la formule imparable à chaque instant employée est qu’un chef d’orchestre se doit d’être un homme. On est alors en 1995 et l’on peut espérer que les choses sont maintenant en train de changer, grâce à tous les mouvements qui concernent la place des femmes dans la société. D’ailleurs, au même moment que « Divertimento » sort sur les écrans un autre film « Tàr », américain celui-là, consacré lui aussi à une femme chef d’orchestre. On se dit avec joie qu’un verrou est sans doute en train de sauter.
Il n’est jamais facile d’évaluer toutes les composantes qui entrent en ligne de compte dans la définition d’un destin, on a tout de même envie de dire que dans le cas de Zahia Ziouani, rien n’aurait été possible sans les exceptionnelles aptitudes musicales qui ont déterminé sa vocation ; et de ce fait on a l’impression que dans son cas—mais il faut  s’empresser d’ajouter que son cas est d’une remarquable singularité— d’autres facteurs ont permis d’échapper à l’enfermement dans le déterminisme social sur lequel a tant insisté le sociologue Pierre Bourdieu. Mieux vaudrait sans doute s’adresser à un autre sociologue tel que Stéphane Beaud (dont La Lettre a déjà parlé), pour analyser le cas des sœurs Ziouani ; mais cette analyse n’est pas du tout ce qu’a voulu faire ici la réalisatrice du film, elle n’a pas écrit un bréviaire de la réussite sociale en milieu défavorisé, même si l’on sent parfaitement son attachement, ainsi que celui de ses principaux personnages, pour la petite ville de Stains, en Seine-Saint-Denis. Le maire est un personnage très sympathique (peut-être un mélange du maire de l’époque et du maire actuel ?) mais Zahia a aussi pour elle l’ensemble de la population qui vient la soutenir au moment où elle est prête à capituler, devant la difficulté de créer son propre orchestre. On sait qu’elle y est parvenue finalement et que c’est justement cet orchestre qui porte le nom de « Divertimento ».
s’empresser d’ajouter que son cas est d’une remarquable singularité— d’autres facteurs ont permis d’échapper à l’enfermement dans le déterminisme social sur lequel a tant insisté le sociologue Pierre Bourdieu. Mieux vaudrait sans doute s’adresser à un autre sociologue tel que Stéphane Beaud (dont La Lettre a déjà parlé), pour analyser le cas des sœurs Ziouani ; mais cette analyse n’est pas du tout ce qu’a voulu faire ici la réalisatrice du film, elle n’a pas écrit un bréviaire de la réussite sociale en milieu défavorisé, même si l’on sent parfaitement son attachement, ainsi que celui de ses principaux personnages, pour la petite ville de Stains, en Seine-Saint-Denis. Le maire est un personnage très sympathique (peut-être un mélange du maire de l’époque et du maire actuel ?) mais Zahia a aussi pour elle l’ensemble de la population qui vient la soutenir au moment où elle est prête à capituler, devant la difficulté de créer son propre orchestre. On sait qu’elle y est parvenue finalement et que c’est justement cet orchestre qui porte le nom de « Divertimento ».
La réalisatrice n’agit pas en tant que sociologue parce que, si l’on peut dire, elle aime trop ses personnages pour cela, c’est-à-dire pour prendre la distance nécessitée par les sciences humaines à l’égard de leur objet (ce mot lui-même est scientifique). Il y a beaucoup d’amour qui circule dans ce film, c’est pourquoi il ne prend jamais la forme d’une dénonciation. L’attitude la plus remarquable à cet égard est celle des parents Ziouani, joués par deux très bons acteurs, Zinedine Soualem et Nadia Kaci. Le père notamment a ceci de remarquable qu’il fait délibérément et tout naturellement semble-t-il, l’économie de la partie critique que pourrait comporter son regard sur la société. Le gros avantage de cette attitude est qu’elle libère une sorte d’énergie illimitée. A priori tout est possible, on réussit ou pas, mais il ne faut jamais oublier la part de réussite.
Le fonctionnement social étant ce qu’il est, l’histoire racontée par « Divertimento » est aussi une illustration, en tout cas un exemple indéniable, de ce qu’on appelle la méritocratie, un mot qui rime, ou qui devrait rimer plus souvent, avec démocratie. C’est un film qui fait du bien, ce qui n’est pas du tout la même chose que ce qu’on appelle, un « feel good movie » (destiné à faire rire et à faire rêver).
Denise Brahimi
« REINETTE L’ORANAISE, LE PORT DES AMOURS », film par Jacqueline Gozland, 1992
Jacqueline Gozland a réalisé en 1992 ce film documentaire consacré à celle que tout le monde connaît sous le nom de Reinette l’Oranaise alors que cette grande chanteuse et musicienne d’origine juive algérienne devait mourir six ans plus tard, en 1998, après une vie consacrée à la tradition qu’on appelle arabo-andalouse ou plus précisément dans ce cas 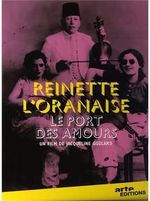 judéo-arabe. On a eu la chance de voir ce film à Lyon grâce aux journées consacrées par Coup de soleil à la culture des Juifs d’Algérie, sous ses différentes formes, dont la musique n’est pas la moindre, puisqu’on apprend qu’elle était présente à peu près dans toutes les circonstances de la vie étant de ce fait à la fois savante et populaire, ce qui est évidemment un trait original et intéressant. Ce n’est d’ailleurs pas le seul rapprochement fusionnel opéré par cette musique qui est à la fois indistinctement arabe et juive, refusant donc la coupure qui n’a cessé de grandir en Algérie entre les deux communautés, notamment depuis un certain décret Crémieux de 1870, représentatif de la politique coloniale et de ce que certains (dont Jacqueline Gozlan) considèrent comme ses erreurs.
judéo-arabe. On a eu la chance de voir ce film à Lyon grâce aux journées consacrées par Coup de soleil à la culture des Juifs d’Algérie, sous ses différentes formes, dont la musique n’est pas la moindre, puisqu’on apprend qu’elle était présente à peu près dans toutes les circonstances de la vie étant de ce fait à la fois savante et populaire, ce qui est évidemment un trait original et intéressant. Ce n’est d’ailleurs pas le seul rapprochement fusionnel opéré par cette musique qui est à la fois indistinctement arabe et juive, refusant donc la coupure qui n’a cessé de grandir en Algérie entre les deux communautés, notamment depuis un certain décret Crémieux de 1870, représentatif de la politique coloniale et de ce que certains (dont Jacqueline Gozlan) considèrent comme ses erreurs.
Jacqueline Gozland a eu la chance de connaître Reinette l’Oranaise, alors qu’elle-même est d’une origine géographique différente, puisque née à Constantine en 1953.C’est dire que la différence d’âge entre elles est importante puisque Reinette l’Oranaise est née semble-il en 1915, le petit doute s’expliquant par le fait qu’elle refusait de répondre sur ce point notamment aux journalistes, qu’elle avait tendance à malmener sans ménagement étant très agacée par leurs questions qu’elle jugeait stupides : Reinette était une forte femme, et Jacqueline Gozland s’amuse beaucoup à donner dans son film quelques exemples de son franc-parler. Il est vrai que les événements de sa vie et la place presque exclusive que la musique y occupait faisaient de Reinette un personnage hors pair, à dire vrai étonnante voire exceptionnelle.
Née à Tiaret dans le nord-ouest de l’Algérie d’un père rabbin d’origine marocaine, Reinette eut le malheur de devenir complétement aveugle dès l’âge de deux ans et ne fut guère convaincue semble-t-il par sa fréquentation de l’Ecole des aveugles à Alger : elle dit elle-même qu’elle n’était pas bonne à l’école, ce qui la vouait à exercer des métiers très modestes, si sa mère ne s’était démenée pour lui trouver un moyen d’y échapper, et ce fut la musique. Dès l’âge de treize ans elle fut agréée à une audition par un maître de la musique arabo-andalouse, jouant de plusieurs instruments avant que son choix ne se fixe sur le oud, qui est le nom du luth arabe. On sait que celui qu’on appelle « prince du luth » est Zyriab, fondateur de la musique arabo-andalouse qui au 9e siècle introduisit le oud en Andalousie (alors qu’il était originaire d’un village kurde en Irak.
Désormais Reinette l’Oranaise ne renoncera jamais à cette carrière, au sein d’un orchestre limité (quatre ou cinq personnes seulement) qui comporte des gens aussi éminents que le pianiste et compositeur Mustapha Skandrani, né en 1920 dans la casbah d’Alger. Sa vie est néanmoins ponctuée d’événements politiques graves, c’est le moins qu’on puisse dire : dans les années 40, il s’agit de la guerre et de la politique menée par le gouvernement contre les Juifs, Reinette quitte Oran pour Alger à l‘âge de 26 ans ; et lorsque advient en Algérie la guerre d’indépendance, elle part cette fois pour Paris.
Ce départ est en fait le grand événement traumatique de sa vie, c’est le début de ce qu’elle va vivre comme un exil, non sans en être affectée gravement. Le film montre de quelle violence elle est capable lorsqu’il en est question. Maladroitement mais de manière attendue, quelqu’un lui pose la question de savoir si elle serait prête à retourner en Algérie au cas où…Elle explose alors avec fureur en disant : c’était la question qu’il ne fallait pas poser ! De fait elle n’y reviendra jamais, à la différence de Jacqueline Gozland qui elle y retournera à partir de 1987, et c’est pour elle l’occasion de rappeler que son deuxième prénom, aussi arabe que juif, est Messaouda.
A côté de ce drame personnel, qui est en fait une véritable tragédie, Reinette poursuit plus que brillamment sa carrière musicale, même si quelqu’un d’aussi proche d’elle que  Jacqueline Gozland ne peut ignorer qu’elle est une femme blessée. Ce qu’on peut certainement entendre dans la thématique de certaines de ses chansons, et même dans la tonalité rauque de sa voix, où il y a sans doute un refus de s’attendrir sur elle-même quoi qu’il en soit.
Jacqueline Gozland ne peut ignorer qu’elle est une femme blessée. Ce qu’on peut certainement entendre dans la thématique de certaines de ses chansons, et même dans la tonalité rauque de sa voix, où il y a sans doute un refus de s’attendrir sur elle-même quoi qu’il en soit.
Pour mieux comprendre le mouvement auquel elle participe où qu’elle soit, il est bon de se reporter à l’action menée au même moment, pendant des décennies, par le musicologue Boudali Safir dont le rôle a été très important pour assurer sa place à la musique arabo-andalouse et en faire une composante très appréciée de la culture judéo-maghrébine. Il est justement de ceux qui transcendent volontairement la distinction entre musique savante et musique populaire. Le film de Jacqueline Gozland est précieux lui aussi dans la lutte contre toutes les formes de différences et de distinctions.
Denise Brahimi
Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.
 – Utiles
– Utiles
de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun
Cliquez ici pour voir le film et le mot de passe utilesjoussour

–Entre nos mains
de Leila Saadna
Cliquez ici pour voir le film, puis mot de passe utilesjoussour
Et sa bande-annonce, cliquez ici

« ENCORE UNE FOIS » De Patrick Bruel 2022 Editions Sony Music
« Parfois on écrit une chanson, et ensuite ça devient le réel ». Cette phrase par laquelle Sonia Devillers conclut sur France Inter son émouvante interview de Patrick Bruel revenu le dimanche précédent de son premier voyage en Algérie avec sa maman Augusta résume cet étonnant voyage retour. Bien des anciens habitants d’Algérie, de toutes origines font ce retour, et racontent les innombrables « bienvenue chez toi » qui les ont accueillis.
Bien des anciens habitants d’Algérie, de toutes origines font ce retour, et racontent les innombrables « bienvenue chez toi » qui les ont accueillis.
Quand il s’agit d’une vedette comme Patrick Bruel qui se revendique comme juif berbère issu de cette Algérie qu’il a quittée avec sa mère à 3 ans cela prend une autre saveur. Quelques islamistes se sont bien exprimés contre ce retour d’une personnalité présentée comme pro-sioniste . Mais l’invitation est venue des autorités algériennes alors que le chanteur terminait « Je reviens », l’une des chansons clés de son dernier album « Encore une fois ». Il y a a mis la dernière main et a pris l’avion pour Tlemcen, sa ville natale, avec Augusta, comme le décrit sa chanson. « Oui, je reviens Ta main dans la mienne, comme on entre sur scène pour un premier rappel Enfin… ».
L’acteur chanteur n’a pas été avare du récit de ce retour, qui a déclenché sur bien des réseaux sociaux une émotion positive, défi qui n’était pas gagné, quand on observe le flot continu des imprécations numériques que déclenche le moindre événement.
Il a terminé son court séjour par la visite de la tombe de Roger Hanin, son papa de cinéma à Bologhine Saint-Eugène. Il raconte aussi que Alexandre Arcady a terminé en Algérie le tournage de son film Le petit blond de la Casbah, adapté de son livre éponyme de 2003. Le tournage en Algérie n’est jamais simple, surtout pour des non Algériens, mais Arcady y parvient pour la deuxième fois, après Ce que le jour doit à la nuit. Cette relation apaisée avec des artistes juifs algériens est à prendre selon nous comme un message positif, denrée rare dans la relation officielle franco-algérienne. Enrico Macias, un jour ? Bruel y croit… Son album dans lequel il s’entoure de gens de talents, paroliers, musiciens et arrangeurs contient des textes intéressants, moments de vie, de bilan personnel. La voix que Bruel a cassée de longue date donne à ces chansons une belle profondeur.
Son album dans lequel il s’entoure de gens de talents, paroliers, musiciens et arrangeurs contient des textes intéressants, moments de vie, de bilan personnel. La voix que Bruel a cassée de longue date donne à ces chansons une belle profondeur.
Mais ce sont bien sûr Je reviens, paroles et musique de Patrick Bruel, et L’instit, superbe hommage à sa maman qui a fait toute sa carrière à Tlemcen puis Argenteuil, où elle a retrouvé quelques élèves tlemceniens. Que l’on retiendra ici. La première est orchestrée avec bendir et derbouka et est une déclaration d’amour à l’Algérie et son peuple. Et l’auteur de ces lignes ne cache pas le délicat plaisir qu’il prend à l’écouter. Tout comme du reste L’instit : les bonnes chansons, on contraire de la littérature (du moins si on en croit Henri Jeanson) peuvent être construites sur de bons sentiments.
Apprécions ce message d’amitié et d’amour, par delà la séparation et le temps qui passe en l’Algérie et ses enfants exilés.
Un concert à Alger suivra peut-être. Acceptons-en l’augure . Les bons moments ne sont pas si fréquents…
Michel Wilson

Si vous souhaitez aider notre association régionale à développer ses actions, vous avez aussi la possibilité de faire un DON, via Hello Asso. Soyez-en remercié.e.s.
Si vous souhaitez vous investir à nos côtés, nous serions heureux d’accueillir votre adhésion. Il vous est possible de le faire en ligne sur notre site via Hello Asso.

Vous pouvez aussi nous commander notre livre « Algérie à coeur » en envoyant un chèque de 16€, port compris,
chez Michel Wilson 5 rue Auguste Comte 69002 LYON.
Et également vous avez la possibilité de souscrire en ligne sur notre site à l’ultime numéro de la Revue Le Croquant, un hommage à son créateur Michel Cornaton, que nous avons co-édité.
Nous souhaitons aussi contribuer à la diffusion du livre posthume de notre cher Abdelhamid LAGHOUATI, poète, artiste plasticien, ami de Jean Sénac et de tant d’autres. Une souscription est ouverte pour commander son livre par la Maison de la Poésie Rhône-Alpes à Saint Martin d’Hères.
SOUSCRIPTION
BON DE COMMANDE
Je commande .. .. .. .. exemplaire(s) de « Entre cri et passion » de Abdelhamid Laghouati.
Je règle par : ☐ chèque bancaire
☐ autre moyen (sauf carte bancaire)
☐ postal
À l’ordre de :
Maison de la Poésie Rhône-Alpes
33 avenue Ambroise Croizat
38400 Saint-Martin-d’Hères
Date : .. .. / .. .. / .. .. Signature :

- Samedi 4 mars, à l’IFCM de Lyon, journée Assia Djebar: table ronde, exposition, film La Nouba des femmes du mont Chenoua
- Du 2 au 4 mars au théâtre de l’Iris de Villeurbanne, pièce Les pieds tanqués
- Du 9 au 14 mars au Théâtre de l’Iris pièce Le village de l’Allemand
- Samedi 11 mars à 16h30 au cinéma Mon Ciné de Saint Martin d’Hères, Film Gardien du monde en présence de la réalisatrice Leila Chaibi
- Mercredi 15 mars au cinéma Lumière Bellecour films Papicha et Houria de Mounia Meddour, partenariat Coup de Soleil
- vendredi 17 mars 20h au Théâtre de l’Iris conférence Les Français et la musique arabe en Algérie avant 1962 par Martiel Pardo
- Vendredi 17 mars intervention témoignages croisés sur la guerre d’Algérie au Lycée Fernand Forest de Saint Priest
- Vendredi 17 mars au cinéma de Charlieu (42), films Ils ne savaient pas que c’était une guerre de JP Julliand, et Hors la loi de Rachid Bouchareb, débat animé par Coup de Soleil et l’association des pieds noirs progressistes
- Jeudi 23 et vendredi 24 mars au Théâtre de l’Iris, pièce de théâtre Pourquoi les oiseaux ont-ils disparu, d’après Rachid Mimouni, par la Compagnie Leila Soleil. Coproduction Coup de Soleil
- Jeudi 23 mars intervention témoignages croisés sur la guerre d’Algérie au Lycée de l’Immaculée conception de Villeurbanne
- Samedi 25 mars au Théâtre de l’Iris concert de Nouiba (musique chaabi)
- Lundi 27 mars intervention témoignages croisés sur la guerre d’Algérie au collège Lucie Aubrac de Givors
- Mardi 28 mars intervention témoignages croisés sur la guerre d’Algérie au collège Lumière d’Oyonnax
- Du 28 au 30 mars à 20h au Théâtre de l’Iris pièce de théâtre d’Eckmühl à Eckmühl
- Vendredi 31 mars à 20h au Théâtre de l’Iris Conférence gesticulée de Nadège de Vaulx « J’aurais dû m’appeler Aïcha »
N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.


