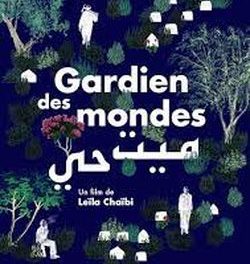Editorial
Vacances studieuses, avec ou sans lecture? N’importe, puisque le moment est venu de tourner la page sur cet été caniculaire et de revenir à nos rubriques habituelles.
Parmi les livres, on trouvera notre mélange d’essais, de mémoires ou de fiction : grâce au travail de Jean-Pierre Bénisti et à son inépuisable mémoire, nous éprouvons l’ambiance d’une Algérie encore camusienne et surtout éprise de création artistique. L’Algérie juive et séfarade est présente dans cette sélection grâce au livre de Monique Zerdoun et à son remarquable héros Raphaël Ben Israël. L’originalité du livre de Najat El Hachemi où se mêlent mémoires et fictions vient du fait que le pays européen à partir duquel s’y trouve évoqué le Rif marocain est l’Espagne (Catalogne) variante intéressante par rapport au très riche fonds alimenté par les franco-maghrébin(e)s.
La Bande dessinée continue à prendre sa place dans la création franco maghrébine, en particulier grâce au travail de la maison d’édition Alifbata: deux albums parlent de révolution, l’un marocain, l’autre tunisien, Michel Wilson nous fait approcher leur contenu.
Parmi les films, la diversité étonnante qui nous émerveille toujours chez les réalisateurs du Maghreb nous permet d’apprécier cette fois ce qu’il en est du rapport père/fils dans ce qu’on pourrait appeler un film d’homme : »Les Meutes » de Kamel Lazrak ainsi que du rapport mère/filles dans ce film de femme : « Les filles d’Olfa », de la Tunisienne Kaouther ben Hania. Mais il y a bien d’autres choses encore dans ces évocations riches et originales. D’ailleurs, « Les filles d’Olfa »est défini comme un « documentaire fiction ».
Pour nourrir le dossier des notes de présentation , la finalité du travail universitaire consacré par deux équipes de chercheurs à ces grands classiques que sont Mouloud Feraoun et Mohammed Dib se voudrait d’être une incitation à une relecture de leurs écrits. Cette relecture toujours riche en découvertes montre la nécessité de se battre contre les idées reçues. Ces travaux sont un plaidoyer contre les enfermements de toute origine, idéologiques et politiques mais pas seulement.
Le livre atypique de Samira Sédira, « Un jour j’ai menti » montre la place d’une Algérie fantasmatique dans nos imaginaires contemporains. de quoi l’Algérie est-elle le nom? C’est sans doute la question que nous aurons de plus en plus à nous poser.
Terminons ces notes par un documentaire assez court d’un réalisateur marocain sur les jeunes footballeuses de la petite ville de Khenifra.
Denise Brahimi

Peut-être souhaitez-vous faire un don à notre association, pour contribuer à notre fonctionnement? Et notamment au coût de réalisation de cette Lettre?
Vous en avez la possibilité en cliquant ICI. Merci d’avance!

« A PROPOS DE CAMUS, DE SENAC ET DE L’ALGERIE » par Jean-Pierre Bénisti, L’Harmattan, 2023
L’auteur de ces « souvenirs et réflexions » les consacre certes à sa propre histoire mais plus encore à celle de son père, le peintre Louis Bénisti qui vécut une bonne partie de sa vie en Algérie. Il appartenait à la société dite pied-noire et essaya de prolonger ce mode de vie pendant dix ans au-delà de l’indépendance de l’Algérie puisque c’est seulement en 1972 que tout la famille revint s’installer en France, y compris Jean-Pierre qui était né en 1943 et qui avait donc à peine trente ans au moment de ce retour. Les souvenirs qu’il évoque remontent le plus souvent à l’époque de son enfance et de son adolescence et l’on peut dire que globalement ce sont des souvenirs heureux, même si surviennent au centre de cette période les années de la guerre d’Algérie, de plus en plus difficiles à vivre à partir de 1954. Jean-Pierre Bénisti n’entreprend évidemment pas de suivre continûment le fil de l’histoire, ni celle de l’Algérie ni la sienne et celle de ses parents. Il nous en donne des fragments, qui dans une première partie font une place importante à Camus, dont on peut dire que Louis Bénisti fut un proche, même si Camus vivait essentiellement à Paris, alors que les Bénisti vivaient encore en Algérie ainsi que la plupart de leurs amis. Dans la seconde partie du livre et principalement à partir de l’été 1962 ou été de l’indépendance, le personnage principal devient Jean Sénac , plus âgé que Jean-Pierre puisque né en 1926 mais plus jeune que son père Louis Bénisti né en 1903.
Jean-Pierre Bénisti n’entreprend évidemment pas de suivre continûment le fil de l’histoire, ni celle de l’Algérie ni la sienne et celle de ses parents. Il nous en donne des fragments, qui dans une première partie font une place importante à Camus, dont on peut dire que Louis Bénisti fut un proche, même si Camus vivait essentiellement à Paris, alors que les Bénisti vivaient encore en Algérie ainsi que la plupart de leurs amis. Dans la seconde partie du livre et principalement à partir de l’été 1962 ou été de l’indépendance, le personnage principal devient Jean Sénac , plus âgé que Jean-Pierre puisque né en 1926 mais plus jeune que son père Louis Bénisti né en 1903.
En fait on peut dire qu’à travers des intermédiaires et en remontant dans l’histoire de son père, l’histoire ou plutôt les histoires racontées par Jean-Pierre Bénisti recouvrent partiellement trois générations constitutives de l’Algérie pied-noire, qui n’est plus comme le dit le sous-titre de son livre qu’un ensemble de souvenirs —mais de souvenirs qui lorsqu’ils sont évoqués par un homme comme lui sont extrêmement vivaces et présents. Jean-Pierre Bénisti a l’art de faire revivre des personnages du passé en leur donnant une grande proximité en sorte que tous ceux qui furent les amis de son père, et ils sont nombreux, nous donnent le sentiment d’être présents ou presque encore aujourd’hui. Quels que soient les faits, pas nécessairement d’une grande importance historique, qu’il prend plaisir à évoquer, il a un art de l’anecdote qui fait que, comme on dit familièrement, on s’y croirait : pendant les années 50 et du fait de la guerre d’Algérie qui sans doute a resserré certains liens, on a l’impression de partager les relations quotidiennes d’un petit groupe d’amis qui se voient beaucoup et essaient de suivre tant bien que mal l’évolution des faits, plus tard livrés aux commentaires des historiens.
Globalement et avec quelques nuances individuelles, ces proches amis sont de ceux qu’on appelait alors des Libéraux sans y mettre la moindre signification économique comme dans le sens actuel du mot, mais dans le sens qu’il avait alors, purement politique et sociétal : tous ces gens, souvent des intellectuels et des artistes, sont des modérés qui réprouvent tous les excès et toutes les formes de terrorisme, aussi bien ceux des indépendantistes d’autant plus violents que clandestins ou ceux des tenants de l’Algérie française, qui constitueront finalement l’OAS ou Organisation Armée secrète prête à lutter par tous les moyens contre l’indépendance.
Au début de la guerre, on peut dire que le groupe auquel appartenaient les Bénisti était proche de Camus, et c’est à ce titre qu’ils se sont trouvés mêlés de très près à la revendication pour une Trêve civile du 22 janvier 1956, pour laquelle Camus était venu spécialement faire une conférence à Alger. Jean-Pierre Bénisti, alors jeune lycéen, s’est trouvé dans les coulisses de cet événement, sur lequel des analystes politiques sont revenus récemment mais qui malheureusement n’eut guère d’impact au moment où il s’est produit ; il était sans doute déjà trop tard pour tenter d’enrayer les pratiques violentes, de plus en plus meurtrières.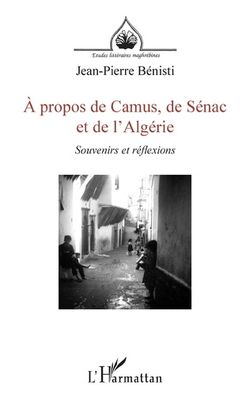 L’auteur de ces « Souvenirs » revient à la politique à travers Sénac qui ayant passé la guerre d’Algérie en tant que militant sur le sol français n’a pas manqué de revenir à Alger sitôt après l’indépendance et a participé très activement à la mise en place de celle-ci , du moins dans le domaine culturel. Jean-Pierre Bénisti n’entreprend pas de raconter comment la situation de Sénac a dégénéré à partir de ces débuts flamboyants, jusqu’à son assassinat le 30 août 1973, il y aura bientôt cinquante ans. En revanche, il insère dans son livre deux notes qu’il a consacrées à Sénac en 1983.
L’auteur de ces « Souvenirs » revient à la politique à travers Sénac qui ayant passé la guerre d’Algérie en tant que militant sur le sol français n’a pas manqué de revenir à Alger sitôt après l’indépendance et a participé très activement à la mise en place de celle-ci , du moins dans le domaine culturel. Jean-Pierre Bénisti n’entreprend pas de raconter comment la situation de Sénac a dégénéré à partir de ces débuts flamboyants, jusqu’à son assassinat le 30 août 1973, il y aura bientôt cinquante ans. En revanche, il insère dans son livre deux notes qu’il a consacrées à Sénac en 1983.
Parmi les personnages connus il s’attache également à la fin de son livre à l’éditeur Edmond Charlot, à peu près contemporain de Camus dont il publia les premiers livres et dont la vie n’a jamais cessé d’être liée à l’histoire de l’Algérie, jusqu’ à sa mort en France en 2004.
Jean-Pierre Bénisti lui aussi a maintenu jusqu’à aujourd’hui cette sorte de lien, d’autant plus fort qu’il est à la fois pour lui un lien collectif avec ce pays et un lien personnel avec son père.
Denise Brahimi
« L’ECLAT SINGULIER DU LAPIS-LAZULI » par Monique Zerdoun, éditions Auteurs du monde, 2022
Ce gros livre est historique, il retrace 40 années d’histoire juive telle que vécue au nord-est du Maghreb dans la région de la ville qui s’est appelée à l’époque coloniale Constantine. La communauté juive avec laquelle on fait connaissance est très réduite en nombre, puisqu’on la voit à l’échelle d’un tout petit village appelé Aïn-el-Kelma. Cependant le personnage principal, Raphaël ben Israël, dont on fait la connaissance en 1827, alors qu’il n’a même pas 14 ans, est exceptionnel par son intelligence et sa curiosité d’esprit. Raison pour laquelle, à la recherche du savoir, il quittera son village pour aller s’instruire, audacieusement mais avec l’accord des siens, dans la ville italienne de Livorno (Livourne) en Toscane, connue pour l’accueil favorable qui y fut fait aux Juifs, grâce à la protection du Grand Duc de Toscane , alors que la Reconquête catholique les obligeait à fuir l’Espagne (appelée Sepharad). Il y eut dès lors à Livorno un essor remarquable de la culture juive, aussi moderne que respectueuse des traditions. A cet égard, elle représente l’inverse du très archaïque village d’Aïn-el-Kelma, exemplaire de la judéité nord-africaine dans un lieu reculé de ce qui allait devenir l’Algérie, en cette époque coloniale qui commence tout juste au moment où s’ouvre le roman. Monique Zerdoun décrit ainsi deux aspects opposés de la vie juive et les faits connaître à Raphaël ben Israël, personnage remarquable qui travaillera à sa propre émancipation, notamment en apprenant à manier plusieurs langues alors qu’au départ il ne pratique rien d’autre que l’arabe dialectal comme tous les juifs de sa petite communauté : par son mariage avec une Livournaise, il est amené à découvrir l’italien, puis le français grâce à l’aide d’un jeune Français relégué en Algérie pour raison politique après l’échec de l’élan révolutionnaire de 1848. On voit bien que l’auteure cherche à élargir ce qui n’est encore en 1830 qu’un très petit monde refermé sur lui-même et sans aucune communication avec l’extérieur. Celle-ci n’est alors assurée que très modestement par les colporteurs qui sont amenés à circuler et transportent avec eux quelques nouvelles, non sans retard sur les événements.
Monique Zerdoun décrit ainsi deux aspects opposés de la vie juive et les faits connaître à Raphaël ben Israël, personnage remarquable qui travaillera à sa propre émancipation, notamment en apprenant à manier plusieurs langues alors qu’au départ il ne pratique rien d’autre que l’arabe dialectal comme tous les juifs de sa petite communauté : par son mariage avec une Livournaise, il est amené à découvrir l’italien, puis le français grâce à l’aide d’un jeune Français relégué en Algérie pour raison politique après l’échec de l’élan révolutionnaire de 1848. On voit bien que l’auteure cherche à élargir ce qui n’est encore en 1830 qu’un très petit monde refermé sur lui-même et sans aucune communication avec l’extérieur. Celle-ci n’est alors assurée que très modestement par les colporteurs qui sont amenés à circuler et transportent avec eux quelques nouvelles, non sans retard sur les événements.
Ceux-ci concernent principalement l’arrivée des Français en 1830 et l’extension progressive de leur influence et emprise politique sur le pays. Cependant Monique Zerdoun insiste plutôt sur la lenteur de ce processus, du moins pendant les 40 premières années de la conquête et elle montre bien que les Juifs, pas plus que les Musulmans avec lesquels ils cohabitent, n’ont la moindre notion de ce que sont les nouveaux arrivants. On sait juste qu’ils ont chassé les Ottomans, qui dirigeaient le pays jusqu’en 1830, et on leur en sait gré, cependant les Français ne jouissent pas a priori d’une opinion favorable, et il se dit assez vite qu’en France , majoritairement, l’opinion est défavorable aux Juifs, ce qui ne laisse présager rien de bon. Cependant, dans les limites chronologiques du livre, non seulement ces présages sinistres ne sont pas justifiés mais c’est l’inverse qui se produit : le dernier événement évoqué est le fameux décret Crémieux qui en 1870 accorde la nationalité française à tous les Juifs, et on assiste à la joie extrême qui s’ensuit pour eux. Monique Zerdoun a choisi le « Happy end »et manifestement elle ne veut pas le gâcher—ce qui consisterait à reprendre les thèses de ceux qui, même parmi les Juifs, dénoncent le conséquences funestes de ce décret : beaucoup l’accusent d’être la cause principale d’une rupture violente entre Juifs et Musulmans d’Algérie. En fait on a pu voir auparavant et dès le début du livre la soumission dans laquelle les Juifs sont maintenus par une tradition séculaire qui comporte un ensemble d’humiliations ; elle vaut au jeune Raphaël une sévère bastonnade pour avoir frôlé involontairement un Musulman ; et pourtant le cadi d’Aïn-el-Kelma fait preuve de bénignité voire de bienveillance à l’égard des Juifs !
Cependant, dans les limites chronologiques du livre, non seulement ces présages sinistres ne sont pas justifiés mais c’est l’inverse qui se produit : le dernier événement évoqué est le fameux décret Crémieux qui en 1870 accorde la nationalité française à tous les Juifs, et on assiste à la joie extrême qui s’ensuit pour eux. Monique Zerdoun a choisi le « Happy end »et manifestement elle ne veut pas le gâcher—ce qui consisterait à reprendre les thèses de ceux qui, même parmi les Juifs, dénoncent le conséquences funestes de ce décret : beaucoup l’accusent d’être la cause principale d’une rupture violente entre Juifs et Musulmans d’Algérie. En fait on a pu voir auparavant et dès le début du livre la soumission dans laquelle les Juifs sont maintenus par une tradition séculaire qui comporte un ensemble d’humiliations ; elle vaut au jeune Raphaël une sévère bastonnade pour avoir frôlé involontairement un Musulman ; et pourtant le cadi d’Aïn-el-Kelma fait preuve de bénignité voire de bienveillance à l’égard des Juifs !
Le sujet traité par l’auteure est moins la description de cette situation (qui a déjà été faite mainte fois) que la question dont l’auteure est spécialiste en tant que chercheuse universitaire : la place du livre dans le monde juif médiéval et l’extrême importance qui lui est reconnue parmi des gens analphabètes et qu’on pourrait donc croire indifférent à cette question.
L’histoire de Raphaël ben Israël depuis son plus jeune âge jusqu’au moment où il est devenu grand-père témoigne de ce prestige du livre et du respect dont il est entouré : le plus grand désir de Raphaël est de devenir copiste et il y parvient. Il s’agit de savoir copier avec toute la compétence qui convient les rouleaux liturgiques sacrés, sachant que la moindre erreur ou modification qui leur serait apportée, si minime soit-elle, pourrait avoir les plus graves conséquences et que le sort de la communauté juive toute entière en dépend.
Raphaël, qui a longuement observé ce travail, est devenu un copiste éminent, surtout après son séjour à Livourne, c’est d’ailleurs le métier dont il vit, plutôt bien semble-t-il, et il le revendique comme un choix de vie essentiel. Lorsque dans l’Algérie devenue conforme aux lois de l’état-civil français, il lui faut se faire inscrire sous un nom propre (qui ne soit plus seulement un résumé de sa généalogie), il déclare fièrement celui de SOFER, qui veut dire copiste. Par ce seul mot il réinscrit la tradition dans la modernité, fidèle à lui-même et à sa communauté.
Denise Brahimi
« MERE DE LAIT ET DE MIEL »par Najat El Hachmi, éditions Verdier, 2023 pour la traduction française
On aurait tendance à ranger ce roman dans les œuvres, nombreuses, qui nous font connaître le Maghreb francophone, mais il n’est francophone qu’indirectement, par la traduction que proposent les éditions Verdier, qui ne sont nullement spécialisées dans les œuvres concernant le Maghreb, mais qui se sont chargées de faire traduire en français ce livre écrit en catalan (2018). L’auteure est à la fois marocaine puisque née à Nador dans la région du Rif oriental, et espagnole puisque elle a vécu en Catalogne dès l’âge de huit ans. Ce n’est pas elle la narratrice du roman, qui s’appelle Fatima mais elle pourrait être sa fille, qui dans le livre s’appelle Sara. De celle-ci on apprend à l’extrême fin du livre qu’elle a disparu, en tout cas qu’elle ne répond plus aux appels désespérés de sa mère Fatima mais comme le livre s’arrête sur ce silence, sans explication ni postface, le lecteur, comme Fatima elle-même, ignore la suite de l’histoire.
L’auteure est à la fois marocaine puisque née à Nador dans la région du Rif oriental, et espagnole puisque elle a vécu en Catalogne dès l’âge de huit ans. Ce n’est pas elle la narratrice du roman, qui s’appelle Fatima mais elle pourrait être sa fille, qui dans le livre s’appelle Sara. De celle-ci on apprend à l’extrême fin du livre qu’elle a disparu, en tout cas qu’elle ne répond plus aux appels désespérés de sa mère Fatima mais comme le livre s’arrête sur ce silence, sans explication ni postface, le lecteur, comme Fatima elle-même, ignore la suite de l’histoire.
Les événements que racontent le récit se situent dans la vingtaine d’années qui précèdent. C’est la vie de Fatima, en grande partie racontée par elle-même, lorsqu’elle revient au village où vivent sa mère et ses sœurs, qu’elle n’a pas revues depuis qu’elle est partie clandestinement en emmenant avec elle la petite Sara pour tout bagage, expression à prendre à la lettre car elle part en effet sans rien sinon une adresse envoyée des années auparavant par son mari. Lequel a décidé un jour d’aller travailler à l’étranger et n’a pas donné de nouvelles depuis lors. En fait Fatima n’a jamais été acceptée par sa belle-famille, et moins que jamais depuis qu’elle est manifestement abandonnée par son mari qui n’a jamais envoyé d’argent pour elle et sa fille. Fatima part donc pour essayer de retrouver son mari en fuite, dont elle apprendra au terme du voyage qu’il a refait sa vie, comme on dit, avec une autre femme et ne veut surtout pas revoir Fatima, dont il ne supposait sûrement pas qu’elle viendrait un jour à sa recherche.
Le voyage de la paysanne rifaine illettrée jusqu’en Catalogne (en fait elle ignore même où elle va) est un morceau de bravoure située au cœur du livre, et c’est un véritable objet de sidération, qui resitué en son temps reste exceptionnel. Fatima ne sait ni lire ni écrire, elle n’a aucun argent, et elle ne connaît absolument rien de la vie moderne, n’ayant vécu jusque là que dans le plus archaïque des villages, occupée uniquement à faire la cuisine et le pain d’abord dans sa propre famille puis dans celle de son mari. Elle a réussi à traverser toute l’Espagne en n’ayant rien d’autre que de quoi nourrir sa fille, ce qui veut dire à peu près l’empêcher de mourir de faim. Il paraît presque vain de parler de son courage, qui est inouï et aussi bien physique que moral. C’est une sorte d’intrépidité qui a disparu du monde civilisé, dès que l’habitude a été prise d’une minimum de confort au-delà de la survie. Fatima, elle, est capable de survivre comme l’ont fait par exemple les tribus indiennes dites sauvages d’Amérique au moment où leur immense pays a été conquis. Parler d’un exploit n’a pas grand sens, elle ne se pose pas la question de savoir si elle le peut ou non, elle le fait et c’est tout.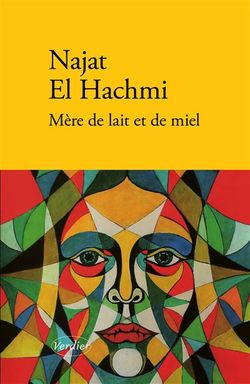 Ce voyage ahurissant est pourtant encadré par un avant et un après, que le livre raconte aussi avec beaucoup de talent d’écriture. Najat El Hachmi dit remarquablement tout ce qui concerne le corps des femmes dont on parle beaucoup de nos jours dans le roman occidental, mais toujours semble-t-il avec des difficultés pour le dire, en sorte qu’il se réduit le plus souvent à la sexualité. Il en est évidemment question dans « Mère de lait et de miel » mais en fait tout ce qui concerne les corps est d’abord déplacé, dans une étonnante première partie du roman, vers un sujet rarement traité qui est la relation physique fusionnelle entre la mère et le bébé fille jusqu’au moment du sevrage, devenu nécessaire lorsque la mère est enceinte d’un nouvel enfant. Il y a à ce moment du livre des pages d’une très grande force sur la douleur de ce sevrage imposé, aussi bien pour la mère que pour la fille. Et de cet arrachement encore plus que de la fusion qui l’a précédé découle une relation mère-fille qui sera physiquement et psychiquement déterminante pendant tout le reste de leur vie.
Ce voyage ahurissant est pourtant encadré par un avant et un après, que le livre raconte aussi avec beaucoup de talent d’écriture. Najat El Hachmi dit remarquablement tout ce qui concerne le corps des femmes dont on parle beaucoup de nos jours dans le roman occidental, mais toujours semble-t-il avec des difficultés pour le dire, en sorte qu’il se réduit le plus souvent à la sexualité. Il en est évidemment question dans « Mère de lait et de miel » mais en fait tout ce qui concerne les corps est d’abord déplacé, dans une étonnante première partie du roman, vers un sujet rarement traité qui est la relation physique fusionnelle entre la mère et le bébé fille jusqu’au moment du sevrage, devenu nécessaire lorsque la mère est enceinte d’un nouvel enfant. Il y a à ce moment du livre des pages d’une très grande force sur la douleur de ce sevrage imposé, aussi bien pour la mère que pour la fille. Et de cet arrachement encore plus que de la fusion qui l’a précédé découle une relation mère-fille qui sera physiquement et psychiquement déterminante pendant tout le reste de leur vie.
Du moins en sera-t-il ainsi pour Fatima, mais pour Sara une coupure se fait avec l’entrée dans l’âge adulte, sous des influences diverses, dont celle de l’école n’est pas des moindres. Sara entre dans la modernité pendant son adolescence, la romancière est très discrète sur ce qu’il en est de cette mutation considérable, (sans doute parce que chez Sara, il y a beaucoup elle-même), mais du point de vue de Fatima on comprend que c’est une tragédie considérable, car elle est absolument incapable, à tous égards, de vivre la rupture de ce lien qui est un véritable cordon ombilical. Corps et âme, elle ne le supporte pas.
Ses réactions sont alors désastreuses, et relèvent du pire patriarcat, comme on a coutume de dire, mais il est évident que c’est de matriarcat qu’il s’agit. La fille se voit imposer par la mère un mariage forcé , avec ses inévitables conséquences, la mère tente de se réfugier dans son propre monde maternel, qui est celui de ses sœurs, mais il lui faut arriver à comprendre que ce n’est pas de refuge qu’elle a besoin, et en effet peu à peu elle parvient à reconnaître qu’il y a eu des erreurs de sa part.
Fatima est une femme intelligente, mais il se pourrait que cette évolution soit trop tardive : Sara a certainement dû payer le prix fort pour atteindre son autonomie, pour Fatima c’était bien plus difficile encore car elle n’a eu aucune aide pour s’y préparer. Avec toute sa pudeur, le livre suggère la détresse et l’angoisse d’une telle solitude.
Denise Brahimi
« DRÔLES DE RÊVOLUTIONS » DE Youssouf Amine Elalamy et Yassine Hejjamy (Editions Alifbata mai 2023)
Nous poursuivons pour cette rentrée le commentaire de la riche production de l’éditeur marseillais Alifbata qui apporte cette année une pierre importante à l’édifice qu’il construit : faire connaître et aider à émerger le potentiel créatif important de la BD du monde arabe, celle ancrée depuis plus longtemps, au Liban et en Egypte, et celle moins développée mais au riche potentiel dans les pays du Maghreb. Drôle de révolution est coédité avec l’éditeur marocain Le Fennec, et constitue l’adaptation graphique du roman Drôle de printemps, de Youssouf Amine Elalamy. Le scénariste et le dessinateur se sont rencontrés lors d’une manifestation culturelle à Rabat. Le romancier, qui enseigne par ailleurs à l’université et travaille sur le lien entre le mot et l’image a proposé à Yassine Hejjamy de réaliser une bande dessinée à partir de son roman. Ce livre est constitué d’une multitude de microportaits d’acteurs des mouvements révolutionnaires des printemps arabes, à partir du spectacle de la Place Tahrir, mais non situé dans un pays particulier, tout comme la BD. Le dictateur (il en faut bien un pour déclencher une révolution!) est de l’aveu du dessinateur un mélange de Staline, de Saddam Hussein et de Khadafi (une cuisine relevée!).
Drôle de révolution est coédité avec l’éditeur marocain Le Fennec, et constitue l’adaptation graphique du roman Drôle de printemps, de Youssouf Amine Elalamy. Le scénariste et le dessinateur se sont rencontrés lors d’une manifestation culturelle à Rabat. Le romancier, qui enseigne par ailleurs à l’université et travaille sur le lien entre le mot et l’image a proposé à Yassine Hejjamy de réaliser une bande dessinée à partir de son roman. Ce livre est constitué d’une multitude de microportaits d’acteurs des mouvements révolutionnaires des printemps arabes, à partir du spectacle de la Place Tahrir, mais non situé dans un pays particulier, tout comme la BD. Le dictateur (il en faut bien un pour déclencher une révolution!) est de l’aveu du dessinateur un mélange de Staline, de Saddam Hussein et de Khadafi (une cuisine relevée!).
La Bd réduit à 18 le nombre de personnages qui étaient 100 dans le livre. Le mouvement politique qui provoque ces manifestations récurrentes n’apparaît qu’en fond d’écran, tant l’implication de chaque protagoniste est variée, et souvent éloignée d’une prise de conscience réellement politique. L’aboutissement révolutionnaire de cette mise en désordre (il y a en effet un débouché dans ce printemps-là, sans divulgacher la fin de l’album) n’est pas le fait d’une conception marxiste de la lutte des classes, mais d’une multitude d’attitudes individualistes. En ouverture de la BD, comme dans une pièce de théâtre , les 18 protagonistes sont présentés. Pour donner une idée de leur diversité, citons notamment la martyre, la coquine, la battante, la paradisiaque pour les femmes, et le dictateur , le préfet, le psy, le patron du chawarma, beau-frère du libraire qui reluque son employée pas farouche, et bien sûr, le dessinateur, qui a le rôle final… Beaucoup passent sur le divan du psy, ce qui est une prise de position quant au malaise individuel et social qui est l’un des déclencheurs de ces drôles de révolutions. Qu’auraient fait des psy, s’ils avaient existé en 1789 ou en 1917 ? Signalons du reste que les révolutions du titres s’orthographie rêvolutions, ce qui laisse aux psychanalystes un beau rôle à y jouer… Toutes ces trajectoires individuelles voire individualistes s’enchevêtrent de façon très habile. La 4ème de couverture parle de jeu de domino, ce qui est bien vu, chaque personnage passant de relais à un autre qui n’est associé au premier que par hasard ou par une succession de contacts intermédiaires. Les gags sont nombreux, rebondissent, cette BD est une hilarante caricature, qui pourtant comporte sa part de drame. La pancarte « DEGAGE » fréquente dans les scènes de manifestation peut permettre à une manifestante de couvrir ses arrières menacés par un manifestant attiré par le beau sexe. Les personnages féminins sont tout particulièrement vigoureux. Les motivations sexuelles sont abondantes. Mais pas seulement : le personnage du bègue se noie dans la multitude pour sortir de la solitude . Cet exemple comme d’autres est une fine observation de certaines trajectoires humaine.
Toutes ces trajectoires individuelles voire individualistes s’enchevêtrent de façon très habile. La 4ème de couverture parle de jeu de domino, ce qui est bien vu, chaque personnage passant de relais à un autre qui n’est associé au premier que par hasard ou par une succession de contacts intermédiaires. Les gags sont nombreux, rebondissent, cette BD est une hilarante caricature, qui pourtant comporte sa part de drame. La pancarte « DEGAGE » fréquente dans les scènes de manifestation peut permettre à une manifestante de couvrir ses arrières menacés par un manifestant attiré par le beau sexe. Les personnages féminins sont tout particulièrement vigoureux. Les motivations sexuelles sont abondantes. Mais pas seulement : le personnage du bègue se noie dans la multitude pour sortir de la solitude . Cet exemple comme d’autres est une fine observation de certaines trajectoires humaine.
Les mots prononcés par les personnages sont directement transposés du roman et donnent une solidité littéraire à l’album.
Le dessin est en noir sur fond blanc, dans un style qui évoque les fumetti humoristiques italiens, très efficace pour exprimer les ressentis, les scènes d’action.
Et c’est là que le dessinateur se donne avec poésie le beau rôle : il gomme les ruines de la ville dévastée par les scènes d’émeute réprimées par l’armée et la police, « ensuite je trace des verticales et je redresse les murs » et il nous livre la seule page en couleurs d’une ville vivante où l’on reconnaît tous les personnages dans des situations conformes à leurs vœux : une « happy end » pas si banale dans le monde de la littérature dessinée.
Quand un auteur de BD algérien se risquera t il à raconter le hirak ?
Michel Wilson
« UNE REVOLTE TUNISIENNE – LA LEGENDE DE CHBAYAH » de Seif Eddine Nechi et Aymen Mbarek, Editions Alifbata 2022, traduit par Marianne Babut
Ce très bel album peut donner une idée de ce que peut être un roman graphique en comparaison avec la production traditionnelle des albums de bande dessinée. Ampleur du récit d’abord, déployé par le scénariste Aymen Mbarek : à partir des émeutes du pain tunisiennes de janvier 1984, il couvre aussi bien la glorieuse bataille du Belvédère à Monte Cassino en janvier 1944 où le 4ème régiment de tirailleurs tunisiens conquit dans la douleur des positions allemandes, ce qui allait ouvrir la voie à l’avancée des alliés dans la campagne d’Italie, et renforcer le prestige de l’armée française auprès des américains. Au prix de 279 tués, 426 disparus et 800 blessés… Le récit rappelle aussi la révolte étudiante de 1972 qui résonne encore lors de ces affrontements de 1984, et sert probablement aussi de socle aux révoltes tunisiennes suivantes…
Ampleur du récit d’abord, déployé par le scénariste Aymen Mbarek : à partir des émeutes du pain tunisiennes de janvier 1984, il couvre aussi bien la glorieuse bataille du Belvédère à Monte Cassino en janvier 1944 où le 4ème régiment de tirailleurs tunisiens conquit dans la douleur des positions allemandes, ce qui allait ouvrir la voie à l’avancée des alliés dans la campagne d’Italie, et renforcer le prestige de l’armée française auprès des américains. Au prix de 279 tués, 426 disparus et 800 blessés… Le récit rappelle aussi la révolte étudiante de 1972 qui résonne encore lors de ces affrontements de 1984, et sert probablement aussi de socle aux révoltes tunisiennes suivantes…
L’histoire fait aussi place à ce qu’il reste de présence italienne en Tunisie avec l’intervention de l’ami coiffeur du grand-père avec qui les échanges se font en italien, et l’affiche du film La ragazza di Trieste, et la splendide silhouette d’Ornella Mutti qui hypnotise le petit Salem, au point qu’oubliant toute prudence, il se fait renverser par une voiture, et doit subir l’amputation de sa main droite. Sa révolte contre cette injustice trouve place dans la révolte populaire. La beauté de ce livre doit aussi beaucoup au très beau dessin de Seif Eddine Nechi, variant dessin à la plume colorisé de façon variable, selon les stades du récit, depuis le noir et blanc des émeutes de Douz, la colorisation assez sourde, mais très harmonieuse des épisodes de Tunis, les aquarelles grisées du rappel des combats du Belvédère, et des aquarelles en pleine page figurant une vipère dans un puits. Cette mystérieuse vipère rappelle la chasse qu’essaie de lui faire le petit Bachir à Douz en début de récit, mais semble devenir une représentation subliminale de l’affrontement avec le pouvoir…
La beauté de ce livre doit aussi beaucoup au très beau dessin de Seif Eddine Nechi, variant dessin à la plume colorisé de façon variable, selon les stades du récit, depuis le noir et blanc des émeutes de Douz, la colorisation assez sourde, mais très harmonieuse des épisodes de Tunis, les aquarelles grisées du rappel des combats du Belvédère, et des aquarelles en pleine page figurant une vipère dans un puits. Cette mystérieuse vipère rappelle la chasse qu’essaie de lui faire le petit Bachir à Douz en début de récit, mais semble devenir une représentation subliminale de l’affrontement avec le pouvoir…
Citons aussi de rôle du fantôme d’une victime de snipper lors des répressions de Douz, qui vient avec une forme d’humour étonnant épauler le petit Salem et son grand-père Ahmed, l’un des héros du Belvédère. Ces trois personnages improbables vont incarner pour les auteurs le mystérieux « Chbayah », nom donné au fantôme de dessin animé Casper dans sa version tunisienne. En 1984 ce mystérieux Chbayah avait tourné en ridicule les forces  de police en brouillant leurs communications et en diffusant de fausses informations sur les réseaux radios de la police. Dans ce livre, ce fantôme, qui est devenu un mythe populaire chez les Tunisiens, est incarné par un vieillard handicapé et son petit-fils, également handicapé. Accompagnés par le fantôme d’un jeune homme, même pas manifestant, lâchement abattu. L’appareil radio qui permet cela est un héritage d’un soldat américain qui l’a offert à Ahmed en remerciement pour sa bravoure au combat.
de police en brouillant leurs communications et en diffusant de fausses informations sur les réseaux radios de la police. Dans ce livre, ce fantôme, qui est devenu un mythe populaire chez les Tunisiens, est incarné par un vieillard handicapé et son petit-fils, également handicapé. Accompagnés par le fantôme d’un jeune homme, même pas manifestant, lâchement abattu. L’appareil radio qui permet cela est un héritage d’un soldat américain qui l’a offert à Ahmed en remerciement pour sa bravoure au combat.
Les petites victoires d’un petit peuple meurtri, confronté à la violence aveugle d’un pouvoir qui le méprise.
La violence est partout dans ce livre, notamment dans la représentation de la torture subie en 1972 par le père de Salem, lors du congrès de l’Union Générale des Etudiants Tunisiens, qui l’amène à trahir ses amis militants et devenir un soutien du régime au sein du Parti Socialiste Destourien. Cet artiste, joueur de houd est broyé et humilié, et les auteurs en font une narration très réaliste.
L’ouvrage, sur fond de cette violence, qui fait écho à celle de « Drôles de rêvolutions » fait aussi part à la poésie, l’humour, un peu d’onirisme…
Une belle œuvre, originale, définitivement.
Michel Wilson

« LES FILLES D’OLFA », documentaire-fiction de Kaouther Ben Hania, Tunisie 2023
La réalisatrice est tunisienne et c’est exclusivement d’une famille tunisienne qu’il est question dans « Les filles d’Olfa ». Pourtant cette œuvre filmique était très attendue ailleurs, notamment en France où l’accueil qui lui est fait peut d’ores et déjà être considéré comme un succès. Pour aller à l’essentiel, du moins dans la présentation qui en est faite par la critique, il y a à cela deux raisons principales , l’une des questions à se poser étant de savoir si elles sont liées ou non pour la réalisatrice. Le contenu du film est souvent résumé à un fait, dont on a beaucoup parlé en Tunisie , et qui est en effet un sujet brûlant, parce qu’il est lié à l’islam mais d’une façon à la fois secrète et spectaculaire et parce qu’il est à la fois présent dans tous les esprits mais manifestement mal compris : deux des filles d’Olfa, Rahma et Ghofrane ont quitté leur famille pour rejoindre Daesh et l’Etat islamique, alors qu’elles avaient à peine atteint l’âge adulte, abandonnant leur mère et leurs deux sœurs plus jeunes, Eya et Tayssir, encore adolescentes. Les deux fugitives ont disparu sans retour, ont vécu longtemps en prison et l’une d‘entre elles a une grande fille qu’on ne fait qu’apercevoir à distance à la fin du film. Il ne faut pas attendre de la documentariste Kaouthar Ben Hania des informations sur le mode de vie des femmes qui ont rejoint Daesh. D’ailleurs, elles ne sont encore revenues qu’en très petit nombre, et l’on peut aller jusqu’à dire que ces rares retours sont environnés d’une sorte d’effroi, d’une très grand malaise en tout cas qui explique l’attente causée par le film.
Le contenu du film est souvent résumé à un fait, dont on a beaucoup parlé en Tunisie , et qui est en effet un sujet brûlant, parce qu’il est lié à l’islam mais d’une façon à la fois secrète et spectaculaire et parce qu’il est à la fois présent dans tous les esprits mais manifestement mal compris : deux des filles d’Olfa, Rahma et Ghofrane ont quitté leur famille pour rejoindre Daesh et l’Etat islamique, alors qu’elles avaient à peine atteint l’âge adulte, abandonnant leur mère et leurs deux sœurs plus jeunes, Eya et Tayssir, encore adolescentes. Les deux fugitives ont disparu sans retour, ont vécu longtemps en prison et l’une d‘entre elles a une grande fille qu’on ne fait qu’apercevoir à distance à la fin du film. Il ne faut pas attendre de la documentariste Kaouthar Ben Hania des informations sur le mode de vie des femmes qui ont rejoint Daesh. D’ailleurs, elles ne sont encore revenues qu’en très petit nombre, et l’on peut aller jusqu’à dire que ces rares retours sont environnés d’une sorte d’effroi, d’une très grand malaise en tout cas qui explique l’attente causée par le film.
Mais la réalisatrice intrigue et surprend aussi par la forme qu’elle a donnée à son film, deuxième raison de l’intérêt que celui-ci a suscité. C’est un documentaire qui donne abondamment la parole à Olfa et ses deux filles restées avec elle à la maison. Elles sont des personnages réels, non des fictions, et elles doivent expliquer aux spectateurs ce qu’elles ont compris de la situation qu’elles ont réellement vécue. Mais faute de pouvoir faire parler les deux disparues, Rahma et Ghofrane, Kaouther Ben Hania les a remplacées par deux actrices qui jouent leurs rôles, du moins pour ce qui précède leur départ de la maison. Pour ce qui concerne Olfa elle-même, le traitement qui lui est réservé par le film est encore plus complexe : elle est présente en tant que personne réelle, on l’entend beaucoup et souvent, mais en même temps elle est aussi représentée dans le film par une actrice d’ailleurs célèbre, qui la remplace pour jouer certains épisodes de sa vie et qui, plus étonnamment encore la prend à partie et lui demande des comptes sur certains de ses comportements choquants voire révoltants.

La réalisatrice Kaouther Ben Hania de Les Filles D’Olfa, à Cannes, le 22 mai 2023.
Face à cette complexité, on ne sent pas la réalisatrice comme une instance extérieure à ce qu’elle décrit, elle n’est ni une analyste ni même une organisatrice des événements évoqués plus ou moins lointains, elle les laisse au contraire en partie inorganisés et si l’on peut dire mouvants. C’est aux spectateurs d’essayer de comprendre, mais de toute façon, le film n’est pas une enquête, malgré le fait que les deux plus jeunes filles, très intelligentes et capables de s’exprimer parfaitement bien, fournissent beaucoup d’éléments d’explication, à partir de ce qu’elles ont elles-mêmes vécu et compris.
Malgré le très grand intérêt du film suscité par les deux aspects qu’on vient d’évoquer, c’est peut-être sur cette sorte d’auto-explication interne et implicite qu’on aimerait réfléchir, d’autant que ce n’est pas si facile et qu’on en a parfois le souffle coupé—pour le dire vite, comment peuvent coexister tant de beauté et tant d’horreur, avec une sorte de naturel qui laisse le spectateur pantois.
La beauté, c’est évidemment celle des quatre adolescentes et jeunes filles, dont les corps sont constamment présents, souvent collectivement , comme peuvent l’être les jeunes femmes dansantes dans un tableau de Botticelli. Mais de celles-ci on sait bien qu’elles sont allégoriques et idéalisées, tandis que les jeunes Tunisiennes si remarquable que soit leur beauté sont aussi pleinement réelles, c’est une sorte d’incroyable cadeau qui surgit en pleine lumière de la noirceur du quotidien dans lequel elles sont immergées. Elles virevoltent, elles se posent, elles nous regardent et nous parlent, tout est vrai et pourtant presque incroyable, comment est-ce possible que d’aussi magnifiques personnes aient pu survivre dans ce bas-fond du monde ? De toute évidence, Kaouther Ben Hania les aime et les trouve belles et c’est cela aussi ou d’abord que pendant près de deux heures elle nous fait partager.
Et pourtant l’horreur est là, on y est d’emblée quand au début du film, remontant une génération, on assiste au mariage d’Olfa elle-même, le fameux viol conjugal si justement décrié et qui reste l’une des bases voire l’apanage du patriarcat. Oui, cela a bel et bien été et on ne saurait trop le dire ; mais le film incite cependant à deux remarques. La première est que ce viol ou plutôt ses tentatives sont représentées de façon si grotesque et carrément bouffonnes qu’on ne peut s’empêcher d’en rire : Olfa elle-même s’esclaffe tandis qu’elle en fait le récit et le mime. Faut-il comprendre que les temps ont passé et que là n’est plus le véritable danger ?
La deuxième remarque est qu’en tout cas dans cette famille, il n’y a pas un seul homme qui soit susceptible d’incarner le patriarcat, c’est de matriarcat qu’il s’agit, le pouvoir maternel tel qu’exercé par Olfa sur ses filles n’étant pas moins redoutable et violent que s’il l’était par un homme ; les filles l’ont très bien compris et disent à ce propos que leur mère se venge sur elles de ce qu’elle a subi— ce qu’elle ne dément pas. Faut-il admettre que l’amour ne s‘invente pas à partir de rien et qu’il ne peut pas exister là où il n’y a pas eu de modèle ? L’amour d’un père ou plutôt d’un substitut du père semble faire de timides apparitions mais il est noyé et submergé par la pulsion sexuelle masculine que rien ne contrôle.
Et pourtant, alors qu’elles sont objectivement des victimes ô combien, physiquement, affectivement et de toutes les manières, les quatre filles d’Olfa sont trop rayonnantes pour qu’on les cantonne dans ce rôle pitoyable, leur présence au monde est éclatante et signifie à chaque instant que leur force de vie l’emporte sur la mort. En a-t-il été de même pour les deux aînées ? On craint que non et il semble bien que leur mère et leurs sœurs le craignent aussi, leur cœur saigne lorsqu’elles pensent aux deux disparues. S‘il y a bien un amour qui s’exprime dans le film, c’est celui des sœurs entre elles, un lien qui est peut-être le seul sentiment positif et très fort auquel il nous est donné d’assister, que nous voyons exister sous nos yeux comme une vérité physique incontestable, en partie peut-être parce qu’elles ont traversé ensemble des moments si durs que seule leur sororité leur a permis de les surmonter.
On se dit alors que pour décider les deux aînées à partir, il a fallu le sentiment de n’avoir aucun autre choix, aucune porte même à peine entr’ouverte devant elles. N’ayant fait aucune étude d’aucune sorte, pas même un apprentissage manuel, n’ayant connu ni rien ni personne en dehors des murs de leur maison, leur mère n’envisageant pas pour elles un mariage contre lequel elle s’était elle-même révoltée, on comprend fort bien qu’elles n’aient pu envisager aucun avenir pour elles-mêmes, sinon en prenant le risque d’un inconnu effrayant et d’un arrachement au cocon familial, de la pire espèce à certains égards, mais cocon tout de même. Des prêches n’ont pas manqué de les y inciter, mais rien dans le film ne permet de dire que le moindre sentiment religieux voire mystique s’en soit mêlé et le voile lui-même n’a été pour elles rien d’autre qu’un objet attirant. Ceux qui croient subodorer dans Daesh on ne sait quelle sorte de mystérieuse séduction, un peu satanique peut- être pour ceux et celles qui ont peur de l’islam, ne trouveront pas dans le film de Kaouther Ben Hania de quoi nourrir leurs fantasmes. Au bout du compte Rahma et Ghofrane auront certainement été beaucoup plus victimes que leurs sœurs cadettes, aussi victimes quoique d’une tout autre manière que leur mère en son temps l’a été du patriarcat encore régnant tant bien que mal à sa génération. Celui-ci a pris une autre forme en s’associant à un éventuel Etat islamique, avatar plus récent de la volonté de pouvoir qui renouvelle depuis des siècles ses prétextes à l’oppression.
Denise Brahimi
« LES MEUTES » de Kamel Lazrak, film marocain, 2022
Ce film marocain obtient en France beaucoup de succès. Il appartient à la catégorie « film noir » ou « film policier », ce qui est loin d’être le courant dominant dans le cinéma marocain récent dont les sujets sont le plus souvent des problèmes sociétaux (qu’on pense aux films de Nabil Ayouch ou de Maryam Touzani). Dans « Les Meutes » il est évidemment question de la misère et de la difficile survie des classes urbaines les plus pauvres (ici celles de Casablanca) mais le film a manifestement envie de montrer aussi autre chose, et d’aborder un autre genre de cinéma où l’action multiforme et débridée l’emporte sur l’analyse et la description. L’originalité des « Meutes » n’apparaît pas moins si l’on tente une comparaison avec le genre policier français qui semble avoir atteint des sommets à une époque récente mais à l’opposé de la manière choisie par Kamel Lazrak : que l’on pense par exemple au cinéma de Jean-Pierre Melville, dont la tendance a été d’aller toujours davantage dans le sens de la rigueur et de la minutie, pour des films très épurés—ce qu’on ne saurait dire des « Meutes ».
L’originalité des « Meutes » n’apparaît pas moins si l’on tente une comparaison avec le genre policier français qui semble avoir atteint des sommets à une époque récente mais à l’opposé de la manière choisie par Kamel Lazrak : que l’on pense par exemple au cinéma de Jean-Pierre Melville, dont la tendance a été d’aller toujours davantage dans le sens de la rigueur et de la minutie, pour des films très épurés—ce qu’on ne saurait dire des « Meutes ».
Dans le film de Kamel Lazrak les personnages ne maîtrisent rien, ils sont au contraire ballottés par une série improbable d’événements qui leur tombent dessus par hasard, que ce soit par mauvaise chance ou maladresse de leur part : leur histoire, c’est vraiment n’importe quoi !
Un père, Hassan, entraîne son fils Issam, faute d’un coéquipier plus averti et sans doute aussi pour le plaisir d’être avec lui, dans une petite affaire un peu louche, certes hasardeuse mais qui ne devrait pas être trop grave si les choses ne se mettaient à déraper. Rien n’a été bien calculé, mais on se dit que c’est l’occasion pour le réalisateur de transposer le genre picaresque au cinéma, pour une série d’aventures dont on verra bien où elles mènent, pour peu qu’on les laisse flotter.
Cependant, aventures ou plutôt mésaventures, on en vient à se dire que malgré leur composante vaguement burlesque, elles évoquent les enchaînements catastrophiques qui sont propres au genre tragique, et l’on sait en effet que dans un tout autre registre, celui-ci n’est pas sans lien avec le genre policier. Comment le réalisateur va-t-il gérer ces données multiples et trouver dans ce mélange le ton propre à son film ?
On n’a certes pas envie d’employer à son propos des grands mots tels que fatalité ou destin car on est loin de cette sorte de sublime, embourbé plutôt dans des bas-fonds misérables et crasseux, peuplés d’individus à mine patibulaire, petits voyous, escrocs ou ivrognes invétérés. Vient pourtant le moment où on est gagné par l’angoisse qui émane de deux personnages principaux, le père et le fils dont les déboires deviennent consternants et suscitent la compassion. Tant il est vrai que dans le monde où ils se meuvent ils font figure d’innocents, manipulés par la pègre qui les exploite et ne rémunère qu’à peine leurs menus services. Ce ne sont évidemment pas des meurtriers et seule la mauvaise chance leur en donne l’apparence. Leurs deux portraits sont d’ailleurs intéressants, et leurs différences montre celle de leurs générations. Le père, naïf et marginal, est une sorte de franc-tireur incontrôlé, le fils serait prêt à collaborer avec la police, par respect de la légalité, il a d’ailleurs, malgré ses origines très modestes, l’allure d’un éventuel jeune cadre mais il sent qu’il ne peut rattraper les erreurs de son père qu’en entrant plus avant dans l’illégalité, d’une manière qu’il voudrait efficace et organisée pour compenser les caprices du vieux. Celui-ci en revanche reste très archaïque, il ne respecte pas les lois qu’il ignore mais les usages anciens, par exemple celui de laver les morts, si dangereux que ce soit lorsqu’il s’agit un clandestin qu’il faut absolument cacher.
Ce ne sont évidemment pas des meurtriers et seule la mauvaise chance leur en donne l’apparence. Leurs deux portraits sont d’ailleurs intéressants, et leurs différences montre celle de leurs générations. Le père, naïf et marginal, est une sorte de franc-tireur incontrôlé, le fils serait prêt à collaborer avec la police, par respect de la légalité, il a d’ailleurs, malgré ses origines très modestes, l’allure d’un éventuel jeune cadre mais il sent qu’il ne peut rattraper les erreurs de son père qu’en entrant plus avant dans l’illégalité, d’une manière qu’il voudrait efficace et organisée pour compenser les caprices du vieux. Celui-ci en revanche reste très archaïque, il ne respecte pas les lois qu’il ignore mais les usages anciens, par exemple celui de laver les morts, si dangereux que ce soit lorsqu’il s’agit un clandestin qu’il faut absolument cacher.
Cependant et malgré ce qui les oppose, ils sont liés l’un à l’autre d’un amour absolu qui les rend très touchants, d’autant que celui-ci est fondé sur un troisième terme qui est sans doute le plus important, une vieille femme qui est la mère de l’un et la grand-mère de l’autre. Ne serait-ce qu’à cause d’elle, ils incarnent la fraîcheur et la douceur dans un monde de brutes.
On se doute bien qu’en dépit de leurs efforts inouïs, ils auront beaucoup de mal à se sortir du mauvais pas dans lequel ils sont. Mais le réalisateur se soucie assez peu de donner un aboutissement à son récit. La dérive à laquelle ils sont voués, Hassan par vocation, Issam faute de trouver où s’amarrer, en fait une sorte de couple qu’on pourrait dire poétique, évoluant non sans peur à travers les menaces et les crapule ries, protégés dirait-on par leur innocence qui est un certain déni du tragique. On a vu celui-ci poindre ça et là, mais le film ne s’en termine pas moins par une pirouette moqueuse. Et si l’on peut en parler comme d’un film noir, c’est en prenant cette expression à la lettre : le film ne se passe à peu près que la nuit, toutes les déambulations des personnages y sont plongées : oui on est dans le noir et on ne peut guère faire autre chose que d’y rester, mais ce noir n’est pas sinistre, il est la couleur naturelle du monde d’Hassan et d’Issam, celle des bas-fonds de Casablanca où pétille dans l’ombre une drôle de survie.
Denise Brahimi
Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.
 – Utiles
– Utiles
de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun
Cliquez ici pour voir le film et le mot de passe utilesjoussour

–Entre nos mains
de Leila Saadna
Cliquez ici pour voir le film, puis mot de passe utilesjoussour
Et sa bande-annonce, cliquez ici

Notes de présentation :
« RELIRE FERAOUN », Revue Awal n° 47-48 sous la direction de Tassadit Yacine et Hervé Sanson, éditions Koukou, 2023

(Photo by STAFF / AFP)
La revue Awal (études berbères) se propose de revenir, soixante ans après l’indépendance de l’Algérie (2022) à l’écrivain kabyle Mouloud Feraoun né à Tizi Hibel en 1913 et assassiné la veille des accords d’Evian du 19 mars 1962.
Le propos général de cet ensemble d’articles et de documents est de donner à lire une défense de Mouloud Feraoun contre différents types d’accusation, sévères et parfois violents.
Cette entreprise s’appuie d’abord, en guise d’ouverture, sur la parole de trois écrivains contemporains, Tahar Bekri, Samira Negrouche et Habib Tengour. Puis elle montre, grâce à un ensemble d’articles, qu’il n’a cessé, d’être un témoin de la réalité, dans laquelle il a été continûment immergé pendant la terrible période de la guerre d’Algérie.
A quoi s’ajoute un ensemble d’informations sur son travail d’ethnologue (« Jours de Kabylie ») et de pédagogue (« L’ami fidèle »).
Les documents, de première main, font apparaître un écrivain et un intellectuel, qu’on ne peut apprécier si l’on s’en tient à une vision étroite et réductrice de ce qu’aurait dû être tout militant de la cause indépendantiste.
Denise Brahimi
« LE THEATRE DES GENRES DANS L’OEUVRE DE MOHAMMED DIB », PUR (Presses universitaires de Rennes), Colloque de Cerisy, 2021
 Le centenaire de l’écrivain algérien Mohammed Dib, qui devait être commémoré de plusieurs manières en l’année 2020, a été repoussé pour cause de confinement jusqu’en 2021. Il a donné lieu notamment à un Colloque de Cerisy, manifestation culturelle réputée qui réunit les plus éminents spécialistes d’un auteur ou d’une question. Pour un auteur aussi étudié que Mohammed Dib (à juste titre, évidemment), le problème est de renouveler les perspectives sur son œuvre, ce qui fut fait dans ce colloque en y montrant un « théâtre des genres » comme l’ont dit les trois universitaires qui en ont assuré la direction, Charles Bonn, Mounira Chatti et Naget Khadda.
Le centenaire de l’écrivain algérien Mohammed Dib, qui devait être commémoré de plusieurs manières en l’année 2020, a été repoussé pour cause de confinement jusqu’en 2021. Il a donné lieu notamment à un Colloque de Cerisy, manifestation culturelle réputée qui réunit les plus éminents spécialistes d’un auteur ou d’une question. Pour un auteur aussi étudié que Mohammed Dib (à juste titre, évidemment), le problème est de renouveler les perspectives sur son œuvre, ce qui fut fait dans ce colloque en y montrant un « théâtre des genres » comme l’ont dit les trois universitaires qui en ont assuré la direction, Charles Bonn, Mounira Chatti et Naget Khadda.
La volonté affirmée par ce titre est de montrer dans les œuvres de l’écrivain une certaine mise en scène des situations, des personnages et des langages, déplaçant par là l’intérêt plus souvent porté à la description thématique dans la majorité des lectures critiques depuis un bon demi-siècle. Une bonne partie des livres de Dib ont été écrits pendant les années 50, ce qui explique qu’on y ait cherché principalement leur rapport à la décolonisation.
Dans la période tardive de sa production, l’écrivain ne se borne pas au domaine algérien et aux préoccupations qu’il induit (non négligeables certes, puisqu’elles incluent le terrorisme islamique !). La théâtralisation que les articles mettent en avant sous ses formes diverses, est parfois directe, dans des œuvres écrites pour le théâtre.
Mais on la trouve aussi bien dans les romans ou dans l’écriture poétique, elle entraîne d’ailleurs des correspondances entre poème et prose, de même que des échanges entre le domaine visuel et le domaine sonore.
Le point de départ de Mohammed Dib est souvent dans l’oralité, omniprésente en Algérie, où la littérature populaire est d’abord orale, à travers les mythes et les contes. Mais c’est toujours pour en proposer une mise en scène : tel pourrait bien être le mot-clef de son travail d’écriture.
Denise Brahimi
« UN JOUR J’AI MENTI » par Samira Sedira édition La Manufacture de livres 2023
 Il n’est aucunement question du Maghreb dans ce livre, sinon par la mention d’un faux grand-père combattant de l’indépendance algérienne que l’héroïne s’invente de toute pièce, sa famille de riches bourgeois bordelais n’ayant jamais eu le moindre rapport avec l’Algérie. On se contentera donc de l’évoquer rapidement pour les lecteurs de Coup de soleil, et de rappeler que l’auteure, d’origine algérienne vit en France depuis sa naissance ou presque, il y aura bientôt une soixantaine d’années. Elle est d’autant plus remarquable que sans aucune ressemblance par les thèmes qu’elle choisit avec la majorité des écrivaines dites franco-maghrébines. L’histoire qu’elle entreprend de raconter, surprenante et énigmatique, ne peut manquer de retenir l’attention mais pourtant et plus encore que son sujet, c’est sans aucun doute la qualité et l’originalité de son écriture qui en font une écrivaine de premier plan, il suffit de lire le moindre passage du livre pour en être convaincu.
Il n’est aucunement question du Maghreb dans ce livre, sinon par la mention d’un faux grand-père combattant de l’indépendance algérienne que l’héroïne s’invente de toute pièce, sa famille de riches bourgeois bordelais n’ayant jamais eu le moindre rapport avec l’Algérie. On se contentera donc de l’évoquer rapidement pour les lecteurs de Coup de soleil, et de rappeler que l’auteure, d’origine algérienne vit en France depuis sa naissance ou presque, il y aura bientôt une soixantaine d’années. Elle est d’autant plus remarquable que sans aucune ressemblance par les thèmes qu’elle choisit avec la majorité des écrivaines dites franco-maghrébines. L’histoire qu’elle entreprend de raconter, surprenante et énigmatique, ne peut manquer de retenir l’attention mais pourtant et plus encore que son sujet, c’est sans aucun doute la qualité et l’originalité de son écriture qui en font une écrivaine de premier plan, il suffit de lire le moindre passage du livre pour en être convaincu.
Or si elle a déjà écrit plusieurs romans, Samira Sédira a plutôt été formée par et pour le théâtre en tant que comédienne, et l’on peut dire par ailleurs que ses occupations ont été variées, puisqu’elle n’a pas hésité à devenir femme de ménage quand le besoin s’en est fait sentir—on peut d’ailleurs penser qu’elle a utilisé cet excellent poste d’observation au profit de ses romans.
« Un jour j’ai menti » est le journal d’une mythomane, une certaine Nikki, qui s’est inventé de toute pièce une identité et au sens le plus complet du terme une vie sans rapport avec ses origines, reniées de longue date au profit de celles que très volontairement, très continûment elle a choisi de s’inventer. Jusqu’au jour où se sachant démasquée par les deux cinéastes venues la filmer, elle a préféré disparaître et s’est suicidée.
Le roman de Samira Sedira est ambigu à de nombreux égards. Nikki étant devenue, de par sa nouvelle personnalité, une femme débordante d’amour et de générosité, qui oserait s’en plaindre et de quel droit ? Et pourtant elle est aussi une femme qui a été empêchée de vivre par la connaissance de son imposture et qui en est morte. Un certain sentiment du malheur et de la tragédie pèse sur l’ensemble du livre, au point que même les deux cinéastes ont été finalement saisies par un malaise et le soupçon de leur propre culpabilité. D’ailleurs tout le livre est scandé par l’annonce récurrente de la catastrophe inévitable. L’art de Samira Sédira est tel que tout le monde, finalement, se sent plus ou moins gagné par l’impression étrange de jouer indûment avec sa propre personnalité.
Denise Brahimi
« L’BNAT DE KHENIFRA » Film documentaire de Karim Hapette
Adrien Lioure est producteur au sein de la jeune société de production lyonnaise La petite ellipse, installée au Pôle Pixel.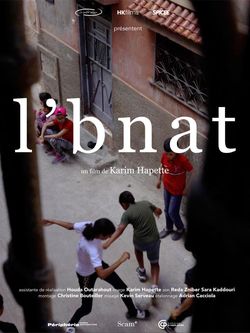 Il a souhaité présenter à Coup de Soleil ce premier documentaire de création intitulé L’bnat réalisé par le Marocain Karim Hapette. Ce film, qui a eu sa première au sein de la compétition internationale du FIDADOC à Agadir, suit le parcours du Chabab Atlas Khenifra (C.A.K FF), une jeune équipe de football féminin, tout au long d’un tournoi mixte hors du commun se déroulant pendant le mois de ramadan dans la petite ville de Khénifra, dans le Moyen Atlas marocain. Dépassant le cadre du ballon rond, L’bnat dépeint la jeunesse marocaine sous le prisme des plus belles facettes du sport avec humour et tendresse.
Il a souhaité présenter à Coup de Soleil ce premier documentaire de création intitulé L’bnat réalisé par le Marocain Karim Hapette. Ce film, qui a eu sa première au sein de la compétition internationale du FIDADOC à Agadir, suit le parcours du Chabab Atlas Khenifra (C.A.K FF), une jeune équipe de football féminin, tout au long d’un tournoi mixte hors du commun se déroulant pendant le mois de ramadan dans la petite ville de Khénifra, dans le Moyen Atlas marocain. Dépassant le cadre du ballon rond, L’bnat dépeint la jeunesse marocaine sous le prisme des plus belles facettes du sport avec humour et tendresse.
Nous ne pouvons qu’être ravis par le courage et la compétence de cette équipe féminine, qui ne semble nullement impressionnée de devoir entrer en compétition avec celle des garçons.

- 6 et 7 septembre puis 11 septembre, Mohammad Sabaaneh, caricaturiste et auteur palestinien à Lyon puis à Vénissieux. Exposition de ses caricatures, dédicace de son livre, conférence.
- 10 septembre à la ferme L’Oasis de Gleizé, rencontres « Exil et permaculture » avec notamment échanges sur nos actions au Maroc en agroécologie avec des formateurs guinéens et des jeunes migrants en formation.
N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.