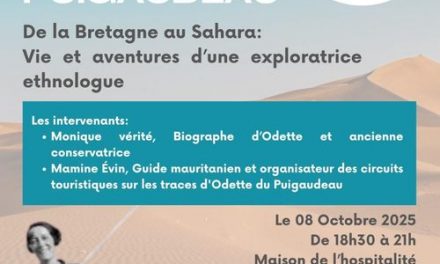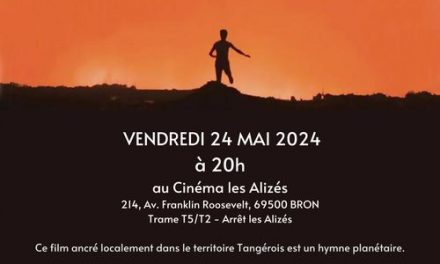Editorial
Cette Lettre commence en attirant votre attention sur deux faits remarquables sinon exceptionnels. Le premier consiste en un recueil de poésie, alors que nous n’avons que trop rarement l’occasion de vous en signaler. Celui-ci est l’œuvre du poète franco-tunisien Tahar Bekri et il s’intitule « Mon pays ». Le second est la parution d’une somme historique considérable en trois volumes dont un seul est présenté dans la Lettre d’aujourd’hui (mais les autres suivront) ; il s’intitule « Harems et sultans », son auteure Jocelyne Dakhlia le centre sur le Maroc, depuis le Haut Moyen-âge jusqu’au 20e siècle. Elle met une masse considérable d’informations au service d’un combat contre les idées reçues sur le rôle et la place des femmes, résolument en dehors des habituels clichés.
Viennent ensuite trois romans, deux films et deux notes d’information.
Un roman très attendu est celui par lequel Leïla Slimani conclut sa trilogie marocaine : « J’emporterai le feu ». L’autre, de Najat El Hachmi : « Lundi, ils nous aimeront » a l’originalité d’être traduit du catalan, ce qui n’est pas seulement une question de langue. Enfin, le roman « L’odyssée du soldat captif » de Michel Sottet est le récit fictif d’un appelé fait prisonnier pendant la guerre d’Algérie.
Les deux films évoqués dans cette Lettre sont de grande qualité et de grand intérêt, « L’effacement » de Karim Moussaoui est tiré assez librement du roman éponyme de Samir Toumi, l’autre, de Saïd Amich, s’intitule « La mer au loin »et témoigne de beaucoup d’originalité dans sa manière de traiter le thème de l’immigration (ici il s’agit de Marocains à Marseille).
Très original aussi le film franco-belge « Reine Mère » de Manele Labidi qui veut traiter de Franco-Maghrébins hors de toute convention, au risque de les rendre méconnaissables. De la Marocaine Fatna El Bouih qui fait l’objet d’une autre note, et de son livre « Toutes peines confondues » il sera question prochainement pour les formes d’action qu’elle tire de la détention qu’elle a naguère subie.
Et bien sûr pour finir le plaisir d’une BD présentée par Michel Wilson : « Marcel : Cerdan, le coeur et les gants », la première BD consacrée à l’histoire du boxeur le plus aimé des Français, donc largement autant de coeur que de gants…
Affaire Boualem Sansal : quelle plus belle forme du pouvoir que la grâce présidentielle ? Croisons les doigts…
Denise Brahimi

Peut-être souhaitez-vous faire un don à notre association, pour contribuer à notre fonctionnement? Et notamment au coût de réalisation de cette Lettre?
Vous en avez la possibilité en cliquant ICI. Merci d’avance!
Et si vous souhaitez nous faire le plaisir de nous rejoindre en adhérant, c’est LA!

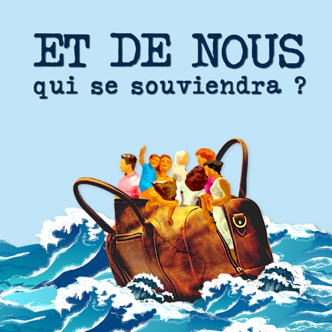
« Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).
Hommage à une communauté en voie de disparition, il a pour objectif d’aider les pieds-noirs à transmettre. Il s’adresse à leurs descendants, aux enseignants qui souhaitent parler de la guerre d’Algérie, et plus largement à tous ceux qui s’intéressent aux exils et à la résilience. Il interroge l’exil comme acte fondateur ainsi que les questions d’identité, d’invisibilité et d’intégration. Il pose également la question de la transmission et de la mémoire des pieds-noirs.
Le projet a démarré en janvier 2022, année de commémoration du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.
Pour écouter les épisodes déjà parus : https://podcast.ausha.co/et-de-nous-qui-se-souviendra
« LUI DEVANT », un podcast audio-graphique en cinq épisodes d’Abderazag Azzouz, auteur/réalisateur.
 « Lui devant », raconte l’histoire puissante et sensible de deux frères, Amine et Hakim, qui se battent pour l’indépendance de l’Algérie dans les années 1960.
« Lui devant », raconte l’histoire puissante et sensible de deux frères, Amine et Hakim, qui se battent pour l’indépendance de l’Algérie dans les années 1960.
Cette histoire est centrée sur leur parcours difficile et leur lien fraternel indéfectible. Nous les suivons alors qu’ils s’évadent d’un camp de prisonniers proche d’une carrière de marbre exceptionnelle située à Fil Fila, où ils étaient forcés de travailler. Cette carrière de marbre sera déterminante pour leur vie. Amine y vivra ses premières émotions, explorant sa créativité et la naissance d’une passion pour la sculpture. Hakim, quant à lui, y confrontera sa force physique lors de l’extraction de la roche, découvrant sa propre endurance et son courage.
Sortie officielle, le 19 mars 2025
Cliquer ICI pour visionner la bande annonce : https://linktr.ee/podcastime69

« MON PAYS, LA BRAISE ET LA BRÛLURE » par Tahar Bekri, poésie, Asmodée Edern, 2025
Tahar Bekri, poète d’origine tunisienne, est très lu et très édité (pas moins de huit maisons d’édition ont contribué à le faire connaître), ce qui est assez rare dans le genre littéraire qui est le sien. Né à Gabès, il vit en France depuis des décennies, pour des raisons politiques qui l’ont contraint à l’exil (« Dans la nuit sombre/ Ils vinrent te prendre »). Tel est l’arrière-plan de ce petit récit-poème qui d’emblée met la Tunisie en exergue, dès le titre qui est une revendication affectueuse : « Mon pays » accompagnée d’une belle formule poétique, riche de son assonance : « la braise et la brûlure ». Braise où persiste le feu d’un amour qui ne s’est jamais éteint, mais non sans la douleur que la brûlure inflige. Quel amour et quelle douleur, c’est ce disent les 55 courtes strophes en lesquelles se déroulent le poème et la narration.

Ph.-Anne-Savate
Les souvenirs personnels sont présents dans un ordre discrètement chronologique —on apprend par exemple qu’il a fallu treize ans pour que le poète revienne dans son pays. Longue durée qui lui a permis d’entendre les échos d’une mémoire parfois ancienne puisqu’elle le ramène aux bancs de sa première école. Mais il se mêle à cette trame tous les acquis d’une culture diverse, qui comporte aussi bien Virgile et ses « Géorgiques » que Malek Haddad et Antonio Machado—et tant d’autres encore :
« Tu lisais Neruda Lorca Hikmet et Fanon
Darwich Nejm Nawab et Sayyab…”
Car Tahar Bekri est un poète multiple et c’est justement ce qui dilate ce livre apparemment petit mais riche du contraste entre le pays de l’origine toujours présent et une pluralité de rencontres en des lieux variés. Sa Tunisie est fraternelle, parfois intime, mais la fraternité qu’il évoque n’est pas réduite à des limites géographiques restreintes, elle est humaniste en ce sens qu’elle va toujours au-delà, dans l’espace et dans le temps. « Mon pays » pour parler comme lui, décline une histoire évoquée par bien des noms chargés de sens tels que Sousse, les îles Kerkennah, Hammamet et Kairouan. Et ce au fil des siècles, voire de millénaires. Peu de pays peuvent revendiquer une origine qui remonte aussi loin dans le temps : c’est bien sûr de Carthage qu’il s’agit, désignée par le poète sous son nom le plus authentique parce que le plus ancien, Qart Hadasht, la cité nouvelle ; on entend le passé qui bruisse à travers les strophes poétiques de Tahar Bekri.
Hors de son pays qu’il lui a fallu quitter, le poète en a connu beaucoup d’autres, dont il parle avec une sorte de familiarité affectueuse car souvent à travers leurs poètes et leurs écrivains : on dirait qu’il ne distingue pas ceux-ci des lieux où ils ont vécu, comme s’ils en étaient l’incarnation. Ce qui est très frappant dans les strophes poétiques de « Mon pays » est que rien de ce dont elles parlent ne semble étranger à leur auteur. Cette poésie-là doit sa qualité à une sorte de mélange ou de fusion entre le moi ou le mien et ce qui chez d’autres serait l’étrange ou l’étranger. Ici l’intime n’est pas un enfermement par des frontières, qui le sépareraient d’une altérité. Prenons-en pour exemple la manière dont il nous parle de Tabarque, lieu et île situées au nord-ouest de la Tunisie : il nous y fait découvrir de figures pour lui fraternelles et venues du reste du monde :
« A Tabarka tu étais comme un chêne-liège
L’écorce légère
Tu découvrais Miles Davis Keit Jarret Randy
Weston
Atahualpa Yupanki Manitas de la Plata Paco
Ibanez… » Sans que s’évapore pour autant l’odeur propre à Tabarque du liège brûlé.
Sans que s’évapore pour autant l’odeur propre à Tabarque du liège brûlé.
Ou bien pour prendre encore un autre exemple de cette fusion qui ici apparaît comme l’essence même de sa poésie : c’est en un certain automne où grâce au poème de Prévert Bizerte sous une pluie fine se confond avec Brest sur laquelle il pleuvait tant : « Il pleuvait sur Bizerte, que Prévert me pardonne ».
Il vient alors à l’esprit que le poète et son pays sont à l’image l’un de l’autre, également ouverts au monde sans se perdre dans sa vastitude ; et refusant également d’être réduits tant au sens physique et géographique qu’au sens figuré par les préjugés et les idéologies. Et si le pays a provisoirement du mal à s’en défendre, le poète le fera pour lui ; tel pourrait être le sens de la revendication affectueuse d’appartenance dont le titre fait état : c’est mon pays et je ne laisserai personne le défigurer.
Un autre grand mérite des strophes poétiques de Tahar Bekri est qu’elles sont accessibles à tous, sans rien perdre pour autant de leur exigence littéraire. Quiconque veut adhérer à la Tunisie dont il parle n’a aucune raison de se sentir exclu.
Denise Brahimi
« HAREMS ET SULTANS, genre et despotisme au Maroc et ailleurs, XIV-XXè siècle » par Jocelyne Dakhlia, éditions Anacharsis, 2024
Ce gros volume de plus de 700 pages n’est que le premier d’une série de trois dont voici les titres :
Tome 1 : « Le Temps des gynécées », Tome 2 : « Le temps des sérails, Tome 3 : « Le temps des harems ». Il ne sera question dans cette Lettre que du premier volume, « Le Temps des gynécées », mais les deux prochaines Lettres parleront des suivants, ce qui est indispensable puisque l’ensemble est un parcours chronologique, comme indiqué dans le titre. Ce premier volume indique clairement la position de l’auteure sur la question du harem en général, un terme dont elle déplore qu’il soit le plus employé lorsqu’il est question des femmes dans le monde dit oriental en général. Tout le but de sa démarche est de montrer qu’au Maroc, qui est le lieu principal de sa recherche (mais on voit d’emblée qu’elle n’hésitera pas à élargir celui-ci au besoin), le mot « harem » est un terme anachronique pour parler du Moyen-Age et même des Temps modernes, jusqu’au 16è siècle inclusivement. On verra dans les deux volumes suivants ce qu’il en est des mots « sérails » et « harems » mais pour ce premier volume, qui va chronologiquement jusqu’en 1550, l’auteure s’en tient au mot « gynécée » qui trouve son origine dans la Grèce antique, et n’est donc pas spécialement lié au Maroc : on sait que dans la Grèce et dans la Rome antique, le mot Gynécée désigne l’appartement des femmes ou partie de la maison qui était réservée à leur usage exclusif. Ce qui ne signifie d’aucune manière qu’elles ne devaient pas en sortir ! C’est contre cette idée d’enfermement que le livre multiplie des exemples très nombreux, donnant l’impression qu’il use d’une documentation exhaustive, et incontestable.
Ce premier volume indique clairement la position de l’auteure sur la question du harem en général, un terme dont elle déplore qu’il soit le plus employé lorsqu’il est question des femmes dans le monde dit oriental en général. Tout le but de sa démarche est de montrer qu’au Maroc, qui est le lieu principal de sa recherche (mais on voit d’emblée qu’elle n’hésitera pas à élargir celui-ci au besoin), le mot « harem » est un terme anachronique pour parler du Moyen-Age et même des Temps modernes, jusqu’au 16è siècle inclusivement. On verra dans les deux volumes suivants ce qu’il en est des mots « sérails » et « harems » mais pour ce premier volume, qui va chronologiquement jusqu’en 1550, l’auteure s’en tient au mot « gynécée » qui trouve son origine dans la Grèce antique, et n’est donc pas spécialement lié au Maroc : on sait que dans la Grèce et dans la Rome antique, le mot Gynécée désigne l’appartement des femmes ou partie de la maison qui était réservée à leur usage exclusif. Ce qui ne signifie d’aucune manière qu’elles ne devaient pas en sortir ! C’est contre cette idée d’enfermement que le livre multiplie des exemples très nombreux, donnant l’impression qu’il use d’une documentation exhaustive, et incontestable.
L’originalité du projet dans son ensemble est d’avoir associé deux termes ou deux ensembles de termes qui ne le sont pas forcément. En effet « sultans » et « despotisme » renvoient à la nature du pouvoir tandis que « genre » et « harems » signifie que l’auteure entend traiter spécialement des femmes, au sens féminin du mot s’opposant au masculin. Et c’est ainsi qu’à l’intérieur des trois chapitres du livre, dont chacun comporte lui-même trois sous-chapitres, se trouvent associées voire mêlées la nature du pouvoir et celle du mode de vie féminin. Ce qui veut dire que dans ce seul volume l’auteure répartit les faits dont elle dispose sous 9 titres qui sont à la fois thématiques et situés dans une chronologie. Le premier des 3 chapitres concerne ce qu’on pourrait appeler le haut Moyen-âge sans autre précision, tandis que le deuxième va de 1300 à 1450 et le troisième de 1415 à 1550. Pour parler en termes sommaires et simplificateurs on est amené comme l’auteure à utiliser des formules dont la forme est négative (alors que le fond ne l’est pas !). On peut dire que, de tous les faits rapportés dans ce premier volume, jamais ne se dégage l’idée d’une exclusion des femmes ni de leur renfermement dans des espaces clos. Cette façon de parler peut paraître surprenante du fait qu’elle recourt à la négation mais elle s’explique clairement par la nécessité où l’auteure se trouve de démentir à peu près constamment les opinions reçues ; celles-ci en effet se sont formées et imposées beaucoup plus tard, à une époque moderne marquée par l’importance de l’idéologie (au sens marxiste où celle-ci impose une vision non scientifique manipulée par un pouvoir).
Pour parler en termes sommaires et simplificateurs on est amené comme l’auteure à utiliser des formules dont la forme est négative (alors que le fond ne l’est pas !). On peut dire que, de tous les faits rapportés dans ce premier volume, jamais ne se dégage l’idée d’une exclusion des femmes ni de leur renfermement dans des espaces clos. Cette façon de parler peut paraître surprenante du fait qu’elle recourt à la négation mais elle s’explique clairement par la nécessité où l’auteure se trouve de démentir à peu près constamment les opinions reçues ; celles-ci en effet se sont formées et imposées beaucoup plus tard, à une époque moderne marquée par l’importance de l’idéologie (au sens marxiste où celle-ci impose une vision non scientifique manipulée par un pouvoir).
Jocelyne Dakhlia affirme la liberté de mouvement dont disposent les femmes dont elle parle et leur mobilité. Si grand renfermement il y a, ce n’est pas aux époques dont parle ce premier volume. Le pouvoir des femmes, sous des formes diverses, existe assurément et même dans le champ politique où l’on peut trouver des « sultanes oubliées » pour reprendre l’expression de la chercheuse marocaine Fatima Mernissi, qui se sont trouvées plus d’une fois associées au trône. D’ailleurs, contrairement à ce qu’on croit, la notion de couple n’est nullement déplacée dans ce contexte historique. On retire de ce premier volume l’idée que « la topique du harem » est totalement inadéquate, le mot « topique » désignant un ensemble de lieux communs ou clichés.
La présence en nombre des femmes s’accompagne de leur parfaite visibilité, ce qui va à l’encontre d’une certaine représentation du gynécée comme monde opaque et insécable ou indifférencié. Maints exemples prouvent que non seulement les épouses musulmanes ne sont pas interdites au regard, jouant un certain nombre de rôles qui les amènent au contraire à s’exposer : elles ont souvent été précieuses à titre de médiatrices ou de négociatrices—ce qui est une manière de dire qu’elles faisaient partie des rouages de l’Etat.
Des changements ne peuvent manquer de se produire à partir de 1415 lorsque les Portugais s’emparent de Ceuta et que leur expansion s’impose au Maroc, entraînant de nombreux échanges entre les deux aires culturelles. Mais l’affirmation grandissante d’une altérité forcément repoussante ne se développe que vers le milieu du 16è siècle, et Jocelyne Dakhlia insiste sur le rôle qu’a joué en ce sens au détriment des femmes, le diplomate et voyageur Léon l’Africain dont la « Description de l’Afrique » est publiée en 1530. En tout cas, ce premier volume de « Harems et Sultanes » allie la rigueur scientifique et l’engagement féministe avec un brio qui rend sa lecture aussi plaisante qu’indispensable.
Denise Brahimi
« J’EMPORTERAI LE FEU », roman, Leïla Slimani, Gallimard 2025
Ce roman est le troisième et dernier d’une série intitulée « Le pays des autres » dont le premier volume est sorti en 2020. On parle en général à propos de cet ensemble d’une fresque historique et littéraire à la fois. La première formule signifie que l’auteure suit chronologiquement le rythme des événements qui se sont succédés pas seulement dans son pays le Maroc mais même plus largement dans le monde. Le récit commence en 1945 lorsque le Marocain Amine rencontre l’Alsacienne Mathilde et qu’ils décident de venir s’installer au Maroc pour y développer une entreprise agricole dans la région de Meknès. Et comme le 3e volume dure à peu près jusqu’au moment de l’écriture, on peut considérer que de 1945 à 2025 ce ne sont pas moins de 80 ans d’histoire marocaine qui sont passés en revue dans l’ensemble de la fresque. Mais le 3e volume, celui qui vient d’être publié et  qui clôt très clairement la série, porte essentiellement sur un laps de temps beaucoup plus limité bien qu’on y voie vivre deux générations. La première est celle d’Aïcha fille de Mathilde et d’Amine et de son mari Mehdi que l’on suit d’assez près jusqu’à sa mort, la seconde est celle de leurs deux filles Mia et Inès, de l’enfance jusqu’à l’âge adulte : Mia est âgée de 6 ans lorsque commence ce troisième volume au début de l’année 1980, alors qu’Aïcha va mettre au monde une deuxième fille Inès. Les 20 années qui suivent sont le moment historique de « J’emporterai le feu ».
qui clôt très clairement la série, porte essentiellement sur un laps de temps beaucoup plus limité bien qu’on y voie vivre deux générations. La première est celle d’Aïcha fille de Mathilde et d’Amine et de son mari Mehdi que l’on suit d’assez près jusqu’à sa mort, la seconde est celle de leurs deux filles Mia et Inès, de l’enfance jusqu’à l’âge adulte : Mia est âgée de 6 ans lorsque commence ce troisième volume au début de l’année 1980, alors qu’Aïcha va mettre au monde une deuxième fille Inès. Les 20 années qui suivent sont le moment historique de « J’emporterai le feu ».
La fresque littéraire est elle aussi centrée sur les personnages de ces 2e et 3e générations avec toutefois des préférences ou une insistance plus marquée sur deux d’entre eux, d’une part Mehdi père des deux filles et d’autre part Mia l’aînée de celles-ci ; ils sont les plus atypiques et se distinguent par la singularité de leur destin ou de leur choix. Dans le cas du père, Mehdi c’est de destin qu’il s’agit : après de brillants succès en tant que Président du Crédit Commercial du Maroc (CCM), il connaît la défaveur du pouvoir et se retrouve en prison. Le coup est si rude qu’il ne survit pas longtemps après sa libération et meurt d’un cancer. Pour Mia, sa vie est déterminée par un choix qu’elle fait très jeune et qui porte sur son appartenance de genre : dès l’âge de 10 ans elle voudrait être le fils et non la fille de son père ; jamais elle ne s’accepte en tant que fille et elle devient résolument lesbienne, si défavorable que soit la société marocaine à toute homosexualité.
Historiquement le Maroc dont il s’agit dans ce livre est celui du Roi Hassan II jusqu’à sa mort en 1999 mais Leïla Slimani évite résolument tout propos qui serait directement politique et consacre bien davantage ses critiques à l’état social du pays. Elles sont importantes et fortes. Cet aspect du livre correspond à une prise de position de l’auteure elle-même, alors que le regard de ses personnages ne va guère au-delà de leur propre appartenance. A partir de cette deuxième génération, la famille Belhaj appartient à la bourgeoisie citadine du Maroc, comme l’avait d’ailleurs voulu Amine, dont tous les efforts visaient à ce but. C’est à la fois une question de mode de vie au quotidien et de culture, l’écart de toute sorte entre les classes sociales étant absolument considérable, en tout cas dans le Maroc de cette époque. Il faudra qu’elle arrive en France, en tant qu’étudiante, pour que Mia y découvre l’existence d’une classe moyenne très modeste, sans doute d’origine prolétarienne ; et tout l’en sépare comme ce sera aussi le cas pour Inès lorsqu’elle viendra à son tour faire des études supérieures à Paris. L’une des caractéristiques de cette bourgeoisie marocaine cultivée est que sa culture, justement, n’est guère qu’occidentale et la coupe des classes populaires qui de ce fait, seraient complètement absentes du roman, si les choses ne changeaient avec le séjour de Mehdi en prison. Là comme ailleurs, il reste un grand bourgeois, mais il est aussi ce personnage atypique qui est capable de dépasser toute appartenance et de vivre de véritables amitiés en dehors de son milieu. Même avant la prison, on voit Mehdi regretter que sa famille ne partage pas davantage certains aspects de la société marocaine dans laquelle elle vit, et notamment la langue, cet arabe qu’il essaie en vain de faire apprendre à sa fille Mia. On en retire l’impression que c’est déjà trop tard pour passer par ce stade des velléités identitaires. En fait, le Maroc des catégories sociales supérieures est résolument ouvert au monde, et ce n’est d’ailleurs plus tout à fait nouveau puisque Selim (devenu Sam) fils d’Amine et frère d’Aïcha est installé à New York et y connaît le succès comme photographe. Il est vrai que lorsque ses parents vont le voir (ce qui donne lieu à quelques pages très amusantes de la part de Leïla Slimani ) ils se sentent complétement inadaptés et vraiment loin de leur domaine de Meknès ! Mehdi en revanche est un banquier international qui prend l’avion trois fois par semaine, c’est dire la différence entre la première et la deuxième génération. Cependant Mehdi est le lieu de nombreuses contradictions sans doute inévitables du fait de sa situation dans l’espace et dans le temps, on a vu qu’il aurait souhaité une meilleure insertion de ses filles dans la culture arabe, mais c’est lui aussi qui tient les propos les plus opposés à toute recherche identitaire (justifiant du même coup le titre du roman : « Ces histoires de racines, ce n’est rien d’autres qu’une manière de te clouer au sol, alors peu importe le passé, la maison, les objets, les souvenirs. Allume un grand incendie et emporte le feu ». Ses deux filles ont d’autant mieux entendu le message qu’elles s’identifient à un lieu personnel et unique, leur propre corps. Ce constat achève quelques décennies d’histoire marocaine étendue sur trois générations.
L’une des caractéristiques de cette bourgeoisie marocaine cultivée est que sa culture, justement, n’est guère qu’occidentale et la coupe des classes populaires qui de ce fait, seraient complètement absentes du roman, si les choses ne changeaient avec le séjour de Mehdi en prison. Là comme ailleurs, il reste un grand bourgeois, mais il est aussi ce personnage atypique qui est capable de dépasser toute appartenance et de vivre de véritables amitiés en dehors de son milieu. Même avant la prison, on voit Mehdi regretter que sa famille ne partage pas davantage certains aspects de la société marocaine dans laquelle elle vit, et notamment la langue, cet arabe qu’il essaie en vain de faire apprendre à sa fille Mia. On en retire l’impression que c’est déjà trop tard pour passer par ce stade des velléités identitaires. En fait, le Maroc des catégories sociales supérieures est résolument ouvert au monde, et ce n’est d’ailleurs plus tout à fait nouveau puisque Selim (devenu Sam) fils d’Amine et frère d’Aïcha est installé à New York et y connaît le succès comme photographe. Il est vrai que lorsque ses parents vont le voir (ce qui donne lieu à quelques pages très amusantes de la part de Leïla Slimani ) ils se sentent complétement inadaptés et vraiment loin de leur domaine de Meknès ! Mehdi en revanche est un banquier international qui prend l’avion trois fois par semaine, c’est dire la différence entre la première et la deuxième génération. Cependant Mehdi est le lieu de nombreuses contradictions sans doute inévitables du fait de sa situation dans l’espace et dans le temps, on a vu qu’il aurait souhaité une meilleure insertion de ses filles dans la culture arabe, mais c’est lui aussi qui tient les propos les plus opposés à toute recherche identitaire (justifiant du même coup le titre du roman : « Ces histoires de racines, ce n’est rien d’autres qu’une manière de te clouer au sol, alors peu importe le passé, la maison, les objets, les souvenirs. Allume un grand incendie et emporte le feu ». Ses deux filles ont d’autant mieux entendu le message qu’elles s’identifient à un lieu personnel et unique, leur propre corps. Ce constat achève quelques décennies d’histoire marocaine étendue sur trois générations.
Denise Brahimi
« LUNDI ILS NOUS AIMERONT », roman par Najat El Hachmi, traduit du catalan,
éditions Verdier, 2025
Dans la vaste catégorie des romans plus ou moins autobiographiques écrits par des jeunes femmes d’origine maghrébine, celui de Najat El Hachmi présente quelques traits originaux.
Le premier de ceux-ci est indiqué par le « nous » qui figure dans le titre. On peut le considérer comme une généralisation aux limites un peu vagues, mais aussi comme renvoyant à un sens bien précis. La narratrice, bien qu’elle assume son rôle à la première personne du singulier, n’en parle pas moins pour deux personnes, elle-même et une autre, celle qui lui a servi de modèle, de guide et d’inspiratrice. Le moment de l’écriture est aussi celui où elle s’interroge sur le rôle voire le destin de celle qui fut sa meilleure amie, et  même plus car on peut sans aucun doute parler d’une relation amoureuse, même si elle n’a pris que très peu la forme attendue de la sexualité. Pourquoi attendue ? Par la volonté de la romancière, qui fait plusieurs fois allusion au désir physique de la narratrice pour son amie—mais à chaque fois dévie ou élude, comme si elle continuait elle-même à s’interroger à ce sujet. On soupçonne qu’elle refuse de réduire l’attirance de la narratrice à une pulsion sexuelle car c’est de bien plus et de bien autre chose qu’il s’agit, même s’il serait malhonnête ou hypocrite de faire disparaître cet aspect.
même plus car on peut sans aucun doute parler d’une relation amoureuse, même si elle n’a pris que très peu la forme attendue de la sexualité. Pourquoi attendue ? Par la volonté de la romancière, qui fait plusieurs fois allusion au désir physique de la narratrice pour son amie—mais à chaque fois dévie ou élude, comme si elle continuait elle-même à s’interroger à ce sujet. On soupçonne qu’elle refuse de réduire l’attirance de la narratrice à une pulsion sexuelle car c’est de bien plus et de bien autre chose qu’il s’agit, même s’il serait malhonnête ou hypocrite de faire disparaître cet aspect.
Donc, ce dont il est question est l’histoire de deux jeunes filles et jeunes femmes, l’une aidant l’autre à s’émanciper des liens familiaux d’abord (et l’on sait ce qu’il en est de leur rigueur, de leur violence, dans le cadre du patriarcat maghrébin) puis des liens conjugaux qui viennent s’y substituer et qui bien que choisis par les deux intéressées s’avéreront profondément décevants. Pour l’amie, on comprend qu’il y a eu avant l’histoire racontée par le roman l’horrible traumatisme d’un mariage forcé aux conséquences interminables mais le sujet de la romancière est ici, clairement, leur double émancipation. Une conquête très dure, payée au prix fort par des jeunes femmes qui certes ont pu se libérer mais pas impunément.
Le livre fait réfléchir à ce processus d’émancipation, qui est le fait nouveau, propre à leur génération. Bien qu’elle le partage, la narratrice reste en retrait par rapport à son amie et inspiratrice, qui elle a pris les risques d’une libération sans frein, à dire vrai suicidaire, même si elle meurt accidentellement. Cette réflexion est liée à l’histoire du pays où se situe l’action, l’Espagne, ici la Catalogne, dont la langue est celle dont le livre de Najat El  Hachmi est traduit. Les romans d’émancipation sont une variante de ce qu’ont été pour les jeunes gens du 19è siècle, les romans d’apprentissage ou de formation. Mais il apparaît qu’au sein de cet ensemble, la variante espagnole est liée à la fin du franquisme (Franco meurt en 1975) et qu’elle est bien connue sous le nom de « movida » notamment grâce aux films de Pedro Almodovar (tels que « Femmes au bord de la crise de nerfs » de 1988). A la fin du siècle dernier, un grand mouvement s’est emparé d’une société enfermée pendant des décennies dans l’immobilisme d’Etat.
Hachmi est traduit. Les romans d’émancipation sont une variante de ce qu’ont été pour les jeunes gens du 19è siècle, les romans d’apprentissage ou de formation. Mais il apparaît qu’au sein de cet ensemble, la variante espagnole est liée à la fin du franquisme (Franco meurt en 1975) et qu’elle est bien connue sous le nom de « movida » notamment grâce aux films de Pedro Almodovar (tels que « Femmes au bord de la crise de nerfs » de 1988). A la fin du siècle dernier, un grand mouvement s’est emparé d’une société enfermée pendant des décennies dans l’immobilisme d’Etat.
Les deux héroïnes du livre vivent leur époque avec une énergie qui ne se dément jamais malgré la dureté de ce qu’elles ont à subir, renforcée par leur origine étrangère et leur nom maghrébin. Le livre montre avec réalisme leurs interminables recherches pour trouver des emplois quels qu’ils soient : en dépit de leurs connaissances et de leurs compétences, c’est toujours comme femmes de ménage qu’elles sont recrutées !
Comme il arrive dans cette catégorie de romans féminins, la narratrice réussit à émerger grâce à l’écriture, c’est-à-dire en devenant une écrivaine dont l’œuvre est publiée. Son amie en revanche entre dans le cycle sans fin de ce qu’on appelle la libération sexuelle, qui n’a de libération que le nom, étant évidemment un esclavage, parfois au sens propre du mot.
Le titre du roman, apprécié en fonction de ce que dit le récit, se révèle ironique et de la part de celles qui feignent de se raccrocher à cet espoir, il est chargé d’autodérision. C’est une sorte de mot d’ordre ou d’acte de foi qu’elles ont décidé d’adopter quoi qu’il en soit, comme un coup de fouet qu’elle se donneraient à elles-mêmes pour se faire avancer. Mais il n’y a évidemment aucune raison pour que se réalise demain ce qui ne l’a pas fait aujourd’hui !
On a la preuve dans le cadre du livre que la demande d’amour qui s’exprime par ce titre n’a pas été satisfaite. Ce n’est certes pas pour le plaisir d’énoncer une loi générale et désespérée mais plutôt pour tenter d’évaluer la part des responsabilités qui dans deux cas précis ont abouti pour l’une à la solitude et pour l’autre à la mort. Dans le premier des deux, la narratrice assume la solitude comme condition nécessaire et inévitable de l’émancipation à laquelle elle n’a cessé d’œuvrer. Il est clair que l’auteure n’a pas voulu écrire une « success story » (histoire d’une réussite) et qu’elle refuse toute idéalisation, ayant fait au contraire le choix de la lucidité. Et pour prendre un exemple, l’amour des enfants pour leur mère, dans le processus d’émancipation de celles-ci, n’est pas forcément gagné. L’auteure, qui a atteint la quarantaine, est à l’âge du bilan et ne veut rien escamoter.
Denise Brahimi
« L’ODYSSEE DU SOLDAT CAPTIF » de Michel Sottet (2022 Jean-Pierre Huguet éditeur)
Michel Sottet est né à Fez, au Maroc. Il fait son service militaire en Algérie, qui prend fin en février 1962. Après des études de philosophie, il enseigne puis dirige pendant toute sa carrière des établissements scolaires souvent « rock’n roll ». Grand amateur d’art, il fait découvrir aux élèves la beauté de la création artistique contemporaine. Après sa retraite, il ouvre un temps une galerie d’art contemporain à Vienne, qui fait découvrir à un vaste public la richesse de cette création.
Il s’est investi depuis des années dans l’écriture, biographies de peintres, nouvelles, et plus récemment romans touchant à l’histoire récente. Ce livre est un roman, inspiré de son parcours en Algérie, totalement fictif, pour autant, mais très documenté, ce qui donne à son récit une aptitude à capter l’attention du lecteur, par la richesse détaillée des informations qu’on y trouve. De plus, le style classique et très soigné de l’écriture permet de le suivre aisément, sans devoir s’interrompre dans des efforts de compréhension comme en suscitent certaines écritures « expérimentales ».
Ce livre est un roman, inspiré de son parcours en Algérie, totalement fictif, pour autant, mais très documenté, ce qui donne à son récit une aptitude à capter l’attention du lecteur, par la richesse détaillée des informations qu’on y trouve. De plus, le style classique et très soigné de l’écriture permet de le suivre aisément, sans devoir s’interrompre dans des efforts de compréhension comme en suscitent certaines écritures « expérimentales ».
Le jeune Lyonnais Isaac a devancé l’appel après son bac, dans une vision romantique de l’armée, pour sortir de sa vie de dilettante peu investi, et aller chercher sous l’uniforme et au soleil une existence différente, virilisante. « Choisir de ne rien choisir ». Comme bien d’autres jeunes gens, il n’avait de ces « événements » que des informations éparses, qui ne l’ont pas dissuadé.
Le livre commence par l’échec de l’embuscade montée par sa section qui est obligée de l’abandonner aux mains des djounouds que l’opération n’a pu intercepter.
Le récit campe ensuite le personnage d’Hacène, qui dirige le groupe de maquisards avec lesquels Isaac va passer les mois qui suivent. Né à Clermont-Ferrand, où sa famille constantinoise s’est installée juste après-guerre, il a fait de solides études scientifiques, et a fréquenté à l’université des militants indépendantistes, ce qui l’a conduit progressivement à rejoindre la lutte, d’abord en Tunisie où il se forme au combat. Il a ensuite franchi la Ligne Morice, sous la férule d’un ancien sous-officier, Momo, emprisonné en Indochine où les commissaires Viet Minh l’ont converti aux luttes anti coloniales, et qui a mis son expérience militaire au service de la cause algérienne. Hélas pour lui, comme beaucoup d’autres, il ne survivra pas à la paranoïa développée par la bleuite autour d’Hamirouche
Au fil du récit, chaque personnage, quel que soit le sort qu’il connaîtra in fine, voit son portrait finement dessiné par l’auteur, ce qui amène le lecteur à s’intéresser à ce récit et aux nombreuses figure qu’il fait vivre. Citons ainsi le lieutenant Bléton, officier du renseignement et « sociopathe ordinaire », et pour faire bonne mesure en matière d’anti-héros, le capitaine Hajoub, tortionnaire sombrement efficace, adjoint d’Hamirouche, et sans le savoir zélé opérateur de l’intoxication montée par le colonel Godard et le capitaine Léger, cette fameuse bleuïte… Il y a aussi Ibrahim, l’oncle d’Hacène, devenu harki après que son colon espagnol l’a licencié pour quitter son exploitation pour s’installer en Espagne, Roger, le colon prisonnier qui parvient à s’évader, Annie et Françoise, les jeunes institutrices épargnées par le Naquib Slimane, chef de katiba dans la wilaya 2. Antoine Garnier le sous-lieutenant chef de poste, ami de l’aspirant médecin, communiste… A côté de ces courts portraits de personnages qui nous les rendent familiers, Michel Sottet fait aussi de courtes mises au point historiques, qui font de son roman un remarquable outil pédagogique pour toute personne s’intéressant à cette histoire du conflit algérien, et tout particulièrement pour les jeunes gens qui l’étudient dans leur programme d’histoire. On entend ainsi parler des camps de regroupement, des SAS et des mokhasni, des harkis, de l’Aspirant Maillot, de l’opération bleuïte mentionnée plus haut… Les précisions sur les armes utilisées, les Sikorski, les bananes, les T6, les pipers, le MAS 36, les MAT 49… sont manifestement bien documentées.
A côté de ces courts portraits de personnages qui nous les rendent familiers, Michel Sottet fait aussi de courtes mises au point historiques, qui font de son roman un remarquable outil pédagogique pour toute personne s’intéressant à cette histoire du conflit algérien, et tout particulièrement pour les jeunes gens qui l’étudient dans leur programme d’histoire. On entend ainsi parler des camps de regroupement, des SAS et des mokhasni, des harkis, de l’Aspirant Maillot, de l’opération bleuïte mentionnée plus haut… Les précisions sur les armes utilisées, les Sikorski, les bananes, les T6, les pipers, le MAS 36, les MAT 49… sont manifestement bien documentées.
Le roman analyse également l’état d’esprit des protagonistes vis à vis du conflit, dressant au final un tableau très complet des différents points de vue, y compris après l’indépendance de l’Algérie. Tout cela se fait au fil d’un récit plutôt prenant, dont il est difficile de prévoir l’issue. Certes, l’esprit romanesque de l’auteur de ces lignes aurait aimé voir se produire, des années après, une rencontre entre Isaac et Hacène, voir quel dialogue possible ou impossible aurait pu se produire entre les deux hommes… Mais ceci pourrait peut-être faire l’objet d’exercices d’écriture par des élèves appelés à travailler sur ce livre ?
Michel Wilson.
« MARCEL, le cœur et les gants » de Bertrand Galic et Jandro chez Delcourt, collection coup de tête 2024
Le scénariste Kris, à qui l’on doit avec Galic la narration du fameux album « Un maillot pour l’Algérie » a la bonne idée de lancer la collection Coup de Tête, chez Delcourt Edition, qui, dans la même inspiration que ce récit, entend « publier de grands récits autour du sport, des histoires vraies à la croisée de la pratique sportive, de l’histoire et des problématiques sociales et politiques ».
 Il ne fait pas de doute que l’histoire de Marcel Cerdan entre dans ce projet, et pour ce qui concerne Coup de Soleil, croise un pan de l’histoire du Maghreb.
Il ne fait pas de doute que l’histoire de Marcel Cerdan entre dans ce projet, et pour ce qui concerne Coup de Soleil, croise un pan de l’histoire du Maghreb.
Galic signe à nouveau le scenario de cet album, qui nous fait découvrir des pans inconnus de la courte vie de Marcel Cerdan mort, comme on le sait dans un accident d’avion le 28 octobre 1949 dans l’archipel des Açores, à 33 ans. On doit à Jandro, excellent dessinateur valencien un dessin remarquable, et très en mouvement.
Marcelino Cerdan et né en 1916 à Sidi Bel Abbès, dans le quartier du « Petit Paris », quatrième garçon d’une famille d’origine espagnole. En 1921, la famille va chercher à améliorer une situation précaire à Casablanca, et Marcel sera identifié comme marocain, et même, bien plus tard comme « bombardier marocain ». Petit, fluet, il préfère le football, mais c’est à a boxe que son père le destine. Il y réussit très jeune, mais « J’aime pas taper sur les autres, maman. J’veux plus jamais boxer », dit-il à 8 ans dans les bras de sa mère.
Avant cela, l’album s’ouvre sur les paysages des Açores où le Constellation d’Air France vient de s’éparpiller… Des étiquettes poétiques ponctuent les images, jusqu’à la carcasse détruite. « Sans doute as tu compris qu’il y a des combats perdus d’avance… même pour le Bombardier marocain ». Que ta vie doit s’éteindre pour que brille la légende… ».
Le football, il n’en est pas question pour son père qui lui fait durement payer quand il désobéit. Il finit par se résigner en enfilant le short cousu par sa mère qui y intègre la médaille pieuse qui le protègera. Son père, qui l’a entraîné à la dure (Ô combien!), le met  entre les mains de son ami Lucien Roupp, propriétaire d’un garage et d’une salle de boxe.
entre les mains de son ami Lucien Roupp, propriétaire d’un garage et d’une salle de boxe.
Sa mère meurt alors qu’il n’a pas 20 ans. Elle sera à jamais la référence de ses combats. De belles images en témoignent et ce beau dialogue dans la cathédrale de Milan en 1939.
Et les victoires s’enchaînent, au Maroc, puis à Paris. Champion de France des super welters en 1938. Puis champion d’Europe en 1939, au Vigorelli devant des chemises noires exaspérées.
Au passage, le récit nous fait connaître son engagement antifasciste. Quand survient la guerre il est dans la marine, au Maroc mais veut se rendre utile. Contacté en France par la résistance, il va combattre à son profit, en reversant une part de ses gains. Il met k.o. un champion fasciste espagnol au Vel d’Hiv devant un parterre nazi, ce qui déclenche une Marseillaise dans cette enceinte, 76 jours après la rafle de 1942, ce que rappelle une étiquette qui mentionne 13152 juifs, dont 4115 enfants…
Revenu au Maroc un peu avant le débarquement américain, il épouse Marinette Lopez, mais apprend en même temps qu’un autre petite amie attend un enfant de lui… C’est que Marcel, c’est aussi un grand amoureux (d’1m69…), et la suite le montrera toujours plus !
Jusqu’à la fin de la guerre il reprend les combats, et met au tapis tous ses adversaires, notamment les G.I.’s, ce qui lui vaut d’être contacté par son futur entraîneur américain pour de futurs combats aux Etats-Unis, en vue du Championnat du monde.
Champion de France des poids moyens le 30 novembre 1945. Son père meurt peu après.
Et c’est la rencontre avec Edith Piaf, joliment racontée. Les premières blessures, ces fameuses « mains d’argile ». Puis le premier voyage, en bateau, aux Etats Unis. Une belle rencontre, elle aussi superbement dessinée et racontée avec Django Reinhardt. Une série de victoires aux Etats Unis, et c’est la belle victoire au championnat du Monde des poids moyens contre Tony Zale, par K.O. technique.
Les premières blessures, ces fameuses « mains d’argile ». Puis le premier voyage, en bateau, aux Etats Unis. Une belle rencontre, elle aussi superbement dessinée et racontée avec Django Reinhardt. Une série de victoires aux Etats Unis, et c’est la belle victoire au championnat du Monde des poids moyens contre Tony Zale, par K.O. technique.
Puis vient le match perdu contre La Motta, sur blessure…
La revanche, reportée à décembre 1949 du fait de La Motta n’aura jamais lieu. Edith Piaf l’attend, ce sera l’avion plutôt que le bateau…
L’album se conclut par le décompte de l’arbitre au Madison Square Garden, le 31 octobre 1949, lors d’une émouvante cérémonie d’hommage.
Eternelle et touchante histoire, splendidement dessinée. C’est du reste la première bande dessinée consacrée à Cerdan.
Elle devrait faire date, tant par la mise en récit que la mise en images…
Michel Wilson

« L’EFFACEMENT », film de Karim Moussaoui, 2025
Ce titre, « L’effacement » a fait parler de lui pour deux raisons, d’abord le roman de Samir Toumi en 2016, d’où viennent l’image et l’idée en effet puissantes et originales que ce mot signifie, puis en 2025, le film de Karim Moussaoui, connu pour son succès précédent, « En attendant les hirondelles », de 2017. La situation de départ est semblable pour les deux œuvres, qui dépeignent à la fois un individu et un pays. En fait il s’agit d’explorer le rapport entre deux générations, celle d’un père et celle de son fils. A l’indépendance le  premier, Youcef, dirige la plus grande entreprise d’hydrocarbures du pays, il partage les mots d’ordre de cette époque, mettant toute son autorité et sa force de travail dans l’immense entreprise de création d’un nouveau pays. Cependant les deux fils de Youcef, Fayçal et Réda, ne prendront ni l’un ni l’autre la succession de leur père, ils incarnent chacun à sa manière la génération qui suit celle des combattants de la guerre d’indépendance, on a d’ailleurs parlé d’un syndrome qui de manière assez générale a frappé celle-ci, ensemble de symptômes qui peuvent aller jusqu’à constituer une véritable pathologie. On a pu dire de « L’effacement , roman et film, qu’il déploie des métaphores éclairantes sur les fêlures de la société algérienne, après la décennie noire et même plus précisément, dans le cas du film, après le mouvement révolutionnaire du hirak, puisque l’une des rares dates fournies est celle de 2021. C’est à peu près le moment semble-t-il où Réda a 44 ans ce qui voudrait dire qu’il est né au début des années 1980. Mais ni le romancier ni le cinéaste ne cherchent une exactitude documentaire et référencée, c’est une autre sorte de vérité qu’ils veulent mettre en valeur, sur la génération à laquelle appartient Réda.
premier, Youcef, dirige la plus grande entreprise d’hydrocarbures du pays, il partage les mots d’ordre de cette époque, mettant toute son autorité et sa force de travail dans l’immense entreprise de création d’un nouveau pays. Cependant les deux fils de Youcef, Fayçal et Réda, ne prendront ni l’un ni l’autre la succession de leur père, ils incarnent chacun à sa manière la génération qui suit celle des combattants de la guerre d’indépendance, on a d’ailleurs parlé d’un syndrome qui de manière assez générale a frappé celle-ci, ensemble de symptômes qui peuvent aller jusqu’à constituer une véritable pathologie. On a pu dire de « L’effacement , roman et film, qu’il déploie des métaphores éclairantes sur les fêlures de la société algérienne, après la décennie noire et même plus précisément, dans le cas du film, après le mouvement révolutionnaire du hirak, puisque l’une des rares dates fournies est celle de 2021. C’est à peu près le moment semble-t-il où Réda a 44 ans ce qui voudrait dire qu’il est né au début des années 1980. Mais ni le romancier ni le cinéaste ne cherchent une exactitude documentaire et référencée, c’est une autre sorte de vérité qu’ils veulent mettre en valeur, sur la génération à laquelle appartient Réda.
Quoi qu’il en soit des changements (ou des non changements) historico-politiques entre 2016 (roman) et 2025 (film), ce qui est réussi est la transposition de l’un à l’autre grâce à des changements d’un autre ordre, utilisant les possibilités offertes par chacun des deux genres artistiques. Le genre romanesque permet une analyse plus conceptuelle, plus mentale qui ne correspond pas au genre cinématographique, beaucoup plus visuel. Dans le  film de Karim Moussaoui cette visualité se manifeste par la grande abondance des paysages, qu’il vaut mieux éviter de dire pittoresques à cause de ce que ce mot implique souvent de joliesse et de facilité. C’est tout l’inverse dans ce que le film donne à voir d’une Algérie puissamment austère, d‘un grande beauté sans doute, mais aux limites du vivable et du supportable : ce ne sont qu’immenses déserts de pierre, dont on ne saurait dire si les murailles de rochers sont purement géologiques ou parfois bâties par l’homme, sortes de ruines impressionnantes et grandioses. Cette nudité du paysage est mortifère, elle donne à ressentir le rejet absolu de l’être humain par son environnement, images métaphoriques en ceci qu’il semble impossible à quelque vie sociale d’y trouver ou d’y fabriquer sa place.
film de Karim Moussaoui cette visualité se manifeste par la grande abondance des paysages, qu’il vaut mieux éviter de dire pittoresques à cause de ce que ce mot implique souvent de joliesse et de facilité. C’est tout l’inverse dans ce que le film donne à voir d’une Algérie puissamment austère, d‘un grande beauté sans doute, mais aux limites du vivable et du supportable : ce ne sont qu’immenses déserts de pierre, dont on ne saurait dire si les murailles de rochers sont purement géologiques ou parfois bâties par l’homme, sortes de ruines impressionnantes et grandioses. Cette nudité du paysage est mortifère, elle donne à ressentir le rejet absolu de l’être humain par son environnement, images métaphoriques en ceci qu’il semble impossible à quelque vie sociale d’y trouver ou d’y fabriquer sa place.
Après le départ pour Paris de Fayçal, incapable de supporter la tyrannie paternelle, toute l’attention se porte sur Réda, dont l’existence est difficile à décrire tant elle est amenuisée et réduite par sa soumission au père, en tout cas aussi longtemps que celui-ci est vivant. Réda ne sait ni ne peut qu’obéir et subir, ce qui se voit aussi pendant toute la période où il est obligé de faire son service militaire, dont la description (longue) est accablante—manière de nous rappeler sans doute l’importance des militaires, y compris aux plus hauts niveaux du pouvoir, pendant les décennies qui ont suivi l’indépendance.
Après la mort du père, il y a bien une ou des tentatives de Réda pour exister autrement ou pour se fabriquer une existence voulue par lui. Sur ce point le verdict porté par le film est sans appel et Réda va d’échec en échec, jusqu’au désastre inclusivement. Sans entrer dans les détails (le film est souvent elliptique, il n’explique pas et ne commente pas), on peut suivre la descente aux enfers du héros à travers certains de ses aspects. Considéré comme une sorte de fantoche mis en place par son père, il n’a aucune crédibilité dans le monde de l’entreprise où les nouveaux chefs et patrons ont la prétention de s’être modernisés. Ils rejettent la génération précédente dans l’archaïsme et dans l’oubli, Réda se fait violemment rabrouer quand il invoque son père et il reçoit l’ordre d’oublier cette référence qui n’a plus cours : la gestion des entreprises n’est pas le lieu du souvenir ni du respect !
S’agissant des femmes, Réda plus ou moins consciemment désire une découverte dont il ignore en fait ce qu’elle serait. Il rejette évidemment le rôle que son père voulait donner à son mariage comme moyen d’ascension sociale et d’enrichissement ; mais pour autant est-il capable de vivre avec une femme quelque chose qui mériterait le nom d’amour ? Il en rencontre une, intelligente, sensible et qui voudrait l’aider, mais d’une part elle est elle-même en difficulté, aux prises avec un problème de divorce et de garde d’enfant, d’autre part et surtout elle comprend que Réda, pauvre garçon perdu, ne peut rien pour elle et réciproquement.
Globalement, le film est une expérience du vide, totalement mortifère et vertigineux. En rendre compte était une tâche difficile pour l’acteur Sammy Lechea : comment dire l’inconsistance, l’inexistence et la perte ? Son jeu tout en retenue évite le pathétique et les effets inutiles. En toute logique, il ne pouvait ouvrir sur aucun espoir.
Denise Brahimi
Denise Brahimi
« LA MER AU LOIN », film de Saïd Amich, franco-marocain, 2024
Ce film est une manière tout à fait atypique de parler du problème de l’immigration. Le personnage principal est un jeune Marocain, Nour, qui quitte son pays au début des années 1980 pour venir à Marseille. Il s’y intègre à un groupe de jeunes comme lui qui aiment faire la fête et vivent matériellement au prix d’une certaine délinquance qui les expose aux intrusions constantes de la police. Par chance pour eux, ils ont affaire à un commissaire de police tout à fait singulier qui les traite avec indulgence et compréhension.  Il s’appelle Serge, il est bi-sexuel, accepté comme tel par sa femme Noémie, et c’est avec eux ou très proche d’eux que vit bientôt Nour. Rien ne l’a préparé à cette situation, si peu conforme aux mœurs marocaines en cette dernière décennie du 20ème siècle, car l’histoire que nous montre Saïd Amich s’étend sur une dizaine d’années (1990-2000) pendant lesquelles le Maroc est encore complètement bloqué dans ses traditions.
Il s’appelle Serge, il est bi-sexuel, accepté comme tel par sa femme Noémie, et c’est avec eux ou très proche d’eux que vit bientôt Nour. Rien ne l’a préparé à cette situation, si peu conforme aux mœurs marocaines en cette dernière décennie du 20ème siècle, car l’histoire que nous montre Saïd Amich s’étend sur une dizaine d’années (1990-2000) pendant lesquelles le Maroc est encore complètement bloqué dans ses traditions.
En revanche cette durée autorise à parler pour ce qui concerne Nour d’un « roman d’apprentissage », d’autant plus qu’il voudrait vraiment comprendre ce qui se passe autour de lui et souffre de n’y parvenir que fort peu. La volonté d’écrire un roman d’apprentissage comme on disait au 19e siècle, ici un film, est explicite chez le réalisateur Saïd Amich qui a dit lui-même s’être inspiré de « L’éducation sentimentale » de Flaubert.
Ce que vit Nour est évidemment commandé par sa situation de migrant, émigré venu d’Oujda au Maroc au prix d’une rupture certainement douloureuse et cruelle. Le film n’est pas très explicite sur les conditions de son départ, ce qu’on comprend est que celui-ci n’a pas été accepté par sa mère qui n’est que reproche à son égard. Et jamais jusqu’à la fin du film elle ne reviendra sur cette rupture, que Nour devra finalement accepter comme un fait irréversible et qui n’en est pas moins un terrible traumatisme—on peut aller jusqu’à parler d’une mutilation.
Double appartenance, double culture, ce sont de beaux mythes idéalisant la situation de l’immigré, alors qu’il doit bien davantage surmonter la sensation quotidienne d’un double rejet. Car on ne saurait dire que Nour se sente non plus totalement chez lui à Marseille, surtout après la mort de Serge qui le protégeait. Il épouse Noémie (peut-être surtout pour répondre au désir de celle-ci ?) mais ce sont alors de nouveaux problèmes qui se posent à lui car il ne parvient pas à accepter pleinement les mœurs très permissives de sa femme. Pour ce qui est du fils que Noémie a eu de Serge, il n’est pas non plus certain que ce garçon soit prêt d’emblée à accepter Nour comme nouveau père. Le film oscille alors entre des incertitudes variées et rien n’aide Nour à acquérir un minimum de stabilité car il a tout autant de mal à régler une autre question qui se pose à lui, celle d’un métier ou d’un emploi qui lui conviendrait. Il hésite entre la tentation de devenir ou de redevenir menuisier, selon sa propre tradition familiale, et une résignation à la pratique alors répandue qui veut que les immigrés marocains travaillent comme ouvriers agricoles (le plus souvent à titre saisonnier) chez les viticulteurs de la région. Cependant cette dernière possibilité s’est amenuisée au cours de la décennie, car les machines ont de plus en plus remplacé les hommes. Et par ailleurs, un travail de ce genre le mettrait à un niveau social très inférieur à celui de Noémie, ajoutant aux difficultés de leur couple et au déséquilibre dont il souffre manifestement.
Il hésite entre la tentation de devenir ou de redevenir menuisier, selon sa propre tradition familiale, et une résignation à la pratique alors répandue qui veut que les immigrés marocains travaillent comme ouvriers agricoles (le plus souvent à titre saisonnier) chez les viticulteurs de la région. Cependant cette dernière possibilité s’est amenuisée au cours de la décennie, car les machines ont de plus en plus remplacé les hommes. Et par ailleurs, un travail de ce genre le mettrait à un niveau social très inférieur à celui de Noémie, ajoutant aux difficultés de leur couple et au déséquilibre dont il souffre manifestement.
Saïd Amich nous fait ainsi assister aux dix années d’incertitude que traverse son personnage mais contrairement à ce qu’on pourrait croire ce ne sont pas pour autant des années de malheur et l’on a même l’impression qu’il en reste une nostalgie, celle du réalisateur peut-être plutôt que celle de son personnage. Au moment du bilan, le charme de cette évocation est dû pour beaucoup à la musique de l’époque, celle du raï qui suscite une émotion complexe et contradictoire, entre douleur et joie. Il est clair que Saïd Amich a voulu lui rendre hommage et c’est peut-être ainsi que s’explique son choix de la période 1990-2000 où le raï est à son apogée.
Pour Nour lui-même et pour les spectateurs, l’emprise exercée par le film vient beaucoup des deux remarquables acteurs que sont Anna Mouglalis dans le rôle de Noémie et Grégoire Colin dans celui de Serge. Nour, si peu sûr de lui, est fasciné par leur capacité à être eux-mêmes sans réserve, dans une sorte d’absolu que les deux acteurs au sommet de leur talent incarnent magistralement. A la fin du film, Houcine, travailleur dans les vignes et incarnation d’une admirable sagesse populaire, ami fraternel de Nour, explique à celui-ci qu’il est inutile de continuer à se poser des questions qui resteront sans réponse. Il faut qu’il accepte de se plonger dans la vie telle qu’elle est et ce sera finalement de cette manière qu’il entrera dans l’âge adulte… Fin ouverte, évidemment, et qui ne préjuge pas de ce qui va se passer ensuite.
Et la mer dans tout cela, physiquement, visuellement très présente, dans sa beauté inouïe ? Elle aussi est un absolu, le contraire de l’être changeant, fluctuant, hanté par le sentiment d’un manque, tel que Nour l’a été mais qu’il ne sera peut-être plus.
Denise Brahimi

Note sur le film « REINE MERE » de Manele Labidi (2025)
Dans ce film franco-belge les deux acteurs Camélia Jordana et Sofiane Zermani, qui jouent respectivement les rôles d’Amel et d’Amor, sont algériens d’origine, mais le parti pris de la réalisatrice est d’aller à l’encontre des usages et poncifs concernant situations et personnages, en sorte que la composante maghrébine de ces deux là est plutôt déniée  qu’utilisée par le film. En revanche l’acteur bien français Damien Bonnard assure pleinement et même davantage le rôle d’un personnage plus légendaire qu’historique, lié à la rencontre entre Arabes et Chrétiens : le célèbre Charles Martel, celui qui arrête les Arabes à Poitiers en 732 comme l’apprennent toujours les écoliers de France, telle la jeune Mouna, 11 ans, fille d’Amel et d’Amor. Elle fait place dans sa vie à un personnage original et amusant, totalement imaginaire, appelé Charles Martel, qui devient son fidèle compagnon, ami et protecteur. L’imagination de la jeune Mouna est si convaincante qu’elle parvient presque à entraîner ses parents dans l’aventure ! En tout cas, pour Mouna, c’est une belle histoire d’amitié qui dure aussi longtemps que le film et que l’enfance de la pré-adolescente habitée par son rêve.
qu’utilisée par le film. En revanche l’acteur bien français Damien Bonnard assure pleinement et même davantage le rôle d’un personnage plus légendaire qu’historique, lié à la rencontre entre Arabes et Chrétiens : le célèbre Charles Martel, celui qui arrête les Arabes à Poitiers en 732 comme l’apprennent toujours les écoliers de France, telle la jeune Mouna, 11 ans, fille d’Amel et d’Amor. Elle fait place dans sa vie à un personnage original et amusant, totalement imaginaire, appelé Charles Martel, qui devient son fidèle compagnon, ami et protecteur. L’imagination de la jeune Mouna est si convaincante qu’elle parvient presque à entraîner ses parents dans l’aventure ! En tout cas, pour Mouna, c’est une belle histoire d’amitié qui dure aussi longtemps que le film et que l’enfance de la pré-adolescente habitée par son rêve.
Denise Brahimi
Note sur « TOUTES PEINES CONFONDUES »de Fatna El Bouih
Le sous-titre de ce livre est parfaitement explicite : « De la disparition forcée à l’engagement citoyen : parcours d’une ex-détenue politique marocaine ».
Le livre a déjà une longue histoire en plusieurs langues. Il a commencé sa carrière au début du siècle grâce aux éditions Le Fennec de Casablanca. Le titre a d’abord été : « Hadith al’Atama »( = Discours des ténèbres ).
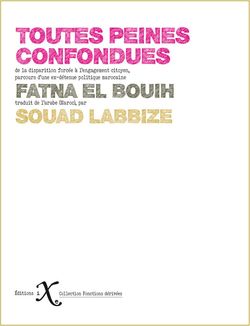 En 2025, les éditions iXe en proposent une traduction de l’arabe marocain en français par Souad Labbize. On sait que cette écrivaine algéro-tuniso-française est à la fois poète, romancière et traductrice.
En 2025, les éditions iXe en proposent une traduction de l’arabe marocain en français par Souad Labbize. On sait que cette écrivaine algéro-tuniso-française est à la fois poète, romancière et traductrice.
De quoi s’agit-il dans le livre de Fatna El Bouih ? Ce sont les souvenirs de détention de l’auteure dans les prisons du Roi Hassan II pendant ce moment de l’histoire marocaine récente qu’on appelle les années de plomb (1960-1980). En fait son incarcération a duré 5 ans, de 1977 à 1982. La détention politique pour les femmes paraissait si inconvenante et inconcevable qu’on préférait leur donner des noms d’hommes !
Le livre contient pour l’essentiel des carnets de prison évoquant la torture, les grèves de la faim et tout un ensemble de mauvais traitements. L’auteure raconte aussi comment, après sa libération, elle a bénéficié des ateliers d’écriture ouverts par Fatima Mernissi, écrivaine, sociologue et féministe, d’une grande générosité. Depuis lors, elle a voulu se mettre elle aussi au service des femmes en difficulté, en créant divers collectifs, des associations et des ONG.
Denise Brahimi

- Vendredi 4 avril Intervention mémoires croisées de la guerre d’Algérie au Lycée François Mauriac à Andrézieux Bouthéon (42)
- Mardi 8 avril Intervention mémoires croisées de la guerre d’Algérie au collège Elsa Triollet de Vénissieux
- Jeudi 10 avril 18 heures rencontre avec les éditrices algériennes de la Revue féministe la Place à la Bibliothèque du Centre Ville à Grenoble
- Jeudi 10 avril 18h Participation à la Table ronde sur le Sergent Blandan à la Mairie de Lyon 1er.
- Vendredi 11 avril Participation à la Journée d’étude Femmes de Lettres arabes d’hier et d’aujourd’hui avec la présence de Maya Oubadi, directrice des éditions algériennes Motifs
- Vendredi 11 avril, Participation à la table ronde sur la signature des accords d’Evian et le cessez le feu 18 et 19 mars 1962
- Samedi 12 avril Participation à l’inauguration de l’Esplanade du 19 mars 1962 à Lyon
- Jeudi 17 avril , Intervention mémoires croisées de la guerre d’Algérie au Collège Colette de Saint Priest
- Vendredi 18 avril Intervention mémoires croisées de la guerre d’Algérie au Collège Jean-Jaurès de Villeurbanne
N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet