Editorial
Cette lettre donne un échantillon des principaux genres que nous présentons habituellement. Le plus répandu figure dans cette sélection, c’est « L’arrivée » de Benjamin Stora, il appartient à la catégorie des mémoires et souvenirs et comme souvent il ne peut recouvrir qu’une partie du passé, ici l’adolescence du jeune Stora, entre l’arrivée de sa famille en France en 1962 quand il avait 12 ans et son entrée dix ans plus tard dans l’âge adulte. Entre les deux Mai 68, un événement majeur pour ce garçon de 18 ans qui entre alors en politique.
Dans la catégorie « souvenirs » quoique présenté sous le titre de roman, on trouvera celui de Yamina Benahmed Daho qui est en revanche un récit d’enfance. Il s’arrête à peu près à la fin de celle-ci, manifestement l’âge de la vie que l’auteure privilégie.
Les souvenirs prennent parfois la forme d’un questionnement, c’est le cas pour« Affreville », le livre de Claire Tencin, qui ne cesse de s’interroger sur ce qu’a fait son père gendarme français en Algérie pendant la guerre d’indépendance : encore une fois, le problème de la torture est posé.
Coup de soleil voudrait ne jamais oublier la poésie et en introduire au moins un peu dans chacune des Lettres. Cette fois, il s’agit du recueil de l’Algérienne Habiba Djanine, « Traversée par les vents » ; ses activités culturelles sont multiples, elle est connue comme féministe algérienne dont la sœur a été tuée en 1995 par les terroristes islamistes.
Par le moyen des notes de présentation, nous attirons l’attention d‘une part sur l’histoire de la littérature tunisienne, qui devrait être très présente au prochain Maghreb des livres, et d’autre part sur le passage à Lyon ce mois-ci du dessinateur palestinien Mohammad Sabaaneh.
Michel Wilson en présentant non pas une mais plusieurs BD, met en valeur la magnifique figure de Gisèle Halimi.
Et naturellement pour finir, on parlera d’un film maghrébin d’une originalité remarquable, « le Gang des Bois du temple » du Franco-Algérien Rabah Ameur Zaïmèche.
Denise Brahimi

Peut-être souhaitez-vous faire un don à notre association, pour contribuer à notre fonctionnement? Et notamment au coût de réalisation de cette Lettre?
Vous en avez la possibilité en cliquant ICI. Merci d’avance!

« L’ARRIVEE. DE CONSTANTINE A PARIS 1962-1972 » par Benjamin Stora, éditions Tallandier, 2023
Le titre de cet ouvrage n’en indique que partiellement le contenu et même son sous-titre paraît trop restrictif. L’arrivée, c’est celle de la famille Stora, des Juifs algériens quittant leur habitat séculaire de Constantine pour participer au grand exode de 1962 vers la France, et ce ne sera pas une mince affaire que d’essayer de s’y installer pour y vivre désormais. Outre le père et la mère, la famille comporte deux enfants dont le jeune  Benjamin alors âgé de 12 ans. Cependant la description de ces événements n’occupe guère que 2 chapitres, 3 au plus, du livre qui en comporte 12. L’arrivée est d’emblée vécue comme définitive, et même si l’on a çà et là quelques exemples des tribulations qui s’ensuivent, démarches épuisantes et certainement évitables si quelque autorité officielle s’en était soucié, on ne peut pas dire que ce soit le sujet du livre, alors que d’autres « rapatriés » l’ont souvent traité.
Benjamin alors âgé de 12 ans. Cependant la description de ces événements n’occupe guère que 2 chapitres, 3 au plus, du livre qui en comporte 12. L’arrivée est d’emblée vécue comme définitive, et même si l’on a çà et là quelques exemples des tribulations qui s’ensuivent, démarches épuisantes et certainement évitables si quelque autorité officielle s’en était soucié, on ne peut pas dire que ce soit le sujet du livre, alors que d’autres « rapatriés » l’ont souvent traité.
Les deux dates qui figurent dans le sous-titre disent clairement la période que l’auteur dit avoir voulu traiter, ce qu’il fait mais pas seulement. Oui il s’agit bien de l’adolescence du garçon qui est l’auteur et narrateur de « L’arrivée », mais en fait toute une série d’indications, d’évocations et de réflexions débordent largement ce cadre temporel. En amont il fallait bien évidemment retracer l’histoire de cette famille juive de Constantine avant l’exode de 62 ; en aval Benjamin Stora revient notamment sur l’une des raisons pour lesquelles on a beaucoup parlé de lui récemment, à propos de son rapport officiel sur les mémoires de la colonisation et de la guerre d’Algérie (2020-2021). Mais surtout « L’arrivée » est riche de tout un ensemble de réflexions sur les principales problématiques qui sont en son cœur et évidemment pas enfermées dans l’espace de 10 années—le moins qu’on puisse dire est qu’elles ne sont pas des moindres : qu’est-ce que s’engager en politique, de manière générale et particulièrement en Mai 68, quelles sont les différentes manières de reconnaître ou pas une appartenance au judaïsme, dans ses relations avec l’universel, la laïcité, le socialisme etc. Sur chaque sujet abordé, l’auteur recourt à ses nombreuses lectures (en sorte que sous une forme très condensée on trouvera aussi dans les notes de  son livre une bonne bibliographie) mais c’est en même temps pour lui l’occasion de préciser sa ou ses positions personnelles, de manière à la fois factuelle et argumentée. Le livre n’est pas polémique, il ne pratique pas l’injure ni la dénonciation ou le dénigrement. Ce qui tient beaucoup à ce que Benjamin Stora évoque à plusieurs reprises comme une attitude qui pourrait être sa définition : plutôt que d’exclure ou de renier, il ajoute, il additionne. Chez quelqu’un qui s’est engagé à ce point politiquement, l’absence de sectarisme est si rare qu’on en est presque surpris ! Il est évident que les constats accumulés des méfaits voire des horreurs du stalinisme n’y sont pas pour rien, Trotsky et les trotskistes ayant payé cher le droit de les dénoncer. De toute façon, Benjamin Stora rappelle fermement son attachement aux principes démocratiques, qui explique d’ailleurs son choix lorsqu’il s’agit de savoir quel militant incarne le mieux à son gré la cause de l’indépendance pour l’Algérie. On comprend fort bien que ce soit Messali Hadj auquel il a consacré de nombreux travaux, dont un livre plusieurs fois réédité : « Messali Hadj, pionnier du nationalisme algérien »
son livre une bonne bibliographie) mais c’est en même temps pour lui l’occasion de préciser sa ou ses positions personnelles, de manière à la fois factuelle et argumentée. Le livre n’est pas polémique, il ne pratique pas l’injure ni la dénonciation ou le dénigrement. Ce qui tient beaucoup à ce que Benjamin Stora évoque à plusieurs reprises comme une attitude qui pourrait être sa définition : plutôt que d’exclure ou de renier, il ajoute, il additionne. Chez quelqu’un qui s’est engagé à ce point politiquement, l’absence de sectarisme est si rare qu’on en est presque surpris ! Il est évident que les constats accumulés des méfaits voire des horreurs du stalinisme n’y sont pas pour rien, Trotsky et les trotskistes ayant payé cher le droit de les dénoncer. De toute façon, Benjamin Stora rappelle fermement son attachement aux principes démocratiques, qui explique d’ailleurs son choix lorsqu’il s’agit de savoir quel militant incarne le mieux à son gré la cause de l’indépendance pour l’Algérie. On comprend fort bien que ce soit Messali Hadj auquel il a consacré de nombreux travaux, dont un livre plusieurs fois réédité : « Messali Hadj, pionnier du nationalisme algérien »
Parmi les ajouts-sans-suppression, il explique comment le désir de s’assimiler vite et pleinement à la France devenu son pays a pu entraîner, pendant les premières années de son « adolescence française » un certain oubli , voire un rejet de l’Algérie comme objet de souvenir, d’engagement ou de préoccupation. Mais il faut croire que consciemment ou pas elle ne l’avait jamais quitté car il y revient au moment de ce qu’on pourrait appeler son entrée dans la vie, et bien avant donc qu’il ne s’engage en tant qu’historien dans l’écriture de nombreux livres consacrés à ce pays. Le choix des dates, jusqu’en 1972 et pas au-delà, explique qu’il n’a pas à parler même pour un survol de cette production d’une incroyable richesse, mais qui sans doute, dans les réflexions placées au cœur de « L’arrivée », n’a pas encore sa place. En revanche l’un des sujets qui s’y trouve traité avec une remarquable acuité, est au chapitre X celui qui s’intitule « La fièvre de la politique ». La méthode de l’auteur est alors très inventive, il pratique une sorte d’objectivité et de mise à distance de soi tout à fait remarquable, comme si « je » y était un autre en même temps qu’un objet d’étude forcément privilégié. Et comme si Mai 68 avait été une sorte de rite de passage  après lequel ce n’est plus un adolescent qui s’exprime mais un adulte. Il ne parle pas autrement de lui-même que du jeune héros des « Quatre cents coups » de Truffaut, avec ni plus ni moins de proximité. Le moment de sa vie qu’il semble préférer est celui où vers les 14-15ans, il était un parmi les autres des gamins de Sartrouville.
après lequel ce n’est plus un adolescent qui s’exprime mais un adulte. Il ne parle pas autrement de lui-même que du jeune héros des « Quatre cents coups » de Truffaut, avec ni plus ni moins de proximité. Le moment de sa vie qu’il semble préférer est celui où vers les 14-15ans, il était un parmi les autres des gamins de Sartrouville.
Le ton qui caractérise ce retour sur soi est désormais trouvé, il est d’autant plus caractéristique qu’il va à l‘inverse de ce qui semble le plus fréquent dans le travail de mémoire où l’introspection favorise généralement l’expression du Moi le plus intime. D’intimité ici il est point question, même si le fait de retracer un itinéraire intellectuel et politique n’exclut pas la sensibilité.
Benjamin Stora nous fait grâce d’un discours sur l’identité et n’emploie pas ce mot, sinon lorsqu’il reproduit quatre de ses photos dites « d’identité », de 1962 à 1972. Étonnamment on croit le reconnaître davantage dans celle de 1962, plutôt que dans le militant sombre et hirsute de 1972 !
Denise Brahimi
« LA SOURCE DES FANTÔMES », roman par Yamina Benahmed Daho, ed. L’arbalète Gallimard, 2023
On est maintenant très habitué à lire des récits largement autobiographes inspirés à des Français(e)s originaires du Maghreb par leur vie en France, et les auteures en sont souvent des femmes, comme c’est le cas ici. Ce fait n’en rend que plus remarquables les qualités propres à « La source des fantômes » : désormais son autrice est devenue écrivaine à part entière, après avoir été professeur de lettres, et écrit quatre autres romans dans les dix dernière années. Quelles sont donc les qualités que fait apparaître « La source des fantômes » ? On apprécie d’abord l’écriture de ce livre, qui est très soignée. Manifestement l’auteure tient à une expression choisie et on se rend compte en la lisant qu’elle a été dès sa petite enfance très sensible non pas à la langue mais aux langues, puisqu’elle a été au contact de plusieurs, même si elle ne maîtrise personnellement que le français. Son père et sa mère, qui sont les deux grandes figures du livre (désormais disparues) ont vécu jusqu’à l’âge adulte en Algérie, ne parlant que l’arabe dialectal avant de venir en France. Son père, bien qu‘ayant fréquenté l’armée française pendant la guerre d’Algérie en tant que harki, ne savait d’ailleurs ni lire ni écrire, a fortiori sa mère, en sorte qu’étant petite fille, elle entendait ses parents se parler dans une langue qu’elle-même ne connaissait pas ; non sans frustration, mais elle comprenait fort bien, intuitivement, le plaisir qu’ils en tiraient —quitte à ce que leur arabe dialectal soit mêlé de mots apportés par la colonisation.
Quelles sont donc les qualités que fait apparaître « La source des fantômes » ? On apprécie d’abord l’écriture de ce livre, qui est très soignée. Manifestement l’auteure tient à une expression choisie et on se rend compte en la lisant qu’elle a été dès sa petite enfance très sensible non pas à la langue mais aux langues, puisqu’elle a été au contact de plusieurs, même si elle ne maîtrise personnellement que le français. Son père et sa mère, qui sont les deux grandes figures du livre (désormais disparues) ont vécu jusqu’à l’âge adulte en Algérie, ne parlant que l’arabe dialectal avant de venir en France. Son père, bien qu‘ayant fréquenté l’armée française pendant la guerre d’Algérie en tant que harki, ne savait d’ailleurs ni lire ni écrire, a fortiori sa mère, en sorte qu’étant petite fille, elle entendait ses parents se parler dans une langue qu’elle-même ne connaissait pas ; non sans frustration, mais elle comprenait fort bien, intuitivement, le plaisir qu’ils en tiraient —quitte à ce que leur arabe dialectal soit mêlé de mots apportés par la colonisation.
La famille s’était installée en Vendée, dans une petite ville qui dans le livre s’appelle Fontayne et qui est en réalité Fontenay. Chacun à sa manière s’y est imprégné peu à peu du patois local, souvent pour s’en amuser, mélangeant allégrement des mots de plusieurs origines. Pour les parents, par le simple fait d’une adaptation au milieu, et sans avoir à faire les efforts considérables que demande l’enseignement scolaire de la langue écrite. Mais les enfants des Benali ont sans doute beaucoup appris aussi par la fréquentation de leurs petits camarades français, dans ce même lotissement où ils étaient les seuls immigrés parmi une dizaine d’autres familles. Le livre ne met pas l’accent, comme beaucoup d’autres de sa catégorie sur cette cohabitation qui aurait pu être problématique mais ne semble pas l’avoir été pour eux. Naturellement les remarques et interjections de type raciste n’ont pas manqué là pas plus qu’ailleurs mais pas au point d’infliger un sort particulier à la famille Benali. Il est vrai que le père en impose par une sorte de prestance qui lui est naturelle et dont ses enfants bénéficient. En tout cas la petite fille qui est devenue la narratrice n’émet aucune plainte sur ce qu’elle aurait pu subir et sur ce qu’elle a vécu : elle est d’ailleurs très discrète sur ce qui s’est passé après sa sortie de l’enfance, c’est cette époque-là qu’elle privilégie—mais son habileté est de ne pas en parler d’un point de vue thématique, en tout cas pas seulement. Elle restitue ce qu’on pourrait appeler la vision du monde d’une enfant, bien que ce mot paraisse trop ambitieux. Le mot vision est à prendre d’abord au sens propre, il s’agit d’une vision rapprochée et qui exclut à peu près tout environnement ; chaque figure est vue pour elle-même, avec minutie, d’une manière qui frappe par sa justesse mais sans le recul qu’il pourrait y avoir si la narratrice se plaçait du point de vue de l’adulte qu’elle est devenue ; or il n’en est rien, globalement on ne trouve dans ce qu’elle dit que des notations parfois malicieuses, et très avisées, mais pas de jugement.
Le livre ne met pas l’accent, comme beaucoup d’autres de sa catégorie sur cette cohabitation qui aurait pu être problématique mais ne semble pas l’avoir été pour eux. Naturellement les remarques et interjections de type raciste n’ont pas manqué là pas plus qu’ailleurs mais pas au point d’infliger un sort particulier à la famille Benali. Il est vrai que le père en impose par une sorte de prestance qui lui est naturelle et dont ses enfants bénéficient. En tout cas la petite fille qui est devenue la narratrice n’émet aucune plainte sur ce qu’elle aurait pu subir et sur ce qu’elle a vécu : elle est d’ailleurs très discrète sur ce qui s’est passé après sa sortie de l’enfance, c’est cette époque-là qu’elle privilégie—mais son habileté est de ne pas en parler d’un point de vue thématique, en tout cas pas seulement. Elle restitue ce qu’on pourrait appeler la vision du monde d’une enfant, bien que ce mot paraisse trop ambitieux. Le mot vision est à prendre d’abord au sens propre, il s’agit d’une vision rapprochée et qui exclut à peu près tout environnement ; chaque figure est vue pour elle-même, avec minutie, d’une manière qui frappe par sa justesse mais sans le recul qu’il pourrait y avoir si la narratrice se plaçait du point de vue de l’adulte qu’elle est devenue ; or il n’en est rien, globalement on ne trouve dans ce qu’elle dit que des notations parfois malicieuses, et très avisées, mais pas de jugement.
Cependant la réflexion adulte existe aussi dans ce livre (bien qu’il soit de petite taille), elle en est un autre aspect que l’auteure revendique sans réserve : elle se donne le droit à ses opinions dans les domaines politique et social et bien que sans militantisme elle s’engage clairement. Son évocation de Fontayne dans ces années-là, qui sont les dernières décennies du siècle dernier, est en fait une analyse précise et claire de la manière dont le néo-libéralisme y a fonctionné. Comme elle prend soin de l’expliciter, ce n’est qu’un cas parmi d’autres de la manière dont, en dépit de toute grève, les entreprises ont licencié par centaines leurs ouvriers. Dans des villes de province petites ou moyennes, où la vie économique était fondée sur leur travail, il s’est avéré que ces fermetures brutales ont fait péricliter tout le mode de vie antérieur et pour le dire plus clairement, c’est la vie tout court qui a peu à peu disparu de ces lieux. Yamina Benahmed Daho a été témoin, dans son enfance et son adolescence, d’une transformation économique et sociale de la France profonde (Fontayne en est un parfait exemple) qui s’est passée dans la plus totale indifférence des pouvoirs en place. Pour ce qui la concerne, elle explique très bien que socialiste ou pas, elle n’est pas prête à oublier. Elle est comme on dit de la mouvance de gauche, ce qui peut se lire dans toutes ses réactions et notamment aussi à propos de la Guerre d’Algérie. Sans éructations et presque mine de rien, elle fait comprendre que les êtres humains ne peuvent subir tant de violences sans en garder les traces. Ce sont des fantômes qui ne cessent de les accompagner.
Denise Brahimi
« AFFREVILLE » par Claire Tencin, récit, ardemment éditions, 2023
Il se peut que le titre de ce récit ne parle pas à ceux qui n’ont pas eu l’occasion de connaître cette modeste localité située à l’ouest d’Alger, sous le nom qu’elle portait à l’époque de la colonisation. L’auteure Claire Tencin a écrit une première mouture de ce texte en 2012 mais sous un autre titre beaucoup plus saisissant : « Je suis un héros, j’ai jamais tué un bougnoul ». Il est vrai que la formule était violente et volontairement brutale, d’ailleurs elle est encore employée dans la nouvelle version du récit et mise par la narratrice dans la bouche de son père, qui est le personnage principal de l’histoire. Ce dernier, gendarme, était en poste à Affreville pendant la guerre d’Algérie et la question qui hante le livre de Claire Tencin est de savoir si comme beaucoup d’autres combattants français pendant cette guerre, il a pratiqué la torture aux dépens des Algériens. Question lancinante qui peut faire penser au mot « affres » contenu dans Affreville, même si cette connotation n’a rien à voir avec l’étymologie puisque Affreville vient du nom de Monseigneur Affre, archevêche de Paris mort pendant la Révolution de 1848. Les affres sont une sorte d’angoisse particulièrement douloureuse, l’adjectif « affreux » est beaucoup plus courant, sans rien perdre de sa force pour autant.
Il est vrai que la formule était violente et volontairement brutale, d’ailleurs elle est encore employée dans la nouvelle version du récit et mise par la narratrice dans la bouche de son père, qui est le personnage principal de l’histoire. Ce dernier, gendarme, était en poste à Affreville pendant la guerre d’Algérie et la question qui hante le livre de Claire Tencin est de savoir si comme beaucoup d’autres combattants français pendant cette guerre, il a pratiqué la torture aux dépens des Algériens. Question lancinante qui peut faire penser au mot « affres » contenu dans Affreville, même si cette connotation n’a rien à voir avec l’étymologie puisque Affreville vient du nom de Monseigneur Affre, archevêche de Paris mort pendant la Révolution de 1848. Les affres sont une sorte d’angoisse particulièrement douloureuse, l’adjectif « affreux » est beaucoup plus courant, sans rien perdre de sa force pour autant.
Cette réflexion sur les mots voudrait dire d’emblée que ce petit livre, guère plus d’une centaine de pages, est remarquable par la façon dont il est écrit. On pourrait être tenté de le réduire à son sujet, qui est historique : il y est question à peu près continûment de la torture et de son usage par l’armée française pendant la guerre d’Algérie. Après une période d’occultation, les faits sont maintenant à peu près connus et reconnus, notamment grâce au livre de Raphaëlle Branche : « La torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie1954-1962 » ( Gallimard 2001). Mais la manière dont ils sont abordés par Claire Tencin est tout à fait originale. La plus fréquente consiste à montrer l’horreur de la répression infligée aux Algériens soulevés contre l’oppression coloniale, et naturellement, il en est aussi beaucoup question dans « Affreville ». Mais l’accent y est mis davantage sur l’autre des deux groupes qui s’y trouve impliqué, donc du côté français, comme ce fut le cas pour le père de la narratrice.
De celui-ci, il est doublement question, une première fois pendant la guerre d’Algérie, alors qu’il est encore un tout jeune homme de 25 ans, dont l’enthousiasme et la générosité n’ont pas trop souffert semble-t-il de sa participation à la guerre précédente, celle d’Indochine ; et une deuxième fois après son retour en France en 1960, où on le suit beaucoup plus longuement jusqu’à sa mort, pendant une quarantaine d’années. A dire vrai, on croit avoir affaire à deux personnages différents, comme si une rupture totale les séparait. Et c’est exactement en ce point qu’est le noeud du récit, et le scandale que la narratrice dénonce en toute indignation, scandale insoutenable qu’elle a été sa vie durant incapable d’accepter. La guerre d’Algérie a littéralement fait disparaître un homme, le jeune homme qui aurait dû être son père et auquel un autre s’est substitué après sa naissance en 1963. Après quoi tout son travail a été, désespérément, de faire revenir le premier, en brisant l’écorce du second, le gendarme français brutal, cynique et grossier. Certes, ses efforts pour que s’opère la remontée des souvenirs ont fait renaître quelques traces du jeune homme d’avant 62, mais il était trop tard pour que survive autre chose que des regrets. « Affreville » est la tragédie d’un anéantissement, le livre ouvre un trou béant laissé par la perte irremplaçable d’un être humain, il se creuse comme une affreuse solitude au sein du drame collectif qu’a été la disparition des victimes torturées englouties par la guerre. La narratrice n’a pas pu connaître les événements de cette guerre, puisque née en 1963, mais une autre l’attendait dont le début a coïncidé avec sa venue au monde. Cette guerre de 40 ans, il lui a fallu la vivre sous la domination familiale du père, jusqu’à ce qu’une crise cardiaque l’emporte, « sans vérité ni histoire à raconter », dans l’anonymat et l’indifférence. A cette dernière la fille n’a rien à opposer que son livre, qui est un cri. On ne peut rien lui comparer que le terrible tableau du peintre norvégien Munch, œuvre célèbre qui porte justement ce titre « Le cri ».
La narratrice n’a pas pu connaître les événements de cette guerre, puisque née en 1963, mais une autre l’attendait dont le début a coïncidé avec sa venue au monde. Cette guerre de 40 ans, il lui a fallu la vivre sous la domination familiale du père, jusqu’à ce qu’une crise cardiaque l’emporte, « sans vérité ni histoire à raconter », dans l’anonymat et l’indifférence. A cette dernière la fille n’a rien à opposer que son livre, qui est un cri. On ne peut rien lui comparer que le terrible tableau du peintre norvégien Munch, œuvre célèbre qui porte justement ce titre « Le cri ».
Munch est mort 20 ans avant la naissance de Claire Tencin. Cette comparaison incite à parler, à propos d’ »Affreville », d’un récit expressionniste, dont le but est d’exprimer la violence des émotions telle que vécue en tout subjectivité. Cette dernière ne supprime aucunement l’objectivité des faits, ici ceux qui constituent la guerre d’Algérie et que les historiens s’emploient à nous faire connaître de mieux en mieux. On voit parfaitement, dans le récit de Claire Tencin, que la littérature crée une sorte de caisse de résonance, permettant le renforcement de l’objectif par le subjectif. Elle s’oppose aux échappatoires que se donne le désir d’oubli.
Denise Brahimi
« TRAVERSEE PAR LES VENTS » par Habiba Djahnine, éditions Bruno Doucey, 2023
On ne sait s’il faut parler d’un recueil de poèmes ou plutôt d’une sorte de coulée poétique sous 17 titres différents, servant à désigner des textes très courts, dont l’ensemble fait à peine 75 pages, et dont plusieurs n’en ont pas plus de cinq pages ou même trois. On sait bien cependant qu’en matière de littérature, la longueur ne fait rien à l’affaire, et surtout s’il s’agit de poésie. Cette poésie est personnelle sinon intime et l’on comprend vite que la personne du titre, « traversée par les vents » n’est autre que la poétesse et auteure du livre, même s’il n’y a pas à proprement parler de contenu autobiographique dans ses vers.  Ce qu’on sait d’elle par ailleurs permet d’identifier l’épreuve dont on sent bien qu’elle est encore mal remise voire bouleversée, celle que l’Algérie toute entière a traversée pendant la décennie noire ; Habiba Dhahnine, née en 1968, avait déjà plus d’une vingtaine d’années quand la terreur a commencé, et surtout elle a été très durement frappée par l’assassinat de sa sœur en 1995 à Tizi-0uzou.
Ce qu’on sait d’elle par ailleurs permet d’identifier l’épreuve dont on sent bien qu’elle est encore mal remise voire bouleversée, celle que l’Algérie toute entière a traversée pendant la décennie noire ; Habiba Dhahnine, née en 1968, avait déjà plus d’une vingtaine d’années quand la terreur a commencé, et surtout elle a été très durement frappée par l’assassinat de sa sœur en 1995 à Tizi-0uzou.
« Le mot « traversée » veut dire que ce cataclysme a fondu sur elle comme un orage, non sans la laisser marquée profondément même si elle est maintenant de l’autre côté —ce n’est pas un sentiment de délivrance qui ressort de ce qu’elle écrit. L’inquiétude en elle reste immense et l’incertitude totale sur ce qui adviendra. Elle met beaucoup de soin à essayer de définir ce qu’il en est de ses sentiments présents, entre espoir et désespoir, pour ne dire les choses qu’en deux mots seulement.
L’image du désert et le désir qu’elle en a prennent la place principale dans sa poésie, et pour commencer par glissement entre les sens du mot « traversée » : on ne peut manquer d’avoir à l’esprit la traversée du désert, au propre comme au figuré. Les vents dont il est question dans son titre font partie du désert, ils pourraient bien être sa principale qualité car ils apportent le mouvement et même jusqu’aux limites de l’envol ; en cela ils sont opposés aux cauchemars qui enferment et que l’auteure redoutait dès son enfance, avant même que ne surviennent les terribles événements.
Sa maîtrise en tant que poétesse apparaît dans son aptitude à tout dire par la simple opposition de quelques mots. Pour n’en prendre qu’un exemple, ce pourrait être tout ce qu’elle parvient à exprimer, lorsqu’elle dit choisir les barricades contre les barrières : les premières signifient, très concrètement, le soulèvement du peuple militant, dont elle a fait partie en des manifestations multiples, tandis que les secondes sont un moyen d’enfermement ( y compris dans des concepts, des mots d’ordre et des slogans).
On pourrait s’étonner que la Kabylie ne soit pas davantage présente dans la poésie de Habiba Djahnine. En fait, tout vient de son exaltation de la liberté, bien mieux représentée par l’espace illimité du désert que par le cloisonnement montagneux. Le désert qu’elle évoque est un lieu physique mais aussi symbolique, lieu des vents qui soulèvent et lieu d’une ouverture vers l’infini, ou encore, pour employer un mot qui a été le point de départ de son poème, lieu des rêves qu’elle valorise non sans dire que les siens ne peuvent être qu’à sa propre mesure, c’est-à-dire trop petits pour l’immense Algérie, son avenir sinon son présent. Les rêves s’opposent aux fantômes, ceux qui ont peuplé le passé mortifère et dont l’invasion redoutable continue à menacer. C’est pourquoi il faut les diluer dans l’espace du désert.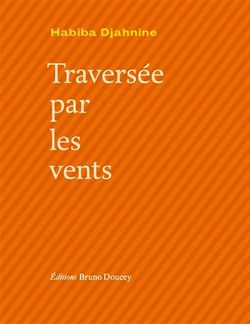 Elle s’interroge sur le rêve car elle le voudrait chargé d’espérance, sans pourtant être sûre de rien, mais pour y croire, loin de se jeter dans un infini abstrait, c’est au contraire à une sorte de noyau primitif, intime et concret, qu’elle revient grâce au souvenir, qui nous vaut l’une des plus belles strophes de son poème : l’heure matinale du café qu’elle prenait avec son père :
Elle s’interroge sur le rêve car elle le voudrait chargé d’espérance, sans pourtant être sûre de rien, mais pour y croire, loin de se jeter dans un infini abstrait, c’est au contraire à une sorte de noyau primitif, intime et concret, qu’elle revient grâce au souvenir, qui nous vaut l’une des plus belles strophes de son poème : l’heure matinale du café qu’elle prenait avec son père :
Le matin entre éveil et sommeil perdu/ je raconte mes rêves à mon père/ Il m’écoute en faisant griller le pain/ Il remplit la coupelle d’huile d’olive/ Il me sert un café/ Il me dit c’est un bon présage(…) pour croire encore croire que les espérances sont aussi belles/ comme une aube en compagnie du père.
Les rêves maintenant débouchent sur une terre inconnue ; à l’opposé du café matinal est venue prendre place une interminable attente qui pour la militante humaniste qu’elle est, évoque celle des migrants— encore une traversée, meurtrière celle-là, pour qui comme elle le dit en mots forts, la Méditerranée n’est pas bleue mais rouge sang.
Comme pour eux mais d’une autre manière, sa vie ne peut être qu‘une vie d‘errance, mais alors que pour eux, celle-ci est la recherche d’une terre réelle, pour elle l’exil est un départ à la rencontre d’un « autre soi ».
Le poème d’Habiba Djahnine ne cesse d’osciller entre la terrible conviction, fondée sur la noirceur d’un passé encore récent, que les efforts présents sont voués à l’échec , et le sentiment d’un « ailleurs possible » lié aux aubes encore renaissantes, ainsi qu’à la présence réelle d’un monde simple et concret : il faut savoir cueillir ou accepter l’orange douce-amère, et mériter la figue de barbarie en la sortant de ses épines. Le désert est le lieu de l’errance et de la solitude, mais il n’est pas interdit d’y chercher une issue.
Ambiguïté du désert, il est le lieu du silence, et pourtant il faut entendre son cri.
Denise Brahimi
« UNE FAROUCHE LIBERTE Gisèle Halimi, la cause des femmes » par Annick Cojean, Sophie Couturier, Sandrine Revel, Myriam Lavialle, 2022 Editions Grasset Steinkis
« GISELE HALIMI, une jeunesse tunisienne » Par Danielle Masse et Sylvain Dorange, 2022 Editions Delcourt/Masse/Dorange
« GISELE HALIMI L’INSOUMISE avocate pour changer le monde » par Jean-Yves Le Naour et Marko 2023 Editions Dunodgraphic
Trois albums de bandes dessinées, plus ou moins inspirés d’ « Une farouche liberté », de Gisèle Halimi et Annick Cojean (voir Lettre 48), de son livre « Fritna » chez Pocket éditions et probablement du « Lait de l’Oranger » (Gallimard) c’est exceptionnel et cela illustre (!) la place qu’on veut donner au parcours et aux combats de cette femme hors du commun. On peut y ajouter « Halimi à la plage » biographie illustrée de Jean-Yves Le Naour et Catherine Valenti (Dunod 2022). Bien sûr, ces biographies, ou plutôt trois versions de ses autobiographies et sont autant de plaidoiries à décharge, et on y chercherait en vain la trace de critiques ou de prises de distances. Mais qu’importe ! Des critiques féroces n’ont pas manqué tout au long de la vie et de la carrière de Zeiza Gisèle Taieb, et même des agressions, des injures et des menaces. Et pas seulement de ses ennemis et de ses adversaires… On les retrouve, plus ou moins détaillées au fil de ces albums, ce qui met en valeur le courage et l’extraordinaire intrépidité de cette femme pour aller « au front » pour défendre des principes qu’elle semble s’être forgés seule, dans une certaine continuité, mais en puisant ici ou là de quoi les nourrir (comme chez son oncle Jacques, communiste athée, honni de sa mère, ou bien plus tard chez Simone de Beauvoir…).
Trois regards portés sur ce parcours impressionnant, trois styles de récit, trois styles de bande dessinée. Commençons par la plus touchante, celle sur l’enfance tunisienne de Zeiza Gisèle. La scénariste Danièle Masse a choisi de s’en tenir à la construction de la personnalité de Gisèle, que sa naissance à La Goulette ne destinait pas à l’évidence à la carrière qu’elle a embrassée.
Commençons par la plus touchante, celle sur l’enfance tunisienne de Zeiza Gisèle. La scénariste Danièle Masse a choisi de s’en tenir à la construction de la personnalité de Gisèle, que sa naissance à La Goulette ne destinait pas à l’évidence à la carrière qu’elle a embrassée.
Son père, Edouard Taieb est juif berbère, assez peu religieux, employé aux écritures dans un office notarial. Il a été naturalisé français quand sa fille avait 3 ans, la rendant donc française ainsi que sa mère et ses frères et sœurs. Sa mère, Fortunée Fritna, descend des juifs d’Andalousie. Fille de rabbin, elle est est beaucoup plus soucieuse des rituels religieux, porte ses fils au pinacle, et réduit ses filles à les servir, ce qui révolte Gisèle. Elle souffrira toute sa vie du manque d’amour de sa mère à son égard, mal compensé par l’affection admirative de son père. Et elle attribuera en partie son parcours à une sorte de revanche et de refus de l’assignation à un rôle de dominée que sa mère a voulu transmettre.
Cet album est le plus détaillé sur le début de la vie de Gisèle, fourmillant d’anecdotes savoureuses et souvent touchantes, et avec un souci documentaire qui le distingue. Le dessin et la colorisation de l’album nous font vivre concrètement dans l’univers de La Goulette, de Carthage, de Tunis, l’animation des rues. Il est donné vie à de nombreux personnages, grand-père, parents, amies, qui jalonnent le début de l’existence de l’héroïne. Vie et mort aussi comme celle dramatique du petit frère André qui causera le déménagement de La Goulette. Mort de Babah, le grand-père qui lui raconte l’épopée de la Kahina, des berbères qui peuplent le nord de l’Afrique, en citant Ibn Khaldoun. La cérémonie de la veille et de la levée du corps est minutieusement décrite, y compris l’interpellation à Dieu de la petite fille pour faire revenir Babah, au scandale de sa mère qui la renvoie avec les femmes… La confrontation de Gisèle avec Dieu est fréquente, bravant les interdits maternels. Elle le met à l’épreuve en n’embrassant pas la mezouza le jour d’une composition de français, qu’elle remporte pourtant haut la main. Il y est raconté combien elle a longtemps souffert d’énurésie, à la grande fureur de sa mère, au point d’avoir souhaité se suicider pour enfin en être aimée, les comprimés d’aspirine n’ayant réussi qu’à provoquer des nausées.
Entrée au lycée, elle observe que les lycéennes arabes sont devenues très minoritaires. La montée en puissance de Bourguiba et du néo Destour, critiqué par ses parents, reçoit son soutien, du haut de ses onze ans, inspirée par ses amies arabes et son oncle communiste. « Ils ont raison de crier La Tunisie aux Tunisiens ! ». Elle s’agace de voir sa mère quémander quelques sous à son mari pour entretenir sa famille. Elle se révolte contre le statut de privilégié de Marcello, son frère aîné, malgré sa paresse et des résultats scolaires déplorables. Elle mène des combats familiaux gagnants pour obtenir de ne plus servir ses frères, ou le droit de lire autant qu’elle le veut.
En 1941 les mesures antijuives de Vichy s’étendent au Protectorat. C’est aussi le moment de ses premières règles, que sa mère oblige à cacher, et qui lui valent de devoir limiter sa fréquentation des garçons, sans autre explication… Elle commence à assister aux réunions du Parti Communiste, vend l’Avenir social journal communiste tunisien, à la grande fureur de son père. Viennent aussi les premières tractations pour tenter de la marier à de riches partis… Dans ses mémoires, nulle trace d’une acceptation, mais certains indices font penser qu’elle a accepté une union très courte avec un certain monsieur Raymond Zemmour, à la fin des années quarante. Mystère sur cet épisode.
Bac en poche avec mention très bien, elle fait le siège de la résidence générale pour un laisser passer afin d’aller étudier le droit à Paris. Elle l’obtient au bout d’un mois et demie. Elle embarque dans un avion militaire, à la grande tristesse de son père. L’album se termine sur cette image, suivie d’un texte de Danielle Masse résumant le reste de sa vie.
Sa vie de femme, sa carrière d’avocate, ses combats, on les trouve dans les deux autres albums.
 Celui de Jean-Yves Le Naour et Marko, fondé sur le Livre de Le Naour « Halimi à la plage » a un ton d’épopée, des dessins minimalistes, parfois symboliques, comme la transformation en cochons des violeurs du procès d’Aix en Provence. Il est très précis et détaillé sur les différents épisodes de la vie de l’avocate, les premier procès en Tunisie, l’apprentissage, un procès avec une sonde d’avortement dans le ventre qui lui vaut un évanouissement, son mariage avec Paul Halimi, dont elle gardera le nom, ses fils Jean-Yves et Serge, son divorce, puis l’Algérie, les accusés du massacre d’El Halia qu’aucun avocat d’Algérie ne veut défendre qu’elle et son confrère Léo Matarasso parviendront à sauver, obtenant la cassation du jugement à charge de Philippeville, Badèche Ben Hamdi, accusé sans preuves de l’assassinat du maire de Boufarik, Frauger, qu’elle ne sauvera pas de la guillotine ; les démarches demandant la grâce auprès du pathétique président Coty, les dossiers du FLN qui lui valent de multiples menaces de mort, un temps de détention au moment du 13 mai 1958, puis les demandes de grâce à De Gaulle, obtenues par les 2 condamnés d’El Halia, la rencontre de Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, celle de Claude Faux le secrétaire de ce dernier, qui devient son grand amour… Enfin le fameux procès de Djamila Boupacha, son premier procès usant tout les moyens de la pression politique, article de de Beauvoir, pétitions de personnalités dénonçant la torture et le viol pratiqués sur l’accusée. Le cessez le feu du 19 mars 1962 sauvera Boupacha , mais elle ne parvint pas à lui permettre des études en France, le FLN la kidnappant en accusant Gisèle d’opération publicitaire…
Celui de Jean-Yves Le Naour et Marko, fondé sur le Livre de Le Naour « Halimi à la plage » a un ton d’épopée, des dessins minimalistes, parfois symboliques, comme la transformation en cochons des violeurs du procès d’Aix en Provence. Il est très précis et détaillé sur les différents épisodes de la vie de l’avocate, les premier procès en Tunisie, l’apprentissage, un procès avec une sonde d’avortement dans le ventre qui lui vaut un évanouissement, son mariage avec Paul Halimi, dont elle gardera le nom, ses fils Jean-Yves et Serge, son divorce, puis l’Algérie, les accusés du massacre d’El Halia qu’aucun avocat d’Algérie ne veut défendre qu’elle et son confrère Léo Matarasso parviendront à sauver, obtenant la cassation du jugement à charge de Philippeville, Badèche Ben Hamdi, accusé sans preuves de l’assassinat du maire de Boufarik, Frauger, qu’elle ne sauvera pas de la guillotine ; les démarches demandant la grâce auprès du pathétique président Coty, les dossiers du FLN qui lui valent de multiples menaces de mort, un temps de détention au moment du 13 mai 1958, puis les demandes de grâce à De Gaulle, obtenues par les 2 condamnés d’El Halia, la rencontre de Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, celle de Claude Faux le secrétaire de ce dernier, qui devient son grand amour… Enfin le fameux procès de Djamila Boupacha, son premier procès usant tout les moyens de la pression politique, article de de Beauvoir, pétitions de personnalités dénonçant la torture et le viol pratiqués sur l’accusée. Le cessez le feu du 19 mars 1962 sauvera Boupacha , mais elle ne parvint pas à lui permettre des études en France, le FLN la kidnappant en accusant Gisèle d’opération publicitaire…
Claude Faux parvient à la convaincre de l’épouser (un goy dans la famille ! dit sa mère), et d’avoir un enfant avec lui, le petit Emmanuel – pas de fille pour cette féministe viscérale…
Puis ses combats dans le sillage de Sartre-de Beauvoir l’emmènent en Espagne, au Viet Nam, au Chili… Quelques candidatures aux élections, et les grands combats pour légaliser l’avortement (le manifeste des 343, la création de Choisir, les procès de Bobigny, le combat pour une loi de légalisation, la rupture avec de Beauvoir et le MLF, les retrouvailles avec Simone Veil connue lors du procès de Boupacha, et son soutien à la loi Veil, malgré les limites qu’elle y critique.
Puis le combat contre le viol, le procès d’Aix en Provence, les menaces et les insultes, la campagne électorale de Choisir pour obtenir une nouvelle l égislation, belle campagne, mais piètre résultat. Après l’élection de François Mitterrand elle se laisse convaincre de se présenter à Voiron, où elle est élue. Mais doit ensuite enregistrer les désillusions en marge du groupe socialiste, ce qui l’amène à démissionner, acceptant temporairement une ambassade auprès de l’UNESCO.
Viendront ensuite les batailles pour la parité à l’Assemblée où elle côtoie… Roselyne Bachelot, celle pour la clause de l’Européenne la plus favorisée…
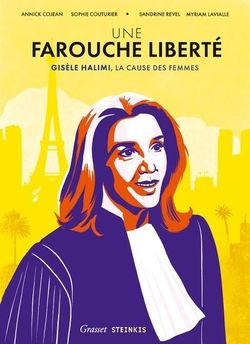 Le troisième album, Une farouche liberté est sans doute le plus autobiographique. C’est Gisèle elle-même, devenue une très vieille dame, qui en fait la narration. Le dessin de Sandrine Revel est le plus réaliste, illustrant efficacement le récit qui recourt fréquemment à la citation issue du livre cosigné avec Annick Cojean. Certains épisodes sont ici plus détaillés comme la rencontre avec Claude Faux, le procès de Bobigny. On retrouve dans les deux livres les rendez-vous discrets dans des « bistrots moches » avec Simone Veil où la Ministre de la Santé peut « s’en griller une » sans risquer une mise en contradiction publique avec les campagnes antitabac.
Le troisième album, Une farouche liberté est sans doute le plus autobiographique. C’est Gisèle elle-même, devenue une très vieille dame, qui en fait la narration. Le dessin de Sandrine Revel est le plus réaliste, illustrant efficacement le récit qui recourt fréquemment à la citation issue du livre cosigné avec Annick Cojean. Certains épisodes sont ici plus détaillés comme la rencontre avec Claude Faux, le procès de Bobigny. On retrouve dans les deux livres les rendez-vous discrets dans des « bistrots moches » avec Simone Veil où la Ministre de la Santé peut « s’en griller une » sans risquer une mise en contradiction publique avec les campagnes antitabac.
Les dernières pages sont très belles, où la vieille dame « transmet le flambeau » à de jeunes disciples allongés autour d’elle dans une prairie. « N’ayez pas peur de vous dire FEMINISTES ! C’est un mot magnifique, vous savez. C’est un combat valeureux qui n’a jamais versé le sang ».
La lecture de ces trois bandes dessinées laisse le lecteur fasciné par cette trajectoire déterminée, guidée par une conviction sans faille acquise très jeune pour l’égalité et la justice pour les femmes.
A faire lire aux jeunes générations.
Michel Wilson

« LE GANG DU BOIS DU TEMPLE », film de Rabah Ameur-Zaimèche, 2023
Ce film appartient à plusieurs genres, ce qui veut dire qu’il crée le sien propre, donnant ainsi une impression agréable de différence et de nouveauté. Géographiquement, il appartient aux films de banlieue, son nom évoque un quartier de Clichy-sous-bois, aujourd’hui disparu. Il comporte un braquage, montré très rapidement, on oserait dire vite expédié, de manière à faire comprendre que ces faits-là ne sont pas ce qui intéresse le réalisateur, pas plus que la prison qui s’ensuit pour l’un des braqueurs en tout cas. Manifestement le film malgré sa longueur (presque deux heures) ne cherche pas à décrire avec précision ce qui se passe dans certaines banlieues populaires, de manière à enrichir les connaissances du public à cet égard, et sa longueur est au contraire le moyen de faire dévier son contenu par rapport à son supposé  objet. On dirait presque que c’est un jeu, de la part du réalisateur, que de lancer le spectateur sur des pistes qu’il reste libre de suivre ou pas.
objet. On dirait presque que c’est un jeu, de la part du réalisateur, que de lancer le spectateur sur des pistes qu’il reste libre de suivre ou pas.
Côté personnages, on a affaire à un groupe de garçons de banlieue, dont un seul est pourvu d’une femme et de deux adorables enfants, qui ne ressemblent sûrement pas à de futurs voyous . Le mot gang, pour se désigner, est peut-être choisi par eux-mêmes avec un brin d’humour et de dérision. Certes ils sont tout prêts à monter, et même minutieusement, un coup qui leur rapporterait beaucoup ; pour autant, on ne pense pas forcément en les voyant à les désigner comme gangsters, un mot qui paraît beaucoup trop fort et beaucoup trop violent pour leurs manières dépourvues de cruauté. On a plutôt envie de voir en eux de gentils garçons d’un naturel amical et sociable, certes prêts à jouer le jeu du banditisme souvent décrit mais dans l’épisode qui nous est montré, ils semblent beaucoup plus soucieux de moralité que les personnages auxquels ils s’en prennent. Ceux-ci sont en revanche de très grands voyous d’envergure internationale, riches parmi les riches d’Arabie saoudite ou des Emirats qui en imposent par des allures de grand seigneurs appartenant à l’élite sociale. Les petits gars du gang sont vraiment naïfs de croire qu’ils pourront faire le poids contre de tels adversaires, et marquer un point contre eux. Il est vrai que dans un premier temps, le coup semble réussi : c’est à peine s’ils osent y croire eux-mêmes et ils sont fous de joie à l’idée de pouvoir réaliser leurs rêves d’enfant. Mais la riposte ne va pas tarder, et malgré les valises de billets dont ils ont réussi à s’emparer, ils ne vont pas loin avant de se faire prendre, non certes par la police mais par les redoutables et tout-puissants seigneurs auxquels ils ont étourdiment oser s’attaquer.  Cela pourrait suffire à faire un film, qui trouverait là sa conclusion et comme on dirait pour une fable ou un récit sa morale—bien peu morale à dire vrai mais réaliste et désabusée : petits gangsters, n’essayez pas de jouer dans la cour des grands car ils vous mangeront. La lutte des classes passe aussi par là, implacable ici comme ailleurs, elle est illustrée par ce qui pourrait être le dénouement du film : le jeune aspirant gangster, néanmoins père de famille et amoureux passionné de sa jeune épouse, est abattu férocement dans la cour de la prison à l’heure de la promenade—inutile de se demander pourquoi ni comment, on l’a vu brûler avec rage et désespoir l’une des valises volées aux Emiratis, qui contenait de très précieux documents (dont nous ne saurons rien mais qu’importe, ce n’est pas le sujet).
Cela pourrait suffire à faire un film, qui trouverait là sa conclusion et comme on dirait pour une fable ou un récit sa morale—bien peu morale à dire vrai mais réaliste et désabusée : petits gangsters, n’essayez pas de jouer dans la cour des grands car ils vous mangeront. La lutte des classes passe aussi par là, implacable ici comme ailleurs, elle est illustrée par ce qui pourrait être le dénouement du film : le jeune aspirant gangster, néanmoins père de famille et amoureux passionné de sa jeune épouse, est abattu férocement dans la cour de la prison à l’heure de la promenade—inutile de se demander pourquoi ni comment, on l’a vu brûler avec rage et désespoir l’une des valises volées aux Emiratis, qui contenait de très précieux documents (dont nous ne saurons rien mais qu’importe, ce n’est pas le sujet).
Cependant le réalisateur n’a pas envie d’en rester là , manifestement il est du côté des petits, ce qui veut dire aussi du côté des enfants ; il s’est attaché à deux d’entre eux et il lui faut inventer un moyen pour qu’ils soient sauvés. Or ils ont sans le savoir tout près d’eux un ange protecteur d’une étrange sorte. Cet ancien militaire qui fut en son temps mercenaire au service des causes les plus brûlantes, est devenu gardien d’immeuble dans cette cité qui nous a été présentée longuement au début du film ; c’est un homme un peu énigmatique adonné au pastis et à l’observation de ses semblables. De ses aventures passées et de sa carrière sur laquelle il reste fort discret, il a gardé dans ses placards un armement impressionnant qui va lui permettre de liquider sans bavure et presque sans bruit l’émirati supposé invincible. Ainsi revient, au moins provisoirement, la paix des cités, non sans dégâts collatéraux. Ce bilan pourrait rendre la fable un peu noire, mais le réalisateur ne s’y attarde pas, pas plus que sur le rouge du sang versé. Comprenons bien, une fois pour toutes, que ce n’est pas son sujet.
Bien plus remarquable est la fantaisie dont il fait preuve, par exemple lorsqu’il montre de manière inattendue, en la personne de l’odieux émirati, un remarquable danseur qui éblouit les braves petits gangsters du quartier —mais que ne s’en tient-il à cette excellence ! Cette danse est sans doute son espace de liberté, les autres personnages ont aussi le leur, lié à l’innocuité de leurs divertissements : on peut être aspirant- voyou et nourrir gentiment les pigeons.
Cette liberté de ton caractérise l’ensemble du film, confirmant l’impression que l’imprévisible réalisateur se veut d’abord bon conteur, échappant pour cela à tout enfermement. Celui qui est la marque des films d’action, policiers principalement, est l’enfermement rigoureux dans le temps qui leur est imposé ; et c’est contre lui que résistent « les bois du temple », jusqu’à la provocation. Des scènes apparemment vides y sont prolongées sans vergogne, sans qu’il s’agisse toujours de « suspenses » débouchant de manière (trop) attendue sur un événement. Non, ce n’est pas l’intrigue qui commande, elle n’a pas tous les droits.
La contemplation, le temps qui dure et ses lentes dérives sont un but en soi. Ne nous privons surtout pas de ce qui se passe, ou ne se passe pas, dans les à-côtés de l’intrigue, gardons le temps de regarder au balcon ou de papoter entre copains, sans oublier pastis ni pigeons.
Denise Brahimi
Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.
 – Utiles
– Utiles
de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun
Cliquez ici pour voir le film et le mot de passe utilesjoussour

–Entre nos mains
de Leila Saadna
Cliquez ici pour voir le film, puis mot de passe utilesjoussour
Et sa bande-annonce, cliquez ici

NOTES DE PRESENTATION
« UN SIECLE DE LITTERATURE EN TUNISIE 1900-2017 » par Samia Kassab-Charfi et Adel Khedher, éditeur Honoré Champion, 2019
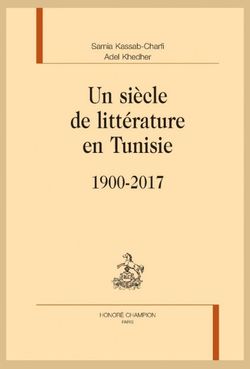 Ce livre est une somme d’informations. Bien qu’il soit paru depuis quelques années déjà, il reprend en cette fin d’année 2023 toute son actualité du fait que la Tunisie est le pays invité au Maghreb des livres en novembre à Paris.
Ce livre est une somme d’informations. Bien qu’il soit paru depuis quelques années déjà, il reprend en cette fin d’année 2023 toute son actualité du fait que la Tunisie est le pays invité au Maghreb des livres en novembre à Paris.
Le champ de recherche des deux auteurs commence avec le 20e siècle et va jusqu’aux deux premières décennies du 21e. L’accent est mis sur la diversité des langues qui, de longue date, fait la richesse de ce pays. De manière non problématique semble-t-il, il est tout à fait bilingue, en sorte qu’on voit alterner dans le livre les chapitres consacrés à la littérature en arabe et ceux du domaine francophone. Sans que d’autres soient oubliés, par exemple la littérature italienne et la littérature judéo-tunisienne. Pour chacun de ces domaines linguistiques, le livre fait place aux différents genres qui y sont représentés, ce qui permet de faire certaines remarques. La poésie est mise à la première place par les auteurs alors que dans de nombreux pays, occidentaux en tout cas, c’est le genre romanesque qui l’emporte sur tous les autres. Dans le domaine arabe, on constate l’importance tenue par l’essai comme genre, au point qu’un chapitre entier lui est consacré, ce qui n’est pas le cas pour la littérature en français. Il semble qu’on puisse observer la même différence pour le genre théâtral. Les auteurs disent d’ailleurs leur volonté de ne pas enfermer leur riche matériau dans des catégories trop strictes et cherchent davantage à montrer la richesse des échanges au sein de ce riche patrimoine littéraire, dont ils pensent qu’il est encore aujourd’hui sous-estimé, au sein de l’ensemble des littératures maghrébines. Ils ont eu l’excellente idée de vouloir donner quelques preuves à l’appui de leur enthousiasme et de leur admiration, pour les faire partager par les lecteurs. C’est pourquoi ils ont ajouté à leurs analyses des genres et des auteurs une « anthologie sélective » qui ne fait pas moins d’une centaine de pages et qui permet d’intéressantes découvertes. D’autant qu’elle s’accompagne d’une bibliographie elle aussi sélective néanmoins précieuse.
 Les auteurs ne cherchent nullement à raccorder les deux littératures en arabe et en français, qui à bien des égards ont suivi leurs chemins propres, mais ils traitent de l’une et de l’autre avec une même attitude très appréciable : ils ne s’en tiennent pas à une histoire littéraire érudite à base de titres et de noms mais ils assortissent les uns et les autres de commentaires sensibles, qui relèvent de l’analyse littéraire. Le livre comportant de nombreuses références historiques, il est un enrichissement apporté à l’histoire culturelle du 20e siècle vue du point de vue de la place de choix qu’y occupe la Tunisie.
Les auteurs ne cherchent nullement à raccorder les deux littératures en arabe et en français, qui à bien des égards ont suivi leurs chemins propres, mais ils traitent de l’une et de l’autre avec une même attitude très appréciable : ils ne s’en tiennent pas à une histoire littéraire érudite à base de titres et de noms mais ils assortissent les uns et les autres de commentaires sensibles, qui relèvent de l’analyse littéraire. Le livre comportant de nombreuses références historiques, il est un enrichissement apporté à l’histoire culturelle du 20e siècle vue du point de vue de la place de choix qu’y occupe la Tunisie.
Denise Brahimi
Mohammad Sabaaneh à Lyon
Le dessinateur palestinien de presse et de BD était en visite à Lyon ce mois de septembre 2023 à l’occasion d’une tournée en France pour la présentation de son livre « Je ne partirai pas »aux éditions Alifbata. Il réside à Ramallah. Sa venue s’est faite en partenariat avec ERAP : Echanges Rhône-Alpes Auvergne Palestine. A Lyon, après une séance de signatures à la Librairie La BD, ses oeuvres ont été exposées à l’IFCM : Institut français de culture musulmane ; l’exposition était accompagnée d’une conférence qui a rassemblé plus de 80 personnes. L’exposition a ensuite été présentée en divers lieux de Vénissieux, en présence de l’artiste le 11 septembre, où elle a rencontré d’autres publics, qui ont pu apprécier le talent de cet artiste à la personnalité attachante, mêlant douceur et courage.
Sa venue s’est faite en partenariat avec ERAP : Echanges Rhône-Alpes Auvergne Palestine. A Lyon, après une séance de signatures à la Librairie La BD, ses oeuvres ont été exposées à l’IFCM : Institut français de culture musulmane ; l’exposition était accompagnée d’une conférence qui a rassemblé plus de 80 personnes. L’exposition a ensuite été présentée en divers lieux de Vénissieux, en présence de l’artiste le 11 septembre, où elle a rencontré d’autres publics, qui ont pu apprécier le talent de cet artiste à la personnalité attachante, mêlant douceur et courage.

- 3 octobre à Lyon 19h19 au Théâtre Astrée (Lyon 1, Campus de la Doua) « MEMOIRES COLLECTEES » sur la guerre d’Algérie, par la compagnie lyonnaise Collectif 81% .
- 12 octobre à 18h30 à l’IFCM de Lyon, projection du film « LE RETOUR » de Saïd Oulmi, en présence du réalisateur
- Du 13 au 15 octobre à Perpignan, Assemblée Générale de l’Association Nationale des Pieds-noirs progressistes et leurs amis (ANPNPA), avec conférences, exposition…
- Les 28 et 29 octobre à l’Hôtel de Ville de Paris, MAGHREB DES LIVRES organisé par l’association Coup de Soleil
N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.



