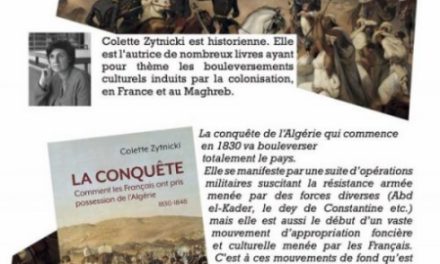Violence ordinaire dans l’Algérie coloniale (camps, internements, assignations à résidence), Sylvie Thénault, Paris, Odile Jacob- histoire, 2012, 381 p., sources, bibliographie, index lieux et personnes.
Violence ordinaire dans l’Algérie coloniale (camps, internements, assignations à résidence), Sylvie Thénault, Paris, Odile Jacob- histoire, 2012, 381 p., sources, bibliographie, index lieux et personnes.
En cette année du cinquantenaire de l’indépendance de l’Algérie, riche en ouvrages de circonstance, ce livre nous donne un résumé exceptionnellement dense sur la politique au quotidien (« violence ordinaire ») dans le pays qui fut le fleuron du système impérial français. L’auteure a exploré dans les archives un aspect spécifique de l’outillage politique colonial : l’internement administratif, peine infligée hors du système judiciaire. A partir de là on parcourt presque un siècle et demi de l’Algérie coloniale, si largement dominé par l’administration militaire, à la fois modèle pour le système impérial français, et reflet des rapports sociaux de part et d’autre de la Méditerranée. L’auteure insiste sur la méthode indispensable pour entrer réellement dans le fonctionnement de cette administration coloniale : retrouver les traces de la pratique « de terrain » des agents de base en proie à leurs administrés (à travers les hasards de rapports et de correspondances rencontrés), dans un pays où plus qu’ailleurs les textes juridiques sont la couverture que les supérieurs de ces agents (généralement au Gouvernement général à Alger) tissent pour présenter ou habiller ces pratiques pour les lointains bureaux parisiens et pour les hommes politiques français. Ces textes juridiques donnent la vision d’un déroulement rationnel et simplifié d’une réalité bien plus violente et bien plus chaotique.
Chacune des trois parties de l’ouvrage s’ouvre sur une « anecdote », histoire vécue choisie au milieu d’une masse de cas similaires. La première partie décrit l’Algérie coloniale à son apogée, à la fin du XIXe siècle, quand les textes composant le « code de l’indigénat » sont en place à partir de 1881. Il s’agit de mesures remplaçant les peines judiciaires pour ce qui concerne en principe les atteintes à la souveraineté française sous ses diverses formes, mais aussi le pèlerinage à la Mecque sans autorisation et le vol de bétail (bechara), délit particulièrement insaisissable spécifique de sociétés rurales où les troupeaux utilisent des terrains de parcours non clos ; mais une foule de crimes et délits de droit commun sont ainsi punis sans jugement formel, par les autorités indigènes nommées par les français (caïds, cheikhs, etc.), puis exclusivement par les officiers et administrateurs français. Outre les punitions infligées au plan strictement local (vingt fois plus nombreuses), les peines plus graves sont en principe réglementées et contrôlées par la hiérarchie et consistent en amendes collectives, internement administratif, séquestre (c’est à dire confiscation) des biens (terres en particulier, parfois collectives).
L’auteure montre que ce système de peines, mais aussi ce système administratif en général, se retrouve ailleurs dans l’Empire, y compris dans les protectorats (Tunisie, Tonkin- Annam), parce que les situations de pouvoir sont comparables, parce que le personnel français tourne entre ces territoires et que les textes juridiques établis pour l’Algérie sont souvent recopiés pour un autre territoire Elle montre que la France connaît aussi, mais exceptionnellement (catégories sociales déviantes comme les Tziganes, moments exceptionnels comme 1848, 1870 ou comme les attentats anarchistes de 1893) l’internement administratif. A titre anecdotique, ce ne sont pas des masses d’indésirables qui sont déportées en Algérie en 1848 mais moins de 500 hommes, affectés au déblaiement des ruines romaines de Lambèse, puis dans la foulée à la construction du pénitencier réputé pour la dureté de son régime jusqu’en 1962. Par rapport à d’autres nations « civilisées », la France répugne autour de 1900 aussi bien aux exécutions sommaires pratiquées « sur le terrain » par les militaires, qu’aux internements en camps de concentration (Afrique du sud de la guerre des boers ou Namibie allemande).
Notons qu’à cet apogée du système, depuis 1876, la part du territoire algérien (non saharien) cédée par l’armée à l’administration civile se monte à la moitié, que celle-ci se divise en une petite minorité gérée « à la française » (les confettis de quelque trois cent petites communes de plein exercice avec juges de paix) au milieu des soixante dix grandes communes mixtes gérées par des administrateurs nommés et disposant du pouvoir de punir. Très tôt l’armée recrute chez ses sujets algériens des soldats engagés volontaires, mais n’établit qu’en 1913 (au meilleur d’un régime colonial apaisé) une conscription, donc un devoir de service militaire. Il est appliqué seulement par tirage au sort avec autorisation de se faire remplacer, ce qui était le régime pratiqué en France pendant une bonne partie du XIXe siècle. Il provoque, en particulier dans les Aures en 1917, une révolte qui groupe jusqu’à « 60 fusils », contre laquelle la répression de l’armée concentre jusqu’à 15000 hommes.
Le régime algérien de l’indigénat a été construit par les officiers au cours d’un demi siècle de tâtonnements. Qu’il s’agisse de progression des territoires conquis ou de répressions de révoltes sur ceux-ci, c’est une guerre de guérilla que conduit l’armée, avec comme arme légale le conseil de guerre. L’internement est pratiqué sur le territoire algérien, mais aussi en France, en particulier pour des otages « de marque », dont la vie quotidienne dépend du statut social. Les derniers centres d’internement disparaissent en 1903, vingt ans après la dernière rébellion (chez les Ouled Sidi Cheik). Dès 1844 des officiers sont spécialement affectés à l’administration des bureaux arabes, dont les communes mixtes avec leurs administrateurs civils sont les héritières directes. Avec leurs adjoints indigènes nommés, ils appliquent dès 1844, selon les normes établies par Bugeaud, la pyramides des peines administratives. Suite à une tentative après 1870 d’intégrer au code civil français des pratiques indigènes (par exemple la día, « prix du sang », pour les meurtres), ces pratiques sont interdites à partir de 1881 (mais la día fonctionne en fait plus tard hors toute norme légale, tout comme les peines administratives infligées par les fonctionnaires indigènes).
C’est à partir de la première guerre mondiale que la pratique coloniale est démantelée, perdant peu à peu sa légitimité. Celle-ci avait été mise en cause dès 1909 par le député Albin Rozet, qui connaissait bien l’Algérie. La présence au front de dizaines de milliers d’Algériens, sans compter cent mille autres dans les usines de guerre en France, donne des droits à ces sujets français : quelle citoyenneté leur accorder ? La loi Jonnart de 1919 crée en Algérie un corps électoral indigène (43% de la population masculine) composé de ceux qui par leurs propriétés, leur métier, leurs services rendus, sont honorablement considérés. Ils votent pour les djemaas des douars, les assemblées des communes, les délégations financières du Gouvernement général, avec une représentation toujours minoritaire par rapport aux citoyens français. A ces quasi- citoyens ne s’applique plus le code l’indigénat. Alors que faire d’eux en cas de punition collective d’un douar ? En 1927 les pouvoirs disciplinaires des administrateurs de communes mixtes sont légalement supprimés ; en 1944 le Comité de libération (ancêtre du gouvernement provisoire de la République restaurée) supprime les peines de séquestre et d’amende collective.
En fait dès les années 1914- 18 les archives montrent que l’administration se désintéresse de la surveillance de l’Algérie rurale traditionnelle pour s’inquiéter du militantisme urbain nouveau : modernisme laïc des Jeunes Algériens, modernisme religieux des Oulemas, nationalisme de l’Etoile nord-africaine de Messali Hadj qui nait au milieu des travailleurs émigrés en France en 1926. Mais dès avant la seconde guerre mondiale l’Algérie dans son ensemble est surveillée plus encore que la France, car on y envoie systématiquement des indésirables, étrangers en particulier, à moins que ceux-ci traversent la mer pour fuir l’Espagne ou l’Europe nazie. Des camps sont à nouveau créés, qui accueillent jusqu’à 2400 internés entre 1941 et 1942, ce que dénoncent dès l’automne 1942 des journalistes anglo-américains.
En mai 1945 la répression du mouvement nationaliste arrête « à chaud » 1000 personnes, plus 3000 arrestations de militants fichés par les autorités. Mais c’est le moment où l’on découvre l’horreur des camps nazis et tout internement durable est rejeté par Paris. Parallèlement se développe une campagne d’amnistie des personnes condamnées par des tribunaux d’exception, tant pour les collaborateurs en France que pour les nationalistes en Algérie.
Tout change au printemps 1955 avec la proclamation de l’état d’urgence en Algérie (puis en France) : on crée quatre centres de détention (pour chacun des trois départements algériens, plus un en territoires du sud) : 1600 détenus fin 1955 ; certes la Croix-Rouge a un droit de visite, mais certains détenus le restent sept ans. Leur chiffre monte à 7500 en avril 1958, 11000 en 1959. Il faut y ajouter jusqu’à 4500 détenus directement par l’armée qui les a pris « les armes à la main », dont le statut oscille entre prisonniers de guerre et rééducation civique ou en puissance de « recherche du renseignement ». Tous ces lieux de détention sont des foyers actifs de la propagande nationaliste du FLN, en Algérie comme en France.
L’auteure n’étudie pas les champs immenses des camps de regroupement, qui accueillent à partir de 1955 plus de deux millions d’algériens, avec proportionnellement à la composition de cette population plus de vieillards, d’enfants et de femmes que d’hommes valides : c’est le fruit de la politique « rurale » de l’armée française face à la constitution de maquis en 1955, établir des zones rurales interdites de plus en plus vastes, dont les populations démunies sont accueillies dans des camps improvisés où une subsistance minimale, une assistance médicale précaire et une scolarisation partielle remplacent la vie « traditionnelle » de communautés de cultivateurs et d’éleveurs ainsi déracinées, en fait sans retour après 1962 pour une large majorité des intéressés.
L’auteure conclut en affirmant que le pouvoir colonial n’a à aucun moment acquis assez de légitimité en Algérie pour se passer d’un usage arbitraire de la contrainte. L’Etat algérien a hérité, particulièrement dans les années 1990, des pratiques de l’internement colonial, comme de la géographie des lieux de détention