Editorial
La réception de cette nouvelle Lettre n’a pas été perturbée par l’événement de cette fin de mois qui est, vous l’avez compris, le Maghreb des livres à l’Hôtel de ville de Paris les 28 et 29 octobre. Il est probable que cet afflux considérable de livres aura des effets (heureux bien sûr) sur la Lettre suivante, la 82.
Pour cette fois, et en attendant l’afflux annoncé, on va commencer par trois films, qui méritent tout notre intérêt : 2 films de fiction, « Abdelinho » d’un autre Ayoub marocain à ce jour moins connu que son frère, de Nadir Moknèche désormais un maître du cinéma maghrébin après de nombreuses réalisations, et le remarquable documentaire de Franssou Prenant sur la conquête de l’Algérie mais si l’on peut dire, à la fois passé et présent.
Nous vous parlons aussi de livres évidemment : les Ensoleillés qui iront au Maghreb des Livres retrouveront certains de ceux dont nous leur avons déjà parlé, et d’autres encore, comme ceux dont nous parlons dans cette Lettre 81 :
-Parmi les œuvres de fiction et de création, 2 exemples assez piquants par leur originalité, « Terminus Babel » de Mustapha Benfodil et « Mon fantôme » de Mehdi Ouraoui.
-Intitulé « Nancy-Kabylie » le livre de Dorothée-Myriam Kellou fait bien plus que de parcourir cet axe géographique, il est un travail sur la mémoire et une réflexion sur l’écriture.
-Nous vous invitons à lire des publications indispensables sur les grands piliers la littérature maghrébine, le journal de Jean Sénac, pour l’anniversaire de son assassinat en août 1983, l’hommage de Maïssa Bey à celle en qui elle voit son modèle et son guide, Assia Djebar, et toujours présents parmi nous grâce à de nombreux travaux critiques, Mohammed Dib, évoqué cette fois à travers un livre de Charles Bonn
La lettre 81 a le plaisir de révéler une nouveauté qui illustre la créativité propre à Coup de Soleil : il s’est créé une association des écrivains qui font partie de ses membres et grâce à Annie Barranco, nous publions un exemple du travail qui pourra être fait au sein de ce groupe.
A cela s’ajoute 2 notes de présentation pour signaler à nos lecteurs l’utilité du livre de Michel Pierre et les manifestations en cours pour l’anniversaire de la Marche des Beurs de 1983.
Grâce à Michel Wilson, vous découvrirez une BD sur le sociologue Pierre Bourdieu, peut-être inattendue et non moins précieuse.
Denise Brahimi

Peut-être souhaitez-vous faire un don à notre association, pour contribuer à notre fonctionnement? Et notamment au coût de réalisation de cette Lettre?
Vous en avez la possibilité en cliquant ICI. Merci d’avance!
Et si vous souhaitez nous faire le plaisir de nous rejoindre en adhérant, c’est LA!

Parution du 10è épisode du podcast « Et de nous qui se souviendra ? », le 16 novembre 2023.
« Pierre-Henri, Saint-Eugène », le 10ème épisode du Podcast Et de nous qui se souviendra est en ligne.
https://smartlink.ausha.co/et-de-nous-qui-se-souviendra/pierre-henri-saint-eugene
« C’est à la façon dont elle respecte ses anciens qu’on reconnait une grande nation » affirme Pierre-Henri, le Pied-Noir marseillais de Notre-Dame d’Afrique. Celui qui a mené croisade pour la réhabilitation des cimetières français en Algérie analyse les raisons d’un échec. Il nous parle aussi de ses réussites, et notamment le retour des Pieds-Noirs en Algérie. De ses nombreuses initiatives de coopération et de rapprochement des peuples, menées à la manière d’un entrepreneur, il retire une vision claire des relations franco-algériennes depuis l’indépendance de l’Algérie.
 « Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).
« Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).
Hommage à une communauté en voie de disparition, il a pour objectif d’aider les pieds-noirs à transmettre. Il s’adresse à leurs descendants, aux enseignants qui souhaitent parler de la guerre d’Algérie, et plus largement à tous ceux qui s’intéressent aux exils et à la résilience. Il interroge l’exil comme acte fondateur ainsi que les questions d’identité, d’invisibilité et d’intégration. Il pose également la question de la transmission et de la mémoire des pieds-noirs.
Le projet a démarré en janvier 2022, année de commémoration du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.
Pour écouter les épisodes déjà parus : https://podcast.ausha.co/et-de-nous-qui-se-souviendra

« TERMINUS BABEL » par Mustapha Benfodil, roman, éditions Macula, 2023
Mustapha Benfodil, journaliste à Alger, écrit dans des genres littéraires variés depuis l’an 2000 et pour ceux qui le découvriraient avec « Terminus Babel », la force de son attachement aux mots apparaîtrait d’emblée comme une évidence réjouissante ; tant il est vrai qu’on est pris continûment pendant tout le livre par un flot incessant de paroles qui ne cesse de submerger le lecteur dans une histoire… ou une absence d’histoire …absolument époustouflante : ce mot peu académique voudrait dire à quel point le lecteur perd son souffle à suivre cet étonnant mélange de fantaisie et de culture. D’ailleurs on n’a pas le choix de suivre ou de ne pas suivre, nous sommes embarqués ! L’auteur nous met d’emblée en présence d’une invention certes peu commune, concernant le personnage principal de son livre, qui en est le narrateur à la première personne : ce n’est pas une créature humaine mais un livre, un livre qui parle et qui se révèle même très bavard car il a beaucoup à dire.
D’ailleurs on n’a pas le choix de suivre ou de ne pas suivre, nous sommes embarqués ! L’auteur nous met d’emblée en présence d’une invention certes peu commune, concernant le personnage principal de son livre, qui en est le narrateur à la première personne : ce n’est pas une créature humaine mais un livre, un livre qui parle et qui se révèle même très bavard car il a beaucoup à dire.
Ce livre qui s’appelle « K’tab » (c’est le même sens en arabe) est évidemment l’expression d’un auteur, qui ne peut manquer d’être présent et de prendre lui aussi la parole pour raconter sa vie et celle de ses proches, sa femme et sa fille et c’est pour Mustapha Benfodil un excellent moyen de montrer l’écart entre ce que dit un livre et ce qu’on a coutume d’appeler la réalité. Cet écart existe toujours, même dans les romans supposés très autobiographiques, d‘où peut venir en effet l’idée que le livre comme c’est le cas ici a une sorte d‘autonomie… pour le meilleur et pour le pire. Le pire, toujours en vertu de l’invention fantaisiste qui est à l’origine de « Terminus Babel » est que ce malheureux «K’tab », à la suite d’une mésaventure domestique, a complétement cessé d’être présentable et convoité comme il l’était auparavant par d’éventuels lecteurs et lectrices ; son apparence devenue défectueuse en a fait un objet de rebut, et le voilà donc condamné au pilon, lieu où sont jetés tous les livres voués pour une raison quelconque à la destruction. Il faut être amateur de livres au point où l’est Mustapha Benfodil pour ressentir, dans sa propre chair dirait-on, la tristesse voire l’horreur de cette condamnation : détruire un livre, n’est-il pas un acte criminel, et qui pourtant, par le procédé de la mise au pilon se pratique couramment comme la chose la plus normale du monde sans susciter la moindre indignation ? L’affabulation principale qui constitue l’intrigue de « Terminus Babel » est que dans ce cas singulier, la menace va être déjouée et qu’un millier de livres ou presque auxquels celui-ci appartient vont être épargnés, au moins provisoirement, échappant ainsi à l’affreux broyage qui semblait être leur immédiate destinée. Evidemment Mustapha Benfodil choisit selon ses goûts et affinités les autres livres et les autres auteurs qui partageront le sauvetage dont bénéficie »K’tab », le choix est d’ailleurs vaste car l’auteur a beaucoup d’enthousiasme et d’objets d’admiration, on ne peut tous les citer ici, il est probable que lecteurs et lectrices en reconnaîtront un certain nombre qui sont aussi les leurs. Mais au-delà de la bibliothèque idéale que chacun se constitue comme précieux accompagnement de sa vie, on voit aussi apparaître l’idée que ce monde des livres, qu’on peut souhaiter le plus nombreux possible, devrait s’organiser selon une logique qu’il s’agirait d’inventer, même si la rigueur requise pour ce travail n’est pas celle de la rationalité.
Evidemment Mustapha Benfodil choisit selon ses goûts et affinités les autres livres et les autres auteurs qui partageront le sauvetage dont bénéficie »K’tab », le choix est d’ailleurs vaste car l’auteur a beaucoup d’enthousiasme et d’objets d’admiration, on ne peut tous les citer ici, il est probable que lecteurs et lectrices en reconnaîtront un certain nombre qui sont aussi les leurs. Mais au-delà de la bibliothèque idéale que chacun se constitue comme précieux accompagnement de sa vie, on voit aussi apparaître l’idée que ce monde des livres, qu’on peut souhaiter le plus nombreux possible, devrait s’organiser selon une logique qu’il s’agirait d’inventer, même si la rigueur requise pour ce travail n’est pas celle de la rationalité.
Le rêve de cette bibliothèque à la fois exhaustive et pourtant infinie est emprunté à un auteur que tous les amoureux fervents (et quasi mystiques) des livres se reconnaissent sans doute pour maître, l’Argentin Jorge Luis Borgès qui travailla à la bibliothèque de Buenos Aires et dont l’œuvre la plus connue est une nouvelle qui s’intitule justement « La bibliothèque de Babel » ; elle est de 1941, et incluse dans son recueil« Fictions ». L’univers du livre s’y avère vertigineux et propre à susciter les plus étonnantes imaginations.
Plus proche de lui, en tout cas dans le temps, Mustapha Benfodil se réfère souvent à un groupement d’écrivains qui s’est donné le nom d’Oulipo : ouvroir de littérature potentielle. A son origine se trouvent des écrivains et poètes tels que Raymond Queneau, un autre nom célèbre parmi les participants est celui de Georges Pérec et s’il y a une idée à retenir de celles qu’ils se font sur la littérature, c’est que celle-ci ne peut naître que de contraintes, définies par les écrivains eux-mêmes, qui choisissent de se les imposer.
Les patronages et affinités qu’il se reconnaît font que Mustapha Benfodil, malgré les difficultés (le mot est faible) de la vie quotidienne à Alger, est loin de se sentir seul mais au contraire très entouré, et l’un des charmes qu’il nous fait éprouver est qu’il concilie fort bien un double aspect : d’une part, il est très inséré dans la vie quotidienne d’Alger et vante pour des raisons très concrètes plusieurs des quartiers dans lesquels il a été amené à vivre, d’autre part, il est complétement ouvert sur le monde, en droit sans limite, et rien de ce qui s’y écrit ne lui est étranger. Malgré le fait qu’il reste assez discret sur les tribulations qu’il lui faut affronter, on en devine la difficulté, mais son écriture n’est jamais une plainte, elle est au contraire extrêmement stimulante et doit aux livres, à tous les livres, l’enthousiasme qui s’en dégage. Il est l’inventeur, pour lui et pour nous, d’une sorte de « Babel Alger ».
Denise Brahimi
« MON FANTÔME » par Mehdi Ouraoui, roman, éditions Fayard, 2023
Ce livre est le premier roman de son auteur, qui pour autant n’est pas un débutant dans le domaine de l’action (politique) ni dans celui de la réflexion, ayant largement dépassé la quarantaine même s’il n’est pas encore cinquantenaire comme le personnage principal et narrateur du roman. Celui-ci s’appelle Mehdi comme l’auteur mais pour autant on ne saurait parler d’un roman autobiographique, ce qui est une première singularité dans la littérature écrite en France par des gens qu’on désigne parfois comme « de la deuxième génération ». Cette formule veut dire que leurs parents étaient encore très proches de leur origine maghrébine, en sorte qu’eux, leurs enfants, même destinés à une vie complètement différente, n’ont pu manquer d’en être partiellement imprégnés, et c’est généralement cela qu’ils veulent raconter.

Chez Mehdi, narrateur du livre, cette imprégnation est très relative, et il ne semble pas désireux d’insister sur la place que cette sorte d’héritage a pu tenir dans sa vie ou dans sa personnalité. Concrètement et dans la vie quotidienne, sa part française semble être plus importante : quoique plus ou moins séparé d’elle il a été marié avec une personne qui porte un prénom français Cécile, avec laquelle il a eu trois enfants ; l’un d’eux certes est prénommé Jalil mais il vit aux Etats-Unis et sa culture ainsi qu’une partie de son langage sont américaines, non maghrébines. La dernière de leurs enfants, Norah, qui n’est pas encore vraiment détachée du noyau familial, semble un parfait exemple de ce que sont en France les filles de sa génération et Mehdi n’est sûrement pas le genre de père à vouloir lui inculquer quelques bribes, même infimes, de ce qui pourrait la rattacher aux ancêtres familiaux. Comme le livre donne l’occasion de le voir, Mehdi est peut-être psychologiquement un peu perturbé, il commet sans doute des erreurs ou plus simplement des gaffes, mais ce n’est sûrement pas par l’effet d’un attachement obstiné à la tradition algérienne, le problème de la double culture ou de la double personnalité étant bel et bien absent de ce roman. Telle est son originalité.
Mais alors, d’où vient le dérapage qu’on sera finalement amené à constater chez Mehdi et qui s’avère, à un moment donné, véritablement pathologique, puisqu’il faut recourir à un établissement et à une médecine spécialisés pour le tirer d’affaire (sans trop de difficulté semble-t-il )?
Le fantôme dont il est question dans le titre n’y est sans doute pas pour rien, c’est avec lui que le livre commence, et il ne disparaîtra qu’au dénouement. C’est donc à une sorte de long et bizarre fantasme qu’il nous est donné d’assister et on se dit que l’événement qui est à son origine a dû être gravement traumatisant pour Mehdi bien que de traumatisme il ne parle pas lui-même. L’événement en question est un fait historique bien réel, il s’agit de la mort du musicien Rachid Taha, très connu dans les milieux du rock et du raï et dont la mort prématurée alors qu’il n’avait pas soixante ans a certainement produit un choc, surtout chez ceux qui ne le sachant pas atteint d’une maladie rare et grave en ont été très surpris. Le roman de Mehdi Ouraoui est arrimé à la date de cette mort, qui a eu lieu en septembre 2018 mais, fait encore bien plus surprenant que celui-là, Rachid Taha réapparaît trois mois plus tard en tout cas dans la vie de Mehdi qui va désormais être accompagné en secret par le fantôme amical de ce mort redevenu vivant. Rachid et Mehdi ont de fréquents dialogues, ce qui d’ailleurs fait partie des étrangetés que l’entourage de Mehdi ne va pas tarder à remarquer avec inquiétude. Pour les autres, Mehdi est quelqu’un qui parle tout seul, ce qui évidemment n’est pas bon signe !
Le roman de Mehdi Ouraoui est arrimé à la date de cette mort, qui a eu lieu en septembre 2018 mais, fait encore bien plus surprenant que celui-là, Rachid Taha réapparaît trois mois plus tard en tout cas dans la vie de Mehdi qui va désormais être accompagné en secret par le fantôme amical de ce mort redevenu vivant. Rachid et Mehdi ont de fréquents dialogues, ce qui d’ailleurs fait partie des étrangetés que l’entourage de Mehdi ne va pas tarder à remarquer avec inquiétude. Pour les autres, Mehdi est quelqu’un qui parle tout seul, ce qui évidemment n’est pas bon signe !
Sans doute pour essayer d’encadrer ce que nous avons désigné par le mot de dérapage (difficile pour les non professionnels de se risquer dans le vocabulaire psychiatrique)Mehdi présente cette histoire bizarre avec mainte précision de date, et c’est ainsi que nous commençons, le 26 décembre 2018, par la première apparition de Rachid Taha aux côtés de Mehdi. Dans le récit que nous lisons, les choses se passent tout naturellement et personne, ni l’auteur ni ses personnages ni même les lecteurs n’a jamais le sentiment de se mouvoir en plein fantastique : encore une habileté ou une ruse de l’auteur qui se garde bien de prévenir son brave lecteur du type d’aventure dans lequel il l’a embarqué; et c’est ainsi que tout le monde se retrouve, le 15 novembre 2019 à l’institut de santé mentale de La Verrière, juste au moment où il semble bien que Mehdi soit devenu capable d’en partir, après y avoir séjourné quelque temps.
On comprend alors quelle sorte d’épisode vient de s’insérer dans la vie de Mehdi, non sans l’aide du médecin lui-même qui juge que son patient mérite quelque explication : « Votre comportement de ces dernières semaines a suscité, disons, de l’inquiétude, en tout cas suffisamment d’incompréhension chez vos proches pour les conduire à solliciter une aide extérieure ».
Le lecteur lui aussi a droit à un complément d’information qui n’est pas des moindres mais qu’on se gardera bien de divulguer ici : il s’avère que l’auteur est expert dans la manipulation et les rebonds de l’intrigue romanesque. Tout ce qu’on avait lu avec une sorte de bonne foi naïve prend finalement un sens plus subtil : comme des somnambules, nous avons longé des précipices et ne le savions pas.
Denise Brahimi
« UN CRI QUE LE SOLEIL DEVORE » par Jean Sénac, 1942-1973 , Carnets, notes et réflexions, éditions du Seuil et El Kalima, août 2023
La date de parution de ce livre est chargée de signification. C’est l’exact anniversaire de l’assassinat en Algérie du poète Jean Sénac. Les conditions exactes de sa mort n’ont jamais été élucidées. Il avait 47 ans, étant né en 1926 à Béni-Saf en Oranie. C’est donc pour le cinquantenaire de sa mort que le gros volume dont il est ici question a été publié.  Commencé en 1942, alors que Sénac avait 16 ans et poursuivi jusqu’au 20 août 1973 on peut dire que ce journal recouvre à peu près tout l’itinéraire de sa vie, dans l’ordre chronologique, mais de manière très inégale car certaines années sont très remplies alors que d’autres sont réduites à presque rien. Et ce qui ne frappe pas moins est le caractère très hétérogène des fragments qui le constituent, beaucoup d’entre eux n’ayant certainement pas été prévus pour une publication. Le résultat est qu’on trouve aussi bien des passages narratifs, plutôt courts, des poèmes souvent incomplets et inaboutis mais qui parfois ont été repris pour la publication dans d’autres recueils, des évocations de très nombreux personnages, parfois réduits à leurs seuls noms, ou même à des initiales, des bribes d’écriture sur des supports tout à fait inattendus et cependant récupérés grâce au travail du professeur Guy Dugas qui a établi cette édition et l’a accompagnée de très nombreuses notes.
Commencé en 1942, alors que Sénac avait 16 ans et poursuivi jusqu’au 20 août 1973 on peut dire que ce journal recouvre à peu près tout l’itinéraire de sa vie, dans l’ordre chronologique, mais de manière très inégale car certaines années sont très remplies alors que d’autres sont réduites à presque rien. Et ce qui ne frappe pas moins est le caractère très hétérogène des fragments qui le constituent, beaucoup d’entre eux n’ayant certainement pas été prévus pour une publication. Le résultat est qu’on trouve aussi bien des passages narratifs, plutôt courts, des poèmes souvent incomplets et inaboutis mais qui parfois ont été repris pour la publication dans d’autres recueils, des évocations de très nombreux personnages, parfois réduits à leurs seuls noms, ou même à des initiales, des bribes d’écriture sur des supports tout à fait inattendus et cependant récupérés grâce au travail du professeur Guy Dugas qui a établi cette édition et l’a accompagnée de très nombreuses notes.
Les connaisseurs de la vie et de l’œuvre de Jean Sénac trouveront dans ce livre toute sorte de compléments à ce qu’ils savent et beaucoup de précisions qu’ils ignoraient peut-être. D’autres tireront des renseignements inclus dans ces 800 pages une sorte de familiarité avec leur auteur et sans doute aussi une empathie avec lui, car la forme très souple de ces notes variées donne le sentiment qu’on le suit dans le désordre même de sa vie, traversant comme lui des hauts et des bas mais surtout des bas, souvent très douloureux, voire suicidaires. On comprend qu’il lui fallait se battre contre un fond dépressif accru par les désordres de son mode de vie. Même s’il n’est pas du genre à se plaindre de son corps, ne serait-ce qu’en raison des jouissances qu’il en tire, on a le sentiment qu’il en a souvent abusé, en le nourrissant peu ou mal, et en ne lui assurant pas assez de repos, ne serait-ce que sous la simple forme du sommeil.
De toute façon, il apparaît à la lecture de ce journal qu’une série de circonstances difficiles ne le laisse jamais en repos. Il commence son journal d’écolier encore sage en pleine deuxième guerre mondiale, puis vient le moment où les troubles de l’adolescence se doublent chez lui de constats ou en tout cas de prémonitions, forcément angoissantes, concernant les goûts homosexuels qu’il découvre en lui. Car il est profondément chrétien et obsédé par l’idée du « vice ». Il se découvre un autre goût, tout aussi irrépressible, pour la poésie, et il s’adonne à de très nombreuses lectures, qui l’entretiennent dans un état constant d’émotion ou d’hyper-sensibilité. D’autant qu’avec le goût de la littérature, apparaît le désir d’écrire et de publier une œuvre personnelle, ce qui n’est pas une mince affaire. La passion politique ne lui vient qu’assez lentement ; elle prend chez lui la forme d’une émotion, mélange de douleur partagée et d’indignation pour ce que subissent les pauvres, les humiliés, et la masse du peuple arabe —ceux qu’on n’appelait pas encore couramment les colonisés, mais c’est pourtant bien la situation coloniale qui est devenue insupportable à Sénac.
Il passe la période de la guerre à Paris et en relation avec les membres du FLN, dont certains sont venus en France comme étudiants. Sénac fait le lien entre eux et Camus qui lui aussi vit à Paris avec sa famille, travaillant pour les éditions Gallimard dont il est la vedette; mais chacun sait que cette liaison entre les deux hommes fut aussi intense que douloureuse, en raison de leurs différents politiques et des reproches virulents faits par Sénac à Camus de n’être pas indépendantiste. Les notes souvent très brèves recueillies dans ce journal intime atypique, spasmodique et déchirant, laissent certes beaucoup à deviner, mais elles en donnent les moyens. C’est d’ailleurs surtout après l’indépendance et le retour de Sénac à Alger que le sentiment de traverser avec lui des hauts et des bas est particulièrement perturbant. Les trois ou quatre premières années de l’indépendance sont sans doute la période la plus faste de sa vie et celle où il est le mieux intégré à une vie professionnelle et sociale, donnant la preuve qu’il est parfaitement capable d’occuper les fonctions qu’on lui confie lorsqu’elles lui agréent. Le moment où cet état bienheureux ou presque commence à se dégrader, malgré la discrétion dont ses notes font preuve, donne le sentiment que Sénac est alors un homme détruit et de plus en plus, qui marche vers sa propre fin de manière irréversible. Les mentions qu’il fait de ses occupations ou rencontres sont d’une sécheresse poignante, on dirait que le souffle de la vie s’est retiré de cet être qui fut si vibrant. Pour ne prendre qu’un exemple de ce que fut ce cheminement tragique, on peut comparer la ravissante écriture si soignée de ce que furent ses premières années d’adolescence (par exemple un « poème-prière » écrit de sa main en 1943, p.105) avec le terrible et sauvage graphisme, comme désarticulé, qui était finalement devenu le sien (p.795). Un homme broyé par la vie, cela semble un cliché, et pourtant…
C’est d’ailleurs surtout après l’indépendance et le retour de Sénac à Alger que le sentiment de traverser avec lui des hauts et des bas est particulièrement perturbant. Les trois ou quatre premières années de l’indépendance sont sans doute la période la plus faste de sa vie et celle où il est le mieux intégré à une vie professionnelle et sociale, donnant la preuve qu’il est parfaitement capable d’occuper les fonctions qu’on lui confie lorsqu’elles lui agréent. Le moment où cet état bienheureux ou presque commence à se dégrader, malgré la discrétion dont ses notes font preuve, donne le sentiment que Sénac est alors un homme détruit et de plus en plus, qui marche vers sa propre fin de manière irréversible. Les mentions qu’il fait de ses occupations ou rencontres sont d’une sécheresse poignante, on dirait que le souffle de la vie s’est retiré de cet être qui fut si vibrant. Pour ne prendre qu’un exemple de ce que fut ce cheminement tragique, on peut comparer la ravissante écriture si soignée de ce que furent ses premières années d’adolescence (par exemple un « poème-prière » écrit de sa main en 1943, p.105) avec le terrible et sauvage graphisme, comme désarticulé, qui était finalement devenu le sien (p.795). Un homme broyé par la vie, cela semble un cliché, et pourtant…
Denise Brahimi
« LES ROMANS ET LES NOUVELLES TARDIFS DE MOHAMED DIB OU LA THEATRALISATION DE LA PAROLE » par Charles Bonn, Honoré Champion, 2023
Il s’agit d’une réflexion personnelle inspirée à l’auteur par ses nombreux travaux universitaires sur le grand auteur algérien Mohammed Dib disparu en 2003, à l’âge de 83 ans. L’œuvre de cet écrivain est considérable, elle comporte principalement des romans mais aussi de la poésie, beaucoup de ses livres sont d’une lecture jugée difficile et il est évidemment très précieux d’être guidé pour l’aborder par un connaisseur éclairé, qui la fréquente de longue date. Tel est le cas de Charles Bonn qui a choisi cette fois d’analyser l’aspect le moins connu de l’auteur, ses textes narratifs tardifs, sans exclure pour autant de revenir à des œuvres plus anciennes, là où se trouve l’origine de certaines de ses thématiques.
Charles Bonn a réussi ce qui constitue un défi difficile pour les chercheurs, concilier la présentation thématique d’une œuvre littéraire dont le parcours est souvent fort complexe avec l’ordre chronologique de son écriture…ou de sa publication, ce qui n’est pas forcément la même chose. Ce type de travail implique évidemment une longue fréquentation de l’auteur et de l’œuvre. L’étude qu’il nous livre recoupe une période assez longue au cours de laquelle se succèdent de nombreuses œuvres, romans ou recueils de nouvelles et dont on peut fixer le début à 1977, date de publication du roman Habel. A l’autre extrémité du parcours, le critique va même au-delà de la mort de son auteur puisqu’il englobe dans ses investigations un recueil posthume paru en 2006, « Laëzza » ; voilà qui au total, représente une bonne douzaine de livres, pour ne pas reparler de quelques retours en arrière jusqu’en 1962, cette date n’étant d’ailleurs pas le début des publications de Mohammed Dib, qui avaient commencé dix ans plus tôt.
L’étude qu’il nous livre recoupe une période assez longue au cours de laquelle se succèdent de nombreuses œuvres, romans ou recueils de nouvelles et dont on peut fixer le début à 1977, date de publication du roman Habel. A l’autre extrémité du parcours, le critique va même au-delà de la mort de son auteur puisqu’il englobe dans ses investigations un recueil posthume paru en 2006, « Laëzza » ; voilà qui au total, représente une bonne douzaine de livres, pour ne pas reparler de quelques retours en arrière jusqu’en 1962, cette date n’étant d’ailleurs pas le début des publications de Mohammed Dib, qui avaient commencé dix ans plus tôt.
La difficulté des textes et des analyses qu’ils induisent est compensée par la très grande clarté de la présentation adoptée par Charles Bonn. Il la partage en 4 parties, qui sont thématiques, et dans chacune d’elles il examine un certain nombre de livres, revenant parfois et même souvent sur les mêmes mais pour les reprendre d’un point de vue à chaque fois différent. On est d’autant plus fermement guidé que le critique a d’emblée défini son objet et s’y tient continûment, usant de variations sur les formules qui sont les siennes et qui deviennent familières au lecteur même si elles lui paraissaient d’abord déroutantes (avant qu’il ne les ait si l’on ose dire apprivoisées !).
Il en va ainsi pour celle qui figure dans le titre du livre, une fois son contenu indiqué. « La théâtralisation de la parole » est effectivement une formule qui fait retour à de très nombreux moments, en sorte qu’elle ne peut faire l’objet, d’emblée, d’une seule et unique définition mais s’enrichit, tout au long de l’essai, de celles qui lui sont progressivement données au fil des chapitres et des œuvres commentées.
En fait, le mot employé par Charles Bonn a valeur d’une mise en garde, qui n’est ni partielle ni limitée dans le temps mais revient au contraire comme un leitmotiv absolu et constant.
Nous ne devons pas nous imaginer, même implicitement, que le récit de Dib consiste à recouvrir par des mots une réalité qui existerait en dehors de lui. Si réalité il y a, elle est d’une autre nature, qu’on ne saurait justement définir, et les mots ne nous y donnent pas accès. Chronologiquement, plus on avance dans l’œuvre de l’écrivain plus on se rend compte qu’il n’y a rien à découvrir derrière ou sous les mots, ceux-ci sont une sorte de monstration ou de projection (comme sur une scène de théâtre), mais ils ne peuvent dire autre chose sinon qu’il n’y a pas de sens à chercher et que nous sommes confrontés par eux à une seule chose, qui est l’absence de sens. Cette formule pourrait n’être qu’une sorte de jeu de mots, mais elle est en fait une vérité fondamentale, et les quatre parties de l’étude montrent en lui donnant à chaque fois des noms un peu différents que cette absence est le véritable moteur du récit. Charles Bonn met d’abord la théâtralisation en rapport avec « l’in-sensé » qu’il écrit de cette manière, en deux mots séparés, pour souligner les résultats négatifs de la quête du sens—dont Mohammed Dib n’ignore évidemment pas à quel point elle est spontanée, et pourtant vaine, chez ses lecteurs. Puis il substitue à l’in-sensé une autre catégorie ayant valeur de définition, c’est le « non-dit explicite », tout ce que l’auteur ne nous dit pas (quelle est par exemple l’identité du narrateur) et dont le manque joue pourtant un rôle actif dans notre lecture, en nous interdisant de croire que récit et réalité sont une seule et même chose. Pour la troisième partie de son essai, le chercheur utilise une expression, « la dissémination générique », qui lui permet d’aborder des textes vraiment tardifs, publiés autour de l’an 2000, où l’on peut constater que les genres littéraires sont pour le moins déstabilisés—d’autant qu’il s’agit souvent de nouvelles qui même lorsqu’elles sont regroupées sous le titre « roman » impliquent une recherche hasardeuse de tout ce qui pourrait constituer une unité relative du récit. Et finalement dans sa quatrième et dernière partie, Charles Bonn montre comment la mise en scène de la parole implique un en-deçà du langage, qu’il voit apparaître dès les romans plus anciens de Dib, ceux des années 60. L’absence de réponses et de repères dans les derniers textes renvoie plus que jamais au pouvoir de la parole, autre manière de dire que celle-ci ne peut être que « théâtralisée ». La quête toujours insatisfaite d’un sens est le moteur de notre lecture.
Charles Bonn met d’abord la théâtralisation en rapport avec « l’in-sensé » qu’il écrit de cette manière, en deux mots séparés, pour souligner les résultats négatifs de la quête du sens—dont Mohammed Dib n’ignore évidemment pas à quel point elle est spontanée, et pourtant vaine, chez ses lecteurs. Puis il substitue à l’in-sensé une autre catégorie ayant valeur de définition, c’est le « non-dit explicite », tout ce que l’auteur ne nous dit pas (quelle est par exemple l’identité du narrateur) et dont le manque joue pourtant un rôle actif dans notre lecture, en nous interdisant de croire que récit et réalité sont une seule et même chose. Pour la troisième partie de son essai, le chercheur utilise une expression, « la dissémination générique », qui lui permet d’aborder des textes vraiment tardifs, publiés autour de l’an 2000, où l’on peut constater que les genres littéraires sont pour le moins déstabilisés—d’autant qu’il s’agit souvent de nouvelles qui même lorsqu’elles sont regroupées sous le titre « roman » impliquent une recherche hasardeuse de tout ce qui pourrait constituer une unité relative du récit. Et finalement dans sa quatrième et dernière partie, Charles Bonn montre comment la mise en scène de la parole implique un en-deçà du langage, qu’il voit apparaître dès les romans plus anciens de Dib, ceux des années 60. L’absence de réponses et de repères dans les derniers textes renvoie plus que jamais au pouvoir de la parole, autre manière de dire que celle-ci ne peut être que « théâtralisée ». La quête toujours insatisfaite d’un sens est le moteur de notre lecture.
Denise Brahimi
» NANCY-KABYLIE « de Dorothée-Myriam Kellou, éditions Grasset, 2023
Cette auteure est déjà connue du public, notamment celui de Coup de soleil, pour avoir réalisé en 2019 un film intitulé « A Mansourah tu nous as séparés » où elle traitait déjà d’un sujet qu’elle reprend partiellement dans ce livre. Mansourah est un village algérien où est né Malek, père de Dorothée-Myriam. Il fait partie de ceux qui pendant la guerre d’Algérie ont été « resserrés », c’est à dire où leur population d’origine a dû faire de la place à celle des villages alentours vidés par l’armée française et transformés en camp de regroupement, dont le nom dit bien de quoi il s’agit. Le but de ce déplacement était de couper toute communication entre les populations rurales et les combattants algériens qui se cachaient alentour dans les maquis. Cependant, du même coup les paysans ont été privés de leurs ressources et de tout ce qui constituait leur environnement habituel, et sont devenus complètement dépendants des militaires qui assuraient la vie quotidienne dans les camps. Cette déstructuration des campagnes algériennes ne pouvait manquer d’avoir des conséquences graves, ce que l’auteure de ce livre essaie de comprendre et de mesurer en confrontant son père avec le souvenir des événements qu’il a alors subis, notamment sa fuite à la fin de la guerre avec sa famille. Dans la mémoire du père et pour sa fille, ce sont eux que désigne, globalement voire symboliquement, le mot « Mansourah ».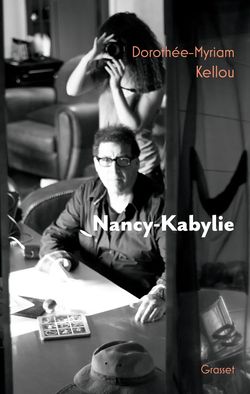 Dans « Nancy-Kabylie » ils gardent un rôle important, mais il y est question de beaucoup d’autres choses, souvenirs et réflexions, en sorte qu’il serait difficile de ranger le livre dans une catégorie clairement définie. Le meilleur moyen de le lire est de se laisser porter par l’auteure à travers une suite de petits chapitres nombreux mais courts qui lui sont l’occasion de pointer ce que rétrospectivement elle juge avoir été important pendant la quarantaine d’années ou presque qu’elle a maintenant vécues.
Dans « Nancy-Kabylie » ils gardent un rôle important, mais il y est question de beaucoup d’autres choses, souvenirs et réflexions, en sorte qu’il serait difficile de ranger le livre dans une catégorie clairement définie. Le meilleur moyen de le lire est de se laisser porter par l’auteure à travers une suite de petits chapitres nombreux mais courts qui lui sont l’occasion de pointer ce que rétrospectivement elle juge avoir été important pendant la quarantaine d’années ou presque qu’elle a maintenant vécues.
Ce sont des années qui ont été très bien remplies, on ne sait s’il faut dire dans l’ordre ou le désordre, avec de nombreux déplacements dans l’espace mais aussi une évidente continuité dans les recherches poursuivies par la narratrice (on ne sait si on peut aller jusqu’à dire « dans ses obsessions »).
S‘agissant de l’espace, le titre peut être mensonger si interprété trop étroitement. Ne dirait-on pas que sa vie a été partagée entre deux lieux, Nancy où elle a vécu en famille son enfance et son adolescence, et la Kabylie qui est le lieu du père, plus précisément Mansourah village de petite Kabylie —ce qu’il faut préciser car il y a d’autres lieux de ce nom en Algérie. En fait, le rappel de ces deux points qu’on peut dire opposés dans la mesure où ils n’ont rien de commun lui permet de définir une sorte d’axe que sans doute elle a gardé présent en elle mentalement, alors même qu’elle s’en écartait pour aller voir ailleurs et parfois y séjourner durablement : l’Egypte, la Palestine, les Etats-unis donnent lieu de sa part à des évocations précises et intéressantes (et par exemple celle des gens qu’elle y a rencontrés) qui n’ont rien à voir avec des journaux de voyage (même s’il en est qui ne sont pas touristiques au sens superficiel du mot).
Mais s’il est évident qu’il ne s’en dégage pas une impression de dispersion ou d’éparpillement géographique, c’est pour une raison bien claire et que l’auteure souligne elle-même : tout au long de ses déplacements, même si le mot « enquêtes » est trop réducteur ou trop journalistique pour les désigner, elle a toujours en tête une seule et même idée, qui est d’approfondir sa part algérienne et s’il se peut sa connaissance de l’arabe—même s’il s’agit dans chaque pays d’une version différente de cette langue.
Au total, on a l’impression qu’elle progresse et qu’elle réussit son imprégnation, mot plus juste dans son cas qu’intégration car sa recherche n’est pas identitaire au sens où elle chercherait un lieu unique lui fournissant sa propre définition. Sans doute n’a-t-elle pas ignoré cette tentation, ou la tentation de cette recherche, croyant fermement pendant toute une époque de sa vie que l’Algérie était le lieu où elle devait s’implanter. Bien qu’elle ne soit pas une spécialiste de l’auto-analyse, elle en dit assez pour qu’on croie comprendre ce qui s’est passé, à savoir qu’un moment est venu où elle s’est détachée de ce projet. Dans sa vie personnelle on peut trouver comme un indice préfigurant cette évolution : la rupture de sa relation amoureuse avec un ami algérien, malgré l’intensité et la qualité de leurs échanges. Mais l’Algérie elle-même en tant que pays est une autre explication de son retrait relatif, du fait qu’elle est devenue un pays post-Hirak où les espoirs liés à celui-ci ont été écrasés.
Bien qu’elle ne soit pas une spécialiste de l’auto-analyse, elle en dit assez pour qu’on croie comprendre ce qui s’est passé, à savoir qu’un moment est venu où elle s’est détachée de ce projet. Dans sa vie personnelle on peut trouver comme un indice préfigurant cette évolution : la rupture de sa relation amoureuse avec un ami algérien, malgré l’intensité et la qualité de leurs échanges. Mais l’Algérie elle-même en tant que pays est une autre explication de son retrait relatif, du fait qu’elle est devenue un pays post-Hirak où les espoirs liés à celui-ci ont été écrasés.
De « Nancy-Kabylie » on garde l’idée que cette première période de sa vie adulte a été principalement pour Dorothée-Myriam le moment de restaurer les liens compliqués de son père Malek, exilé en France, avec son algérianité. Il est probable que cette restauration lui était aussi nécessaire à elle-même, ce n’en est pas moins pour lui et avec lui qu’elle s’est adonnée à ce travail, avec une grande générosité. La mémoire n’est pas un long fleuve tranquille, où l’on se replonge à l’occasion. Elle est plutôt un immense combat à gagner contre l’oubli, volontaire ou pas, en s’appuyant sur les bribes du passé qui ont survécu à l’occultation. La récompense en est, dans le meilleur des cas, « des retrouvailles auxquelles on ne s’attendait pas ».
Et c’est aussi une libération car en disant l’histoire on se dégage de son poids.
Denise Brahimi
» BOURDIEU, UNE ENQUÊTE ALGERIENNE « d’Olivier Thomas et Pascal Génot éditions Steinkis 2023
Ce copieux roman graphique donne à voir et à vivre au lecteur la vie et le parcours d’un intellectuel qui s’engage progressivement. La part prise par son long séjour en Algérie dans la construction d’un sociologue majeur est au cœur de ce livre. Le scénariste, Pascal Génot, docteur en sciences de l’information, spécialiste de l’éducation aux images et aux médias, se met en scène, dans la découverte de l’Algérie à partir de 2011, et dans la découverte du rôle de l’Algérie dans la trajectoire de vie de Pierre Bourdieu.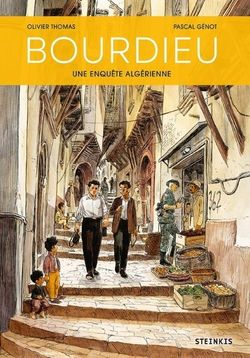 Le livre enchaîne sur la jeunesse et la formation de Pierre Bourdieu, de Pau à Paris. La description de cette trajectoire est dans le texte très sociologique, très « bourdieusienne » montrant les difficultés de l’ascension sociale, illustrée graphiquement par de multiples anecdotes qui donnent une saveur souvent souriante à cette description volontairement académique. C’est en cela que l’objet roman graphique, notamment quand il traite de sociologie, est un support remarquable. Surtout quand on a le plaisir d’y découvrir le dessin au trait, réaliste, d’Olivier Thomas.
Le livre enchaîne sur la jeunesse et la formation de Pierre Bourdieu, de Pau à Paris. La description de cette trajectoire est dans le texte très sociologique, très « bourdieusienne » montrant les difficultés de l’ascension sociale, illustrée graphiquement par de multiples anecdotes qui donnent une saveur souvent souriante à cette description volontairement académique. C’est en cela que l’objet roman graphique, notamment quand il traite de sociologie, est un support remarquable. Surtout quand on a le plaisir d’y découvrir le dessin au trait, réaliste, d’Olivier Thomas.
Citons une anecdote des compères de Louis le Grand, quand « Jackie » Derrida déclame à la demande de ses copains internes dont « Coyote » Bourdieu, un passage de la Parodie du Cid d’Edmond Brua : « qué rabia ! Qué malheur ! Pourquoi qu’on devient vieux ? » (lamentation de Dodièze, qui s’est « mangé » un coup de soufflet de Gongormatz). Premier contact avec l’Algérie et un de ses illustres enfants… La rue d’Ulm, dont ils réussissent le concours de philosophie les maintient dans les débats autour de l’Algérie, avec la fameuse controverse Sartre Camus, et le « fauteuil dans le sens de l’histoire ». Bourdieu, Derrida et Bianco refusent l’alignement au PCF et intègrent le comité d’action des intellectuels pour la défense des libertés. Agrégation de philosophie en poche, Bourdieu fait le choix d’aller enseigner à Moulins en 1954, puis est rattrapé par le service militaire au printemps 1956, en Algérie, début d’une nouvelle initiation… Ainsi évoquée par le scénariste :« Les années passées au-delà de la Méditerranée lui feront quitter les hauteurs de la philosophie pour les ravins de la sociologie, discipline méprisée, qu’il allait réinventer »… L’album donne à voir l’appel à la paix civile lancé en 1994 à la Sorbonne au nom du Comité international de soutien aux intellectuels algériens qu’il préside. Et ces mots qui résonnent étonnamment en cette période de nouvel affrontement en terre palestinienne « Nous savons qu’à l’origine de la tragédie, il y a toute la violence dont la nation française s’est rendue coupable, pendant plus de cent cinquante ans »… L’album entre alors dans le chapitre Algérie, entremêlant l’enquête de Pascal Génot, elle même illustrée d’observations sociologiques comme cette conversation avec le chibani rencontré dans l’avion « le mieux, c’est l’avion, là je suis chez moi ». Son ami algérien avec qui il va sur la tombe de Bourdieu au Père Lachaise lui fait promettre : « Faites moi plaisir, parlez de Sayad ! Bourdieu c’est bien mais sans Sayad il n’aurait pas compris grand’chose ». Le récit progresse ainsi, entrecoupant le « making of » du scénariste et de son enquête, les éléments d’histoire ou de biographie très précis sur Bourdieu et l’époque, et le dessin, illustratif et animant le récit. Bourdieu sur la base aérienne d’Orléansville, la désertion de l’aspirant Maillot dans le journal, qui vaut un dialogue avec son copain ouvrier communiste chez Renault où il lui explique les divergences entre PCF et PCA… Il aborde avec des intervenants algériens la controverse sur le passage du caporal Bourdieu au service de propagande du Gouvernement Général, qui l’a mis au saint des saints du pouvoir en Algérie. Aurait-il dû refuser, déserter ? S’esquisse un être humain, avec ses contradictions et sa complexité, que par exemple l’anthropologue Tassadit Yacine ou le sociologue Kamel Chachoua se refusent de juger. « La réputation, pour un intellectuel, c’est comme l’honneur pour les Kabyles : une question de vie ou de mort ». L’action psychologique qui déploie sa propagande dans les campagnes côtoyait la guerre psychologique, l’intoxication et la torture. Comment Bourdieu a-t-il vécu ces contradictions ? Probablement en travaillant en parallèle à une compréhension profonde de la société algérienne, par exemple avec la fréquentation d’André Nouschi, les livres de Raymond Aron (La tragédie algérienne), de Germaine Tillion (L’Algérie en 1957)… Et en conversant avec son ami Jacques Derrida, lui aussi bidasse en Algérie…
L’album entre alors dans le chapitre Algérie, entremêlant l’enquête de Pascal Génot, elle même illustrée d’observations sociologiques comme cette conversation avec le chibani rencontré dans l’avion « le mieux, c’est l’avion, là je suis chez moi ». Son ami algérien avec qui il va sur la tombe de Bourdieu au Père Lachaise lui fait promettre : « Faites moi plaisir, parlez de Sayad ! Bourdieu c’est bien mais sans Sayad il n’aurait pas compris grand’chose ». Le récit progresse ainsi, entrecoupant le « making of » du scénariste et de son enquête, les éléments d’histoire ou de biographie très précis sur Bourdieu et l’époque, et le dessin, illustratif et animant le récit. Bourdieu sur la base aérienne d’Orléansville, la désertion de l’aspirant Maillot dans le journal, qui vaut un dialogue avec son copain ouvrier communiste chez Renault où il lui explique les divergences entre PCF et PCA… Il aborde avec des intervenants algériens la controverse sur le passage du caporal Bourdieu au service de propagande du Gouvernement Général, qui l’a mis au saint des saints du pouvoir en Algérie. Aurait-il dû refuser, déserter ? S’esquisse un être humain, avec ses contradictions et sa complexité, que par exemple l’anthropologue Tassadit Yacine ou le sociologue Kamel Chachoua se refusent de juger. « La réputation, pour un intellectuel, c’est comme l’honneur pour les Kabyles : une question de vie ou de mort ». L’action psychologique qui déploie sa propagande dans les campagnes côtoyait la guerre psychologique, l’intoxication et la torture. Comment Bourdieu a-t-il vécu ces contradictions ? Probablement en travaillant en parallèle à une compréhension profonde de la société algérienne, par exemple avec la fréquentation d’André Nouschi, les livres de Raymond Aron (La tragédie algérienne), de Germaine Tillion (L’Algérie en 1957)… Et en conversant avec son ami Jacques Derrida, lui aussi bidasse en Algérie…
Pour aider l’Algérie sans s’engager pour autant, Bourdieu abandonne son projet de thèse inspiré par son mentor Georges Canghilem, pour enseigner la sociologie à la faculté d’Alger. Avec pour seul premier bagage sociologique l’écriture d’un Que sais-je « sociologie de l’Algérie ». Petit ouvrage mais où il analyse, dans l’incompréhension de la société coloniale de 1958 la diversité des strates du peuple algérien en même temps qu’un fonds commun religieux et anthropologique. Le livre nous livre quelques contenus des cours de Bourdieu, notamment ses citations de l’anthropologue américaine Ruth Benedict sur la Shame culture et la Guilt culture. Parmi ses étudiants, Fanny Colonna, Alain Accardo et le plus proche, Abdelmalek Sayad, dont l’album décrit la trajectoire. Superbes images des errances de Bourdieu dans les quartiers d’Alger, en observation de manifestations riches d’enseignements sociologiques. On le voit aussi rencontrer Mouloud Ferraoun dont Pascal Génot questionne les enfants notamment Faiza qui a soutenu sa thèse de sociologie avec Pierre Bourdieu et qui raconte son enseignement, la trace, même datée, de ses textes sur la société algérienne, et aussi sa méthode.
En 1960 Bourdieu rentre à Paris où il enseigne à la Sorbonne, et où Raymond Aron lui confie la création d’un nouveau centre de recherches en sciences sociales, logé comme il se doit dans la maison d’Auguste Comte.
Ceci nous vaut quelques pages sur l’histoire de la sociologie puis sur l’apport conceptuel de Bourdieu à cette discipline. Les champs de force et de lutte, le capital et l’habitus sont décrits très pédagogiquement, donnant à ce livre une valeur d’information en profondeur. Il montre comment Bourdieu s’empare et associe des concepts créés par d’autres, Marx, Durkheim…
Mais il n’abandonne pas l’Algérie, et suit de près les enquêtes de terrain menées par Sayad, auxquelles il vient participer dès que possible. L’auteur fait parler plusieurs universitaires algériens pour décrire l’apport de Bourdieu en Algérie, Saïd Belguidoum, qui décortique le phénomène massif d’urbanisation en Algérie, Kamel Chachoua, Nadji Safir, Mohand Akli Hadibi, mais aussi les enquêtés eux-mêmes, remarquablement dessinés par  Olivier Thomas. Les dialogues entre Bourdieu et Sayad autour de ces enquêtes donnent une analyse fouillée du fonctionnement de la société algérienne en 1960. Les conversations avec tous ces sociologues, qui utilisent les outils de Bourdieu pour décrire la société algérienne d’aujourd’hui mais aussi les conversations avec d’autres acteurs, les chants des clubs de football, les scènes silencieuses de déambulation dans l’Algérois donnent au lecteur une vision du pays telle que peut-être Bourdieu aurait su la faire émerger. Ainsi le succulent dialogue avec la chorégraphe et metteuse en scène Aicha à l’hôtel El Aurassi…
Olivier Thomas. Les dialogues entre Bourdieu et Sayad autour de ces enquêtes donnent une analyse fouillée du fonctionnement de la société algérienne en 1960. Les conversations avec tous ces sociologues, qui utilisent les outils de Bourdieu pour décrire la société algérienne d’aujourd’hui mais aussi les conversations avec d’autres acteurs, les chants des clubs de football, les scènes silencieuses de déambulation dans l’Algérois donnent au lecteur une vision du pays telle que peut-être Bourdieu aurait su la faire émerger. Ainsi le succulent dialogue avec la chorégraphe et metteuse en scène Aicha à l’hôtel El Aurassi…
Le dernier chapitre concerne les travaux de Bourdieu et Sayad sur les camps de regroupement, principalement dans la région de Collo. Pascal génot et son guide algérien viennent à l’improviste visiter les lieux où les jeunes du coin leur montrent les photos des camps prises à l’époque par Bourdieu, et trouvées sur internet.
Sont évoquées dans se chapitre les convergences avec le Fanon de L’an 5 de la révolution algérienne, puis les lourdes critiques au Fanon des Damnés de la terre, et à son préfacier Jean-Paul Sartre.
Puis c’est le retour de l’auteur en France où émeutes de gilets jaunes et autres mouvements sociaux sont évoqués, toujours dans une approche bourdieusienne, dans sa dernière époque d’analyse et de démontage de l’emprise du capitalisme sur la société. L’auteur met en parallèle la situation des dirigeants de France et d’Algérie, à la faible légitimité populaire, qui imposent d’autant plus durement des choix que refuse le peuple. Mais selon lui la France illustre davantage le lien entre hausse de la précarité sociale et désaffection politique.
« La liberté n’est pas un donné, mais une conquête, et collective » fait il dire à Bourdieu pour conclure son livre, précédant les dernières images, le tournage d’un film de la chorégraphe Aicha Rahal.
Un livre sur l’Algérie d’hier et d’aujourd’hui, sur la sociologie et l’apport de Bourdieu, largement inspiré par l’Algérie. Riche, beau et nourrissant.
Michel Wilson

« ABDELINHO » film de Hicham Ayouch, Maroc, 2022
Même s’il peut paraître bizarre de commencer par la fin, on ne peut que recommander aux spectateurs de ce film de bien écouter —ne serait-ce d’ailleurs que pour leur plaisir, car Hicham Ayouch le réalisateur est aussi un bon acteur— l’interview fictive qu’il est supposé donner à un journaliste, alors qu’il joue lui-même les deux rôles. Bien que le film ne soit pas difficile à comprendre , et même parfaitement clair sur le fond, ce sont toutes les drôleries, fantaisies et gambades qu’il nous encourage à apprécier pleinement, alors que nous sommes peut-être, parfois, engoncés dans l’esprit de sérieux dès qu’il s’agit d’islam et d’islamisme, sujets qu’on pourrait dire interdits de plaisanterie—ce qui est toujours un signe grave pour la société dans laquelle il en est ainsi.
 Rassurons-nous donc et laissons-nous aller à notre plaisir, Hicham Ayouch n’est nullement coincé par l’immense sujet que son film aborde en réalité, et qui n’est pas moins que la défense du plaisir et de la joie de vivre contre les prêcheurs d’austérité, charlatans hypocrites qui se cachent derrière des prétextes religieux. Le réalisateur a beau expliquer que ce genre de sinistre individu existe partout et que toutes les religions sont utilisées par eux à titre de paravent, pour cacher leur volonté d’exploiter un peuple trop crédule, c’est bel et bien d’un télévangéliste intégriste musulman qu’il s’agit dans le film en la personne d’un certain Amr Taleb, pour la bonne et simple raison que l’histoire se passe au Maroc, le film ayant été tourné à Azemmour, petite ville parmi d’autres sans doute, ici prise pour exemple. L’aspect sociologique est indiqué mais il est loin d’écraser la fantaisie de cette histoire loufoque et singulière qui nous est ici contée. A signaler, comme exemplaire de la façon volontairement comique dont procède le réalisateur, la brochette de « Hittistes » figée contre le mur par une immobilité qui est déjà presque la mort : de temps en temps, le dernier du banc s’effondre et « l’ambulance des chômeurs » passe le ramasser pour le conduire à l’hôpital …ou à la morgue : traitement dans le style BD ou souvenir du grand cinéma burlesque aux beaux jours du muet mais en tout cas affirmation qu’on peut rire de tout pour reprendre une problématique sous-jacente à notre époque.
Rassurons-nous donc et laissons-nous aller à notre plaisir, Hicham Ayouch n’est nullement coincé par l’immense sujet que son film aborde en réalité, et qui n’est pas moins que la défense du plaisir et de la joie de vivre contre les prêcheurs d’austérité, charlatans hypocrites qui se cachent derrière des prétextes religieux. Le réalisateur a beau expliquer que ce genre de sinistre individu existe partout et que toutes les religions sont utilisées par eux à titre de paravent, pour cacher leur volonté d’exploiter un peuple trop crédule, c’est bel et bien d’un télévangéliste intégriste musulman qu’il s’agit dans le film en la personne d’un certain Amr Taleb, pour la bonne et simple raison que l’histoire se passe au Maroc, le film ayant été tourné à Azemmour, petite ville parmi d’autres sans doute, ici prise pour exemple. L’aspect sociologique est indiqué mais il est loin d’écraser la fantaisie de cette histoire loufoque et singulière qui nous est ici contée. A signaler, comme exemplaire de la façon volontairement comique dont procède le réalisateur, la brochette de « Hittistes » figée contre le mur par une immobilité qui est déjà presque la mort : de temps en temps, le dernier du banc s’effondre et « l’ambulance des chômeurs » passe le ramasser pour le conduire à l’hôpital …ou à la morgue : traitement dans le style BD ou souvenir du grand cinéma burlesque aux beaux jours du muet mais en tout cas affirmation qu’on peut rire de tout pour reprendre une problématique sous-jacente à notre époque. Donc Hicham Ayouch a pris le parti d’en rire mais surtout il s’est donné les moyens d’entraîner avec lui toute une partie du public qui ne demande qu’à aimer la vie et ce qu’elle comporte de meilleur, c’est-à-dire l’amour. Le moins qu’on puisse dire, c’est que dans le partage du monde entre le bien et le mal, il ne cherche pas de complication. Nous sommes dans un conte et nous souhaitons de tout notre cœur que les bons, les gentils et les innocents, comme Abdelinho lui-même soient finalement les gagnants dans l’affrontement qui leur est imposé par les méchants, représentés par le misérable Amr Taleb, jouant de l’obscurantisme très répandu, des névroses qui ne sont pas rares non plus (Ah ! ces mères qui ne peuvent pas vivre tant que leur fils n’est pas marié) et des traditions qui sont supposées indispensables pour structurer la vie sociale. Mais la grande force du film est de tenir très rarement ce discours en tant que tel et pour cela de ne pas tenir de discours du tout. Bien plus convaincante en effet est l’exubérance joyeuse de ceux et celles qui avec l’aide d’Abdelinho s’exercent à danser la samba, une des formes que prend son amour délirant du Brésil (dont la modification de son prénom n’est qu’un indice parmi d’autres). Cet amour est un des fils conducteurs du film, en même temps qu’un hommage à l’Amérique latine où l’imaginaire, prenant la forme de ce qu’on appelle « le réalisme magique », transcende la misère grâce à la puissance de l’imaginaire poétique.
Donc Hicham Ayouch a pris le parti d’en rire mais surtout il s’est donné les moyens d’entraîner avec lui toute une partie du public qui ne demande qu’à aimer la vie et ce qu’elle comporte de meilleur, c’est-à-dire l’amour. Le moins qu’on puisse dire, c’est que dans le partage du monde entre le bien et le mal, il ne cherche pas de complication. Nous sommes dans un conte et nous souhaitons de tout notre cœur que les bons, les gentils et les innocents, comme Abdelinho lui-même soient finalement les gagnants dans l’affrontement qui leur est imposé par les méchants, représentés par le misérable Amr Taleb, jouant de l’obscurantisme très répandu, des névroses qui ne sont pas rares non plus (Ah ! ces mères qui ne peuvent pas vivre tant que leur fils n’est pas marié) et des traditions qui sont supposées indispensables pour structurer la vie sociale. Mais la grande force du film est de tenir très rarement ce discours en tant que tel et pour cela de ne pas tenir de discours du tout. Bien plus convaincante en effet est l’exubérance joyeuse de ceux et celles qui avec l’aide d’Abdelinho s’exercent à danser la samba, une des formes que prend son amour délirant du Brésil (dont la modification de son prénom n’est qu’un indice parmi d’autres). Cet amour est un des fils conducteurs du film, en même temps qu’un hommage à l’Amérique latine où l’imaginaire, prenant la forme de ce qu’on appelle « le réalisme magique », transcende la misère grâce à la puissance de l’imaginaire poétique.
L’imaginaire et le choix du rêve sont en effet ce qui caractérise Abdleinho poussé à ce choix grâce à son engouement pour une télénovella appelée « Maria » comme son principal personnage féminin : drame débordant de bons sentiments et susceptible de pulvériser les obstacles que la société pourrait leur opposer. Pour Maria, Abdelinho ne cesse de déclarer son amour (au grand dam de sa mère qui comme on dit lui « joue le grand jeu »). Cet amour réciproque ne peut manquer d’être un jour couronné, n’importe que ce soit « en vrai » ou en restant dans la fiction télévisuelle, puisque le conte est justement le genre qui abolit cette distinction. Abdelinho, les yeux rieurs et la perruque bouclée, a reçu en partage la grâce qui habituellement est celle de l’enfance, croire à la vérité du conte ; c’est pourquoi son histoire finit comme dans le fameux épilogue de ce genre littéraire : ils furent très heureux et eurent beaucoup d’enfants. Et en plus, la pulpeuse actrice brésilienne aux attraits époustouflants semble avoir très bien appris à faire le couscous, ce qui ne saurait nuire. En tout cas, à la fin du conte, les fameux obstacles inévitables semblent bel et bien avoir été surmontés.
Hichem Ayouch a pris délibérément un parti opposé à celui qui domine dans un certain cinéma marocain, celui d’un réalisme hélas non magique qui nous montre les tares les plus déplorables de cette société. Son parti-pris n’est pas celui d’une dénonciation même si on voit bien ici ou là qu’il n’ignore rien de ce que pourrait être celle-ci, ô combien légitimement. Mais ce n’est pas suffisant pour priver tout un peuple de rêve et d’imagination.
Denise Brahimi
« L’AIR DE LA MER REND LIBRE », film de Nadir Moknèche 2023

Nadir Mokneche, nadir-mokneche-photo-karl-colonnier
Nadir Moknèche n’est plus un débutant, il va vers la soixantaine et s’est fait connaître depuis au moins deux décennies par une bonne demi-douzaine de films. Ils sont tous remarquables par des qualités qu’on pourrait certes détailler mais dont l’effet global est qu’on éprouve un très grand plaisir à les regarder—faut-il dire à regarder les acteurs par lesquels ses personnages sont incarnés ? Oui sans doute, et une fois encore dans ce dernier film où sans la moindre recherche de vedettariat, les deux personnages principaux, Saïd et Hadjira, s’imposent à notre admiration par leur finesse et leur originalité. La direction d’acteurs est sans doute un des plus grands talents de Nadir Moknèche, on a l’impression que le souci principal de ces deux-là est vraiment d’entrer dans les intentions de leur metteur en scène., en déjouant tout risque de facilité.
Celle-ci était à craindre en effet, (si ce n’est que Nadir Moknèche nous a habitués à lui faire confiance), du fait que le mariage arrangé d’une part et le secret jalousement gardé autour de l’homosexualité masculine d’autre part sont des traits typiques de la société maghrébine très souvent dénoncés aujourd’hui et connus, si l’on ose dire, même des Français moyens. Encore faut-il qu’on sache les y intéresser, et c’est ce qui se passe dans le film de Nadir Moknèche. Nous sommes dans une ville de province moyenne à tous égards, ici Rennes, et la famille d’origine algérienne qui nous est montrée pratique ce mélange typique d’intégration à maints égards et de traditions éparses ostensiblement maintenues auquel tout le monde est maintenant habitué. Telle qu’en elle-même, c’est la société française d’aujourd’hui … et pourtant à y regarder de plus près, on y trouve encore des faits et des gens susceptibles de nous étonner.
Certes, cette histoire ne se passe guère que dans l’intimité mais c’est l’occasion de comprendre que de cette intimité justement peuvent sortir les plus grands mouvements de société. Donc Saïd est un garçon homosexuel prêt à toutes les aventures auxquelles le pousse ce goût particulier mais aussi amoureux (et réciproquement) d’un garçon appelé Vincent musicien de jazz de son état. Il est harcelé par sa mère qui juge indispensable de le marier dans les plus brefs délais (aurait-elle deviné quelque chose, la fine mouche ?). En tout cas, lorsque l’histoire commence, Saïd est à mille lieues de pouvoir avouer qu’il est gay à qui que ce soit, et l’un des enjeux du film sera de l’amener à le faire finalement. Il est peut-être plus bisexuel qu’il ne croit mais lorsqu’il clamera qu’il est gay, ce sera sans réserve, comme on se jette à l’eau, en une seule fois. Reste que peu à peu et surtout vers la fin, on a l’impression qu’il devient amoureux de sa femme Hadjira, ce qui a le mérite d’éviter les situations binaires et sans nuance ; et pour le dire en termes très simples mais pourtant vrais, même les spectateurs les moins concernés par le sujet finissent par se dire qu’il faudrait sans doute y regarder à deux fois.
 Pour ce qui est d’Hadjira elle-même, on ne peut savoir si elle a deviné la vérité, faute de savoir ce que sont les connaissances de cette jeune femme en matière de sexualité, mais de toute façon on croit comprendre que l’essentiel pour elle n’est pas de savoir si oui ou non Saïd est ou n’est pas ce qu’il ne veut pas dire de toute façon ; de manière bien intéressante, ce qu’elle veut essentiellement est qu’il lui parle, qu’il lui dise ce qu’il en est avec ses mots à lui, sa bouche à lui, alors que pendant la plus grande partie du film il ne parvient pas à lui confier quoi que ce soit, à peine un minuscule aveu ne concernant que son infidélité. Et l’on comprend grâce à elle (qu’on aurait tort de juger enfermée dans son hijab et ses dévotions) l’importance finalement secondaire de ce qui est pourtant l’objet d’une curiosité obsédante pour beaucoup de gens, l’orientation sexuelle des autres en général et d’eux-mêmes en particulier.
Pour ce qui est d’Hadjira elle-même, on ne peut savoir si elle a deviné la vérité, faute de savoir ce que sont les connaissances de cette jeune femme en matière de sexualité, mais de toute façon on croit comprendre que l’essentiel pour elle n’est pas de savoir si oui ou non Saïd est ou n’est pas ce qu’il ne veut pas dire de toute façon ; de manière bien intéressante, ce qu’elle veut essentiellement est qu’il lui parle, qu’il lui dise ce qu’il en est avec ses mots à lui, sa bouche à lui, alors que pendant la plus grande partie du film il ne parvient pas à lui confier quoi que ce soit, à peine un minuscule aveu ne concernant que son infidélité. Et l’on comprend grâce à elle (qu’on aurait tort de juger enfermée dans son hijab et ses dévotions) l’importance finalement secondaire de ce qui est pourtant l’objet d’une curiosité obsédante pour beaucoup de gens, l’orientation sexuelle des autres en général et d’eux-mêmes en particulier.
La promenade à la mer de Saïd et d’Hadjira réconciliés montre à quel point la relation de couple peut être une ressource inépuisable de sentiments à partir du moment où on échappe à cette obsession. Parvenir à s’en libérer est justement conquérir la liberté dont il est question dans le titre du film : mot-clef, simple et lumineux, qui n’avait pas été exprimé auparavant. Cette libération aussi est un enjeu du film, ou plutôt c’est toujours du même qu’il s’agit car la liberté de dire ou de ne pas dire dont ne dispose pas Saïd, le jeune marié-malgré-lui, n’est qu’une facette, à l’échelon individuel, de cette liberté immense, à la fois ouverte et secrète, dont la mer est une magnifique image. C’est la liberté d’être ou ne pas être défini par une seule catégorie comme le voudrait pourtant la société par souci d’une organisation claire et d’un ordre immuable.
Vincent l’ami musicien a sans doute eu, grâce à la musique, la possibilité d’accéder à un certain sens de la liberté, absent au contraire de la boucherie familiale où Saïd vit enfermé. Heureux ceux et celles que la musique ou la mer ont aidé(e)s dans leur difficile cheminement. Saïd aura dû vivre le sien sans adjudant, on peut en conclure, en partageant un certain optimisme du film, qu’il sera un père particulièrement vigilant quand sera mise en cause la liberté de son enfant !
Denise Brahimi
« DE LA CONQUÊTE », film documentaire réalisé par Franssou Prenant, 2022 (sortie 2023)
Il s’agit évidemment de la conquête de l’Algérie et le regard de la réalisatrice s’est fixé sur la première période des 130 ans pendant lesquels a duré la colonisation. Les nombreux textes que le film donne à entendre concernent tous la période 1830-1848, ils ont été le plus souvent écrits par des personnages marquants de cette époque et nous sont donnés à entendre par Franssou Prenant sans autre commentaire car ils n’en ont en effet aucun besoin, leur sens général étant parfaitement clair. Cependant il n’est pas suffisant de dire que globalement ils dénoncent et condamnent l’entreprise coloniale, d’autant que cette condamnation est devenue un leit-motiv de toute une part de la pensée contemporaine et post-coloniale. Ce qui est le plus intéressant et sans doute aussi le plus sidérant dans les textes très nombreux que la réalisatrice a su retrouver et reproduire, c’est que d’une part ils sont le fait de Français manifestement très mal à l’aise de se trouver associés du fait de leur nationalité, à une entreprise qu’ils jugent calamiteuse ; et c’est que d’autre part ce qui les atterre dans cette affaire est l’évidente incompétence de ceux qui la mettent en œuvre. Avant même de passer au jugement moral sur la barbarie de certains comportements (nombreux hélas) que s’autorisent les conquérants, il est facile semble-t-il de faire le constat que ceux-ci sont non seulement inutiles mais nuisibles et se retournent contre ceux qui les commettent. A cette époque des débuts, la plus grande partie du fait colonial est encore la conquête à proprement parler, elle est le fait des militaires qui sont chargés de détruire et non de construire, et si jamais cette dernière question est abordée, la réponse est évidente, le seul modèle envisageable pour la reconstruction est un modèle à 100% français : il doit l’être non seulement explicitement, mais même pourrait-on dire ostensiblement,
A cette époque des débuts, la plus grande partie du fait colonial est encore la conquête à proprement parler, elle est le fait des militaires qui sont chargés de détruire et non de construire, et si jamais cette dernière question est abordée, la réponse est évidente, le seul modèle envisageable pour la reconstruction est un modèle à 100% français : il doit l’être non seulement explicitement, mais même pourrait-on dire ostensiblement,
Avec une sorte de contradiction propre au colonisateur qui consiste à la fois à nier l’existence sur le terrain de tout ce qui aurait pu exister avant lui, et à faire preuve d’un grand acharnement pour en éliminer les traces.
Pour s’en tenir à la ville d’Alger qui pour des raisons claires est à cette époque la seule assez bien connue, il est évident que son fonctionnement est fondé sur des siècles pendant lesquels il a été tenu compte de données multiples et variées, utilisant à la fois l’expérience transmise par la tradition et un ensemble d’observations quotidiennement renouvelées, aussi bien par la sagacité populaire que par des experts et des savants.
Or tout se passe comme si les nouveaux conquérants ne voulaient même pas soupçonner l’existence de ce fonds très précieux qui pourtant n’aurait pas manqué de leur être utile, voire indispensable. Obnubilés par l’idée que leur installation impliquait au préalable une véritable table rase, ils ont détruit sans réserve et sans précaution, se privant eux-mêmes de ce qui allait cruellement leur manquer, et qu’on peut désigner dans les termes les plus simples comme la connaissance du pays.
 Le texte ainsi composé par les commentateurs appelés à la rescousse par Franssou Prenant est une partie importante du film d’autant plus remarquable que certains d’entre eux sont des découvertes. Cependant c’est du côté des images montrées que la réalisatrice se montre particulièrement inventive, et le travail qu’elle a accompli pour le film s’avère d’une grande complexité. On ne pouvait que se poser la question : quelles images, et où les trouver, seraient susceptibles d’accompagner les textes concernant la conquête sur lesquelles le film s’appuie ? Il n’y a évidemment aucun film d’époque(!) et si peu d’iconographie que s’il n’est possible de pas la rechercher dans un livre, elle sera à peine perceptible dans un film. Le parti-pris adopté par la réalisatrice est de montrer des images plus ou moins actuelles, d’où se dégage en tout cas le sentiment qu’on est dans l’Alger d‘aujourd’hui, et vivante ô combien. Tous ces gens dont la disparition était si ardemment souhaitée au moment de la conquête sont encore là et plus que jamais si l’on peut dire alors que de leurs prétendus exterminateurs il n’est autant dire plus question, sinon pour tel ou tel de leurs propos encore capable de susciter notre consternation.
Le texte ainsi composé par les commentateurs appelés à la rescousse par Franssou Prenant est une partie importante du film d’autant plus remarquable que certains d’entre eux sont des découvertes. Cependant c’est du côté des images montrées que la réalisatrice se montre particulièrement inventive, et le travail qu’elle a accompli pour le film s’avère d’une grande complexité. On ne pouvait que se poser la question : quelles images, et où les trouver, seraient susceptibles d’accompagner les textes concernant la conquête sur lesquelles le film s’appuie ? Il n’y a évidemment aucun film d’époque(!) et si peu d’iconographie que s’il n’est possible de pas la rechercher dans un livre, elle sera à peine perceptible dans un film. Le parti-pris adopté par la réalisatrice est de montrer des images plus ou moins actuelles, d’où se dégage en tout cas le sentiment qu’on est dans l’Alger d‘aujourd’hui, et vivante ô combien. Tous ces gens dont la disparition était si ardemment souhaitée au moment de la conquête sont encore là et plus que jamais si l’on peut dire alors que de leurs prétendus exterminateurs il n’est autant dire plus question, sinon pour tel ou tel de leurs propos encore capable de susciter notre consternation.
Il n’est pas étonnant qu’une bonne part des Algériens ou plutôt Algérois qu’on voit sur les images du film soient des adolescents : c’est la vérité sociologique la plus frappante concernant cette si jeune population. Ils se pressent sous nos yeux qui regardent le film mais Franssou Prenant se garde bien de les faire parler ou de commenter leur présence. A chacun d’ajouter aux images ses réflexions personnelles et intimes à partir d’une évidence extrêmement forte et qui nous submerge : dans cette ville la vie déborde de partout comme une sorte de négation ironique de ce qui a été chez les conquérants une volonté d’extermination. A quoi bon tant de crimes, tant de sang versé, tant d’horreurs ? Encore une fois et plus que jamais ce qu’il en reste est le sentiment de leur inefficacité. Physiquement et sans aller chercher plus loin (ni dans l’histoire ni dans la philosophie), on peut penser que certaines tentatives historiques sont vouées à l’échec, même s’il y faut le temps : l’aveuglement, le déni, quoi d ‘autre encore, cherchez où était l’erreur, tout cela est possible mais rien ne remplace incontestablement, un regard sur l’Alger d’aujourd’hui.
Denise Brahimi
Peut-on ajouter que voir ce film en un temps où une autre colonisation conduit à des drames similaires est troublant et fait penser à une malheureuse continuité des comportements humains ? Voir l’humain dont on prend la terre et dénie les droits comme un non-humain… Comment qualifiera t on dans un siècle la « civilisation » dans laquelle nous prétendons vivre ?
Michel Wilson
Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.
 – Utiles
– Utiles
de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun
Cliquez ici pour voir le film et le mot de passe utilesjoussour

–Entre nos mains
de Leila Saadna
Cliquez ici pour voir le film, puis mot de passe utilesjoussour
Et sa bande-annonce, cliquez ici

NOTES DE PRESENTATION
« MEMOIRE POUR L’EGALITE ET LA JUSTICE » ed. Au nom de la mémoire 2023
En cette année 2023, on commémore le 40e anniversaire de La Marche pour l’égalité des droits et contre le racisme (1983-2023). Un album de photos a été publié à cette occasion, plus de la moitié en est constituée de photos en noir et blanc qui sont des clichés de l’époque, pris au long de l’itinéraire de la Marche, sur le parcours Marseille-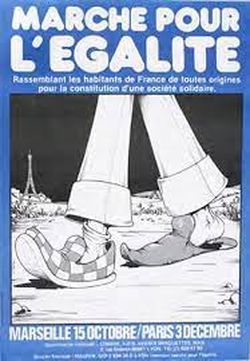 Lyon-Paris. Mais ces photos, qu’on ne se lasse pas de regarder, sont aussi encadrées par un texte substantiel à deux voix, celles de Samia Messaoudi et de Mehdi Lallaoui qui ont été de toutes les marches dans les années 80 et sont aujourd’hui des responsables associatifs qui continuent à travailler pour les mêmes causes. Cependant leur texte va au-delà de la stricte évocation des marches et ils ont recueilli beaucoup de réflexions et de témoignages, au nombre desquels ceux de Christian Delorme, prêtre catholique du diocèse de Lyon parfois appelé « le curé des Minguettes» (quartier de Vénissieux), et initiateur de la marche dont il a d’ailleurs tiré un ouvrage intitulé « La Marche » (Bayard 2013).
Lyon-Paris. Mais ces photos, qu’on ne se lasse pas de regarder, sont aussi encadrées par un texte substantiel à deux voix, celles de Samia Messaoudi et de Mehdi Lallaoui qui ont été de toutes les marches dans les années 80 et sont aujourd’hui des responsables associatifs qui continuent à travailler pour les mêmes causes. Cependant leur texte va au-delà de la stricte évocation des marches et ils ont recueilli beaucoup de réflexions et de témoignages, au nombre desquels ceux de Christian Delorme, prêtre catholique du diocèse de Lyon parfois appelé « le curé des Minguettes» (quartier de Vénissieux), et initiateur de la marche dont il a d’ailleurs tiré un ouvrage intitulé « La Marche » (Bayard 2013).
La preuve que les préoccupations voire les urgences de l’époque sont encore celles d’aujourd’hui se trouve dans une annexe du livre qui, à l’occasion de ce 40e anniversaire, publie une liste réactualisée en 2023 des « Trente revendications du collectif national « Egalité des droits-Justice pour tous ». Il y a aussi à la fin de l’album un livret de 16 photos en couleurs rappelant les combats pour l’égalité menés avant, pendant et après les marches , de 1973 à 2023. Pour cette dernière année, la photo reproduit l’appel à une manifestation du 25 mars, « Contre le racisme et la loi Darmanin ».
Un colloque qui s’est tenu à Lyon le 30 septembre 2023 posait aux participants la question suivante : « En quoi la transmission de la mémoire de la Marche peut-elle nourrir mes engagements d’aujourd’hui ? »
Denise Brahimi
« ASSIA DJEBAR, FEMME ECRIVANT » par Maïssa Bey, éditions Chèvre-feuille étoilée, 2023
Ce petit livre (70 pages environ) est d‘abord un hommage rendu par son auteure à une autre femme écrivaine qu’elle considère comme son initiatrice, et sans l’exemple de laquelle elle pense qu’elle n’aurait peut-être pas écrit. Assia Djebar n’est pas pour elle une image de mère, sans doute parce que l’écart d’âge qui les sépare n’est pas suffisant pour cela, l’une étant née en 1936 et l’autre en 1950. Mais surtout, l’une et l’autre étant des femmes qui ont voulu élargir la définition du genre féminin en Algérie, il n’était pas conforme à leur projet de rabattre toute relation sur la dimension familiale et c’est bien évidemment sur autre chose que porte l’hommage rendu par Maïssa Bey à son aînée. Assia Djebar commence à écrire avec la guerre d’Algérie à laquelle elle a voulu participer alors qu’elle était encore une jeune femme en sorte qu’elle a vécu en même temps deux formes d’émancipation, en étant de celles qui d’une part participent à l’histoire et qui d’autre part entrent en littérature, partiellement pour la raconter mais pour bien d’autres raisons aussi. Par cette double action, elle assume un statut très rare à son époque voire rarissime, qui l’isole de sa société et l’enferme dans une certaine solitude par rapport aux femmes algériennes pour lesquelles elle éprouve cependant une immense empathie. C’est une sorte de contradiction tragique qui pèsera sur toute sa vie.
Assia Djebar commence à écrire avec la guerre d’Algérie à laquelle elle a voulu participer alors qu’elle était encore une jeune femme en sorte qu’elle a vécu en même temps deux formes d’émancipation, en étant de celles qui d’une part participent à l’histoire et qui d’autre part entrent en littérature, partiellement pour la raconter mais pour bien d’autres raisons aussi. Par cette double action, elle assume un statut très rare à son époque voire rarissime, qui l’isole de sa société et l’enferme dans une certaine solitude par rapport aux femmes algériennes pour lesquelles elle éprouve cependant une immense empathie. C’est une sorte de contradiction tragique qui pèsera sur toute sa vie.
Maïssa Bey n’a que 12 ans lorsque l’Algérie devient indépendante ce qui évidemment ne lui permet pas encore d’accéder à l’écriture (même si elle est déjà une grande lectrice) alors que la guerre qui enfin s’achève lui laisse une marque indélébile, la mort de son père combattant algérien contre l’armée française. Elle devient adulte dans un pays parti à la recherche de lui-même et de son identité occultée par la colonisation, ce qui entraîne inévitablement un certain retour à des traditions dont les plus connues concernent les femmes et leur enfermement. Lutter contre celui-ci est donc un combat dont elle va assez vite et inlassablement faire le sien. Et c’est pour défendre cette cause qu’elle écrit livre après livre, pratiquant le féminisme aussi bien en tant qu’écrivaine que dans les activités de sa vie quotidienne, aux côtés d’autres femmes dont elle partage ou même organise les combats. Ce sont des femmes dont elle est très proche, on se rend compte à lire « Assia Djebar femme écrivant … » qu’elle les connaît de manière tout à fait concrète. Son féminisme vient de là et il est important pour elle de l’installer si l’on peut dire dans son cadre géographique et physique, celui de la maison dans laquelle les femmes vivent enfermées : rien de plus logique pour qui veut parler de cet enfermement que de commencer par là. Maïssa Bey n’a pas besoin de chercher loin pour trouver l’objet de sa description, elle ajoute éventuellement à ce qu’elle voit elle-même ce que les livres d’autres hommes ou femmes d’Algérie ont voulu faire connaître également ; et dans leur nombre il y a Assia Djebar. Comme il arrive souvent, on dirait que Maïssa Bey apprécie de plus en plus sa grande aînée maintenant qu’elle a disparu (le 7 février 2015). Ce qui est frappant, sans doute du fait de ce décalage qui les sépare dans le temps et modifie les circonstances historiques de leurs destins individuels, est que Maïssa Bey parle de sa consœur avec une sorte de grande tendresse, on dirait presque une affection qui s’est substituée avec le temps à l’admiration des débuts (ou qui plutôt s’est ajoutée à elle).
Comme il arrive souvent, on dirait que Maïssa Bey apprécie de plus en plus sa grande aînée maintenant qu’elle a disparu (le 7 février 2015). Ce qui est frappant, sans doute du fait de ce décalage qui les sépare dans le temps et modifie les circonstances historiques de leurs destins individuels, est que Maïssa Bey parle de sa consœur avec une sorte de grande tendresse, on dirait presque une affection qui s’est substituée avec le temps à l’admiration des débuts (ou qui plutôt s’est ajoutée à elle).
La pionnière du féminisme algérien moderne a payé au prix fort dans sa vie personnelle le destin qu’elle s’était choisi, sachant très tôt qu’elle aurait à le faire, jusqu’aux ultimes confirmations dont elle parle dans son dernier livre, « Nulle part dans la maison de mon père ».La pratique féministe de Maïssa Bey n’est sans doute plus celle des temps héroïques, ni semblable à ce qu’elle était une vingtaine d’années plus tôt, mais il suffit de lire ses romans écrits dans les dernières années pour se rendre compte des obstacles qui restent à surmonter. Dans l’épilogue de son texte, à la dernière page et à sa dernière ligne, sans commentaire parce qu’elle parle d’elle-même, on trouve une date : « C’est à Alger, c’est en mars 2019 ». Alger, mars 2019 : on peut considérer que les événements encore récents évoqués par ces mots ont toute leur place dans un hommage à Assia Djebar.
Denise Brahimi
» HISTOIRE DE L’ALGERIE DES ORIGINES A NOS JOURS « de Michel Pierre 2023 Editions Tallandier
A son tour, après Gilbert Meynier qui n’a pu mener le projet à son terme, Michel Pierre a entrepris cette oeuvre ambitieuse d’une histoire longue de l’Algérie. Cela débouche sur un ouvrage de 700 pages, très riche en informations, mais pour autant d’une lecture accessible pour un public non spécialiste. Le passé le plus ancien est rapidement survolé, c’est un regret, mais il aurait fallu un tome à part pour explorer ces temps préhistoriques. 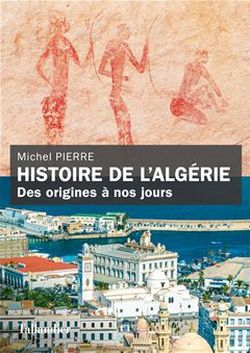 Pour autant ce spécialiste du Sahara nous éclaire sur des périodes qui restent pleines de mystère. Les chapitres sur l’antiquité, l’avènement de l’Islam, la régence ottomane et la relation entre « le lys et le croissant » apportent de multiples informations et plantent le décor de ce que l’envahisseur français va découvrir en 1830.
Pour autant ce spécialiste du Sahara nous éclaire sur des périodes qui restent pleines de mystère. Les chapitres sur l’antiquité, l’avènement de l’Islam, la régence ottomane et la relation entre « le lys et le croissant » apportent de multiples informations et plantent le décor de ce que l’envahisseur français va découvrir en 1830.
Vient ensuite une série de chapitres sur la colonisation très éclairants sur les choix successifs des gouvernements sur cette colonie, et les errements et les illusions qui ont conduit à l’affreuse guerre de libération dont les cicatrices restent vives dans les deux pays. Cinq chapitres analysent finement le parcours de l’Algérie indépendante jusqu’à aujourd’hui.
A signaler la pertinence des intitulés des chapitres, le choix d’illustrer par des anecdotes significatives, ce qui donne un ouvrage dont la rigueur universitaire (citations, notes …) se marie avec un texte fluide et accessible.
Une somme très efficace sur un sujet d’une grande complexité.
Michel Wilson
L’amicale des écrivains CDSRA :
Un groupe s’est formé au sein des adhérents à Coup de soleil de notre région. Cette initiative ne date que de quelques mois, elle en est encore à un stade expérimental et tout permet de supposer que ses contours se préciseront dans les temps à venir. En fait, ceux et celles qui ont souhaité se réunir dans ce cadre sont mus par leur amour de la littérature, la leur et celle des autres. L’amicale (et c’est bien d’amitié qu’il s’agit également) devrait permettre à chaque participant de faire entendre en les lisant des fragments de son œuvre écrite, qu’elle soit publiée ou non. Et ce à tour de rôle, évidemment pour laisser du temps à la discussion à la suite de chaque lecture. C’est par les réflexions et commentaires des autres que chacun pourra enrichir sa propre écriture.
Il est aussi été question de lire d’autres textes que ceux des participants, qui pourraient être des fragments d’œuvres littéraires empruntés à des auteurs laissés au choix de chacun.
C’est donc l’amour de la littérature et de l’écriture qui est au cœur de ce projet, en pleine évolution.

Un exemple de travail littéraire réalisé dans le cadre de L’Amicale présentée ci-dessus
Fiche de lecture « Les silences des pères » de Rachid Benzine, éditions du Seuil, 2023
Proposée par Annie Barranco –septembre 2023.
 Trappes, 2022
Trappes, 2022
Il pleut lorsque Hadj Driss Benzine est porté en terre, ce samedi 16 avril, à côté de sa femme Malika et de leur fils aîné Ibrahim. Deux dates sur une plaque en bois, 1938-2022, scellent la tombe et entre elles, pense Amine, le dernier fils, -notre narrateur-, une béance, un vide qui lui donne le vertige.
« Il a fallu qu’il meure pour que je revienne ».
Vingt-deux ans après son départ pour Boston où Amine a été sélectionné par une grande école américaine de musique.
Seul maintenant, dans l’appartement vide où, avec ses deux sœurs Khadija et Malika, l’existence de leur père est partie chez Emaüs ou dans des sacs plastique, il respire, là dans la chambre du mort, la fragrance toujours présente de son parfum bon marché, le même depuis toujours. Hésite, dans le salon, à s’engoncer dans le fauteuil du père, présence silencieuse, pour l’éternité cette fois, fidélité posthume à son taiseux fantôme égrenant son chapelet.
Amine, finalement le contourne, ne s’y enfonce pas même s’il est épuisé. « L’une de mes sœurs le récupérera », pense-t-il, et cette idée l’apaise.
Alors, il noue autour de son poignet le bracelet de cuir noir de la montre de son père, un modèle simple de chez Lip, en remonte le mécanisme, s’émeut du mouvement repris par la trotteuse qui saute de seconde en seconde.
Quitte l’appartement de son enfance, définitivement, en emportant avec lui l’enveloppe lourde de cassettes audio, une quarantaine, trouvée accidentellement derrière le tablier usé de la baignoire, les carreaux bleu clair, joints par son père, disjoints par le temps et l’humidité, fêlés, sont tombés dans le chambardement de l’ultime « déménagement » en révélant leur cachette improbable.
« Le voyage des nouvelles » peut commencer.
Lecture P. 40 ET 41.
Bouleversé par la présence de Chibani aux funérailles de son père, Amine décide alors de remonter le temps à la recherche de cet inconnu. C’est une épopée émouvante que nous vivons avec le fils, désorienté par l’exilé silencieux qu’il a toujours connu et l’homme qu’il découvre au fil de son voyage. Un voyage rythmé par les récits enregistrés selon une stricte chronologie, boussole précieuse, placée sur le siège « passager » de la voiture, que nous écoutons avec lui, émus et recueillis. Lorsque la voix se tait c’est que les piles du lecteur audio sont à plat, le temps d’un arrêt pour en racheter, et la voix paternelle revient, poursuit posément le récit de sa vie, au fil des kilomètres qui défilent aussi.
Les Trente Glorieuses, les Charbonnages de France, tournent à plein régime en France. Amine découvre comment les Amazighs du Souss, des jeunes hommes qui n’ont pas 20 ans, poussés par la misère des parents, deviennent après l’arrachement au pays et une sélection hasardeuse ponctuée d’humiliations, des travailleurs dociles, corvéables, parmi lesquels son père.
Amine découvre comment les « Gueules Noires » des mines de Lens, Driss Benzine et ses compagnons deviennent à Aubervilliers les « Gueules Grises » de la métallurgie, de la sidérurgie, de la cimenterie.
Découvre enfin à St-Laurent-des-Arbres, dans le Gard, les conditions d’embauche et de travail des ouvriers agricoles dans les maraîchages de melons où règne un racisme crasse, où rôde une envie de meurtre.
Dans ce périple, inhumain souvent, c’est Driss, son père qui tient le groupe d’exilés dans une solidarité sans faille, défend leurs conditions, s’interpose calmement, négocie, lit, s’instruit de tout, s’intéresse au cinéma-documentaire tourné dans les usines Lip ou Rhodiacéta, découvre la musique Raï, jazz. Et plus tard, classique…à travers les tournées de Ce Fils musicien dont il est si fier.
A son insu, il se rend aux concerts de l’enfant prodige, lorsqu’ils ont lieu en France.
« Les silences des pères »
Quand Malika l’accompagne, il lui sert la main très fort afin de ne pas pleurer… Et lorsque Malika décède, il continue d’assister à chacun des récitals de piano de leur fils. Collectionnant articles de presse, tickets de places, les moins chères, les plus éloignées, les plus inconfortables, mais toujours présent.
Enfin, et c’en est trop, Amine apprend comment son père, remarqué par les responsables des syndicats ouvriers, devient l’un de leurs représentants respecté qui défend les droits des travailleurs immigrés au sein des premières organisations mises en place.
« J’ai comme l’étrange sentiment d’avoir été trompé… »
Alors Amine explose, passant tour à tour, avec la souffrance qui l’accompagne, de l’incrédulité de l’adulte à la frustration de l’enfant, se révolte de cette injustice qu’il ne comprend pas, pas encore…
Lecture P. 101 102 103
Il lui faut passer par cette déchirure pour parvenir à rencontrer son père, Driss Benzine, l’inconnu, l’étranger, dont il exhibe parfois, tant il doute de son identité, la photo à son interlocuteur afin que celui-ci, tout en poursuivant, approuve le geste et l’apparition en murmurant ému « oui, comme tu lui ressembles … » ou « bien sûr comme je reconnais mon frère ».
Et c’est un autre Driss (Fnine), l’ami de toujours, parti du même bled, au même âge, puis Boualem-le-Rouge de la CGT, puis Noureddine-le-Vieux et Grand-Martin, puis Mohand-le-Harki, qui parviendront à renouer les fils, tous les fils tissés, des plus secrets aux plus intimes, entre le père doublement absent et le fils errant.
Mais seulement après qu’Amine les eût tous rencontrés, chacun à leur tour, lors de rendez-vous convenus avec eux, dans ce périmètre géographique déterminé par leur vie laborieuse commune, devenu désormais avec le temps inexorable, crépuscule de cette vie.
A Lille, dans un foyer où s’achève tristement, pour la plupart d’entre eux, leur existence solitaire. Parfois dans une brasserie accueillante, jadis fréquentée, autour d’un repas partagé où Nostalgie tient place de 3ème invitée. Rarement dans la chaleur hospitalière d’une maison ou d’un appartement personnel.le.
Oui, c’est certain, à les écouter raconter leur histoire, Amine comprendra mieux leurs parcours étroitement mêlés à celui de son père.
Au-delà de la voix du mort, c’est celles encore vivantes, vibrantes d’amitié et d’affection qui l’enveloppent et l’apaisent.
Lecture P. 63 ET 64
« Pour le mariage, j’ai fait comme tu m’as dit »
Amine est à St-Malo ce 26 avril 2022 devant la porte d’une maisonnette « Au Brise-Larmes », un bouquet de fleurs dans une main, une boîte de gâteaux dans l’autre… C’est la dernière étape de son voyage, la dernière rencontre aussi, avec Paulette cette fois, l’Amour de son père.
– N’en doutez pas, amis lecteurs. Et si vous en doutez, reportez-vous alors aux suppliques que Driss adresse à son père afin d’obtenir son autorisation de l’épouser : elles sont les aveux d’une absolue sincérité- (P.127 et 156).
Amour auquel il renoncera pourtant en 1975, alors âgé de 37 ans, par « respect aux pères, aux mères même quand ils se trompent », son père ayant refusé « la Française ».
Amine apprend ainsi de Paulette, les circonstances douloureuses de ce renoncement.
Puis celles, l’année suivante, du mariage de Driss et Malika-la-Marocaine, sa mère, compagne indéfectiblement douce de son père. De confidences en confidences, Malika n’ignore pas l’histoire d’amour de Driss avec la « chrétienne » ni la place qu’elle occupe dans le cœur de son mari.
Tout est accompli. Cependant encore de très belles pages à lire, cadeau de Rachid Benzine à son public – comme pour s’assurer que le défunt, Hadj Driss Benzine, repose bien, en paix, dans le cœur de ses descendants dont celui d’Amine Benzine, son fils bien-aimé.
Lecture P. 171 ET 172.

- 4 novembre à Lyon 14h Atelier d’écriture associatif « Nos Algérie ».
- 8 novembre projection du film d’Yves Benitah et Patrice Pegeault « 1983 L’espérance trahie » à l’Hôtel de Ville de Lyon
- 9 novembre Projection de 1983 L’espérance trahie au Rize à Villeurbanne
- 9 novembre Conférence/débat Les pratiques économiques et l’Islam dans l’Algérie coloniale par Muriam Haleh Davis de l’Université de Californie, modération Lahouari Addi. A Lyon, organisée par le FORSEM
- 10 et 11 novembre Festival de la Solidarité internationale à l’Hôtel de Ville de Lyon
- 16 novembre à la Maison des solidarités internationales de Lyon, conférence de Jacques Fontaine « L’insécurité alimentaire, le marché, la guerre ».
- 17 novembre, conférence de Stéphane Beaud Les émeutes de juin 2023 : une première approche sociologique. Espace Bancel à Lyon. Organisation FORSEM/Coup de Soleil AuRA
- 19 novembre Atelier d’écriture Nos Algérie.
- 24 novembre Conférence Driss Ksikess à Lyon
- 28 novembre Rencontre avec le romancier mauritanien Beyrouk et l’universitaire Bios Diallo à Lyon
- 30 novembre et 1er décembre Représentations de la pièce Pourquoi les oiseaux ont-ils disparus de la Compagnie Leila Soleil d’après les écrits de Rachid Mimouni, au CCO de Villeurbanne
- 2 décembre Journée mémoires d’appelés, d’insoumis et de déserteurs de la guerre d’Algérie au centre social de la Condition des soies Lyon 1er, avec Raphaelle Branche et Marius Loris Rodionoff
N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.


