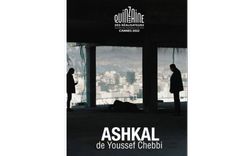Editorial
La Lettre essaie autant que possible d’offrir une relative variété, étant donné qu’il s’agit toujours du même domaine, celui de Coup de soleil, clairement délimité. Cependant on constate que cette variété est toujours possible, comme si le domaine qui est le nôtre était en perpétuel renouvellement. Il touche aux sciences politiques, sociales et humaines, c’est le cas des deux premiers articles, celui de Tahar Khalfoune qui continue à analyser les origines politiques de l’indépendance algérienne et celui dans lequel Tassadit Yacine explique ce que Pierre Bourdieu doit à l’Algérie et réciproquement. Les œuvres littéraires dont nous parlons aussi régulièrement sont représentées ici par deux romans, un roman policier de Rénia Aouadène, « Le choix de Thanina » et celui de Mathieu Bélezi , « Attaquer la terre et le soleil » que Dominique Lurcel a bien voulu présenter pour nous (avec un enthousiasme convaincant).
Dans le domaine des autres arts, le cinéma est cette fois représenté par le livre de Latéfa Lafer consacré au cinéma amazigh mais posant à travers cette catégorie des problèmes beaucoup plus vastes sur l’identité de l’Algérie (expression devenue trop banale et trop vague mais qui prend ici tout son sens). Le cinéma se donne aussi à voir grâce au très beau « Gardien des mondes » de Leila Chaibi.
Et c’est aussi un plaisir de parler pour une fois d’une pièce de théâtre contemporain qui a été bien accueillie au dernier festival d’Avignon : « Au non du père » d’Ahmed Madani.
Denise Brahimi

 Les congressistes se sont attelés en priorité à pallier l’absence d’une organisation viable maillant l’ensemble du territoire au cours des 20 premiers mois de guerre, relevée par l’état des lieux dressé lors cette rencontre d’évaluation. Les concepteurs de ce congrès ont su tirer les leçons de l’échec de la quarantaine d’insurrections régionales, sporadiques et mal organisées de 1830 jusqu’à la fin du XIXe siècle. En effet, ce qui distingue fondamentalement ces insurrections d’ampleur variable de la guerre d’indépendance ne tient pas aux actions armées qui ont toujours existé depuis le début de la colonisation jusqu’à la révolte de Belezma en 1916 dans les Aurès, mais à l’organisation mise en place par le congrès de la Soummam.
Les congressistes se sont attelés en priorité à pallier l’absence d’une organisation viable maillant l’ensemble du territoire au cours des 20 premiers mois de guerre, relevée par l’état des lieux dressé lors cette rencontre d’évaluation. Les concepteurs de ce congrès ont su tirer les leçons de l’échec de la quarantaine d’insurrections régionales, sporadiques et mal organisées de 1830 jusqu’à la fin du XIXe siècle. En effet, ce qui distingue fondamentalement ces insurrections d’ampleur variable de la guerre d’indépendance ne tient pas aux actions armées qui ont toujours existé depuis le début de la colonisation jusqu’à la révolte de Belezma en 1916 dans les Aurès, mais à l’organisation mise en place par le congrès de la Soummam. Par l’organisation politico-militaire de la révolution et le projet d’édification, après l’indépendance, d’une République démocratique et sociale qui garantit l’égalité à tous les citoyens sans discrimination, qui en est issu, les résolutions du Congrès de la Soummam constituent la première matrice de l’État-nation et sa première vraie « petite constitution ». De toutes les mesures prises, le principe de la primauté du politique sur le militaire est le plus déterminant, le plus prémonitoire, mais aussi le plus critiqué par les tenants d’un État militaire. Larbi Ben M’hidi et Ramdane Abane, architectes du congrès et fervents défenseurs de ce principe, ont fait preuve de clairvoyance redoutant une militarisation des conflits politiques entre Algériens avant et surtout après l’indépendance. Deux hommes politiques lucides qui ont pensé juste et agi loin. Leur présage n’a pas pu empêcher, hélas, les luttes fratricides au cours et après la guerre.
Par l’organisation politico-militaire de la révolution et le projet d’édification, après l’indépendance, d’une République démocratique et sociale qui garantit l’égalité à tous les citoyens sans discrimination, qui en est issu, les résolutions du Congrès de la Soummam constituent la première matrice de l’État-nation et sa première vraie « petite constitution ». De toutes les mesures prises, le principe de la primauté du politique sur le militaire est le plus déterminant, le plus prémonitoire, mais aussi le plus critiqué par les tenants d’un État militaire. Larbi Ben M’hidi et Ramdane Abane, architectes du congrès et fervents défenseurs de ce principe, ont fait preuve de clairvoyance redoutant une militarisation des conflits politiques entre Algériens avant et surtout après l’indépendance. Deux hommes politiques lucides qui ont pensé juste et agi loin. Leur présage n’a pas pu empêcher, hélas, les luttes fratricides au cours et après la guerre. période de la guerre d’Algérie, et elle se trouve tout au début de sa vie d’universitaire et de chercheur —autant de circonstances qui pourraient faire croire qu’on arrive assez bien à cerner ce qu’il en fut pour lui de ces années-là. Pourtant Tassadit Yacine a su réunir dans ce volume de 2022 des informations utiles voire précieuses pour un « retour à Bourdieu » dont cet anniversaire pourrait être l’occasion, bien qu’il n’ait jamais cessé d’irriguer la pensée contemporaine, principalement mais pas seulement sans le domaine de la sociologie.
période de la guerre d’Algérie, et elle se trouve tout au début de sa vie d’universitaire et de chercheur —autant de circonstances qui pourraient faire croire qu’on arrive assez bien à cerner ce qu’il en fut pour lui de ces années-là. Pourtant Tassadit Yacine a su réunir dans ce volume de 2022 des informations utiles voire précieuses pour un « retour à Bourdieu » dont cet anniversaire pourrait être l’occasion, bien qu’il n’ait jamais cessé d’irriguer la pensée contemporaine, principalement mais pas seulement sans le domaine de la sociologie.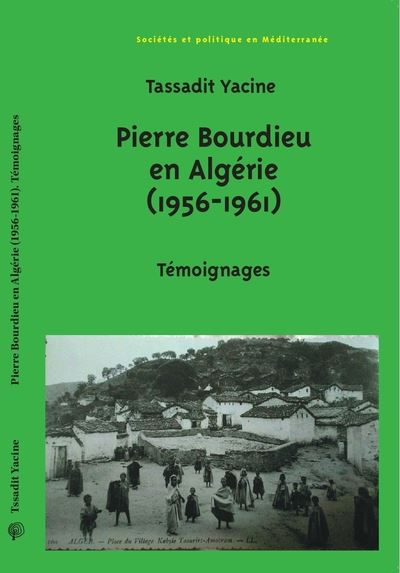 Non sans concepts théoriques, cette sociologie était néanmoins surtout fondée sur l’observation. Pierre Bourdieu avait été aidé dans ce travail par un Algérien d’origine bien connu pour ses remarquables travaux, Abdelmalek Sayad, malheureusement disparu prématurément en 1988, à l’âge de 65 ans. Plusieurs des témoignages repris dans ce recueil de Tassadit Yacine mettent l’accent sur le rôle joué par Sayad dans la découverte de l’Algérie par Bourdieu. Ils s’entendaient d’autant mieux que Sayad était politiquement très à gauche, et que ses relations (forcément clandestines) avec le FLN ont facilité les enquêtes de Bourdieu sur le terrain, à un moment où la guerre d’Algérie entraînait moult contraintes et interdictions. En tout cas Pierre Bourdieu n’a pas été ingrat et à partir de 1998 il a rendu maint hommage à son collaborateur et ami.
Non sans concepts théoriques, cette sociologie était néanmoins surtout fondée sur l’observation. Pierre Bourdieu avait été aidé dans ce travail par un Algérien d’origine bien connu pour ses remarquables travaux, Abdelmalek Sayad, malheureusement disparu prématurément en 1988, à l’âge de 65 ans. Plusieurs des témoignages repris dans ce recueil de Tassadit Yacine mettent l’accent sur le rôle joué par Sayad dans la découverte de l’Algérie par Bourdieu. Ils s’entendaient d’autant mieux que Sayad était politiquement très à gauche, et que ses relations (forcément clandestines) avec le FLN ont facilité les enquêtes de Bourdieu sur le terrain, à un moment où la guerre d’Algérie entraînait moult contraintes et interdictions. En tout cas Pierre Bourdieu n’a pas été ingrat et à partir de 1998 il a rendu maint hommage à son collaborateur et ami. Pour ne prendre qu’un exemple, l’un de ses livres les plus importants ou le plus souvent cités, « Esquisse d’une théorie de la pratique » (1972), dont le titre ne laisse pas supposer un ancrage algérien, n’en est pas moins précédé de « Trois études d’ethnologie kabyle » comme s’il avait besoin de prendre appui sur cette base quoi qu’il en soit. D’ailleurs le titre judicieux donné à sa relation avec l’Algérie, à l’occasion d’une exposition de ses photos qui eut lieu en 2003 à l’institut du Monde arabe, est explicite à cet égard : « Images d’Algérie. Une affinité élective ». On voit que la formule est non seulement jolie mais qu’elle correspond à une réalité.
Pour ne prendre qu’un exemple, l’un de ses livres les plus importants ou le plus souvent cités, « Esquisse d’une théorie de la pratique » (1972), dont le titre ne laisse pas supposer un ancrage algérien, n’en est pas moins précédé de « Trois études d’ethnologie kabyle » comme s’il avait besoin de prendre appui sur cette base quoi qu’il en soit. D’ailleurs le titre judicieux donné à sa relation avec l’Algérie, à l’occasion d’une exposition de ses photos qui eut lieu en 2003 à l’institut du Monde arabe, est explicite à cet égard : « Images d’Algérie. Une affinité élective ». On voit que la formule est non seulement jolie mais qu’elle correspond à une réalité.« LE CHOIX DE THANINA » par Rénia Aouadène, roman policier, éditions Marsa-A, 2022 L’autrice de ce court roman (son troisième) est une écrivaine dont le champ d’action se situe entre l’Algérie, la France et l’Espagne. Thanina dont ce livre fait le portrait est une Algérienne dont le choix (le mot du titre) est justement de rester dans son pays d’origine alors que la situation dans laquelle elle vit et tout son entourage ou presque l’incitent à en partir. Elle pourrait par exemple aller s’établir à Marseille où elle sait qu’elle vivrait beaucoup mieux qu’à Béjaïa, dans cette partie de la Kabylie qu’elle connaît bien mais qui a été horriblement ravagée juste avant que ne commence l’action du livre. Le moment où se passe celle-ci, plus ou moins l’an 2000, fait immédiatement suite à la décennie noire (1990-2000) marquée par les massacres d’une guerre civile entre les hommes au pouvoir et les islamistes : malgré la paix à peine rétablie, les séquelles en sont nombreuses et effroyables et Thanina est amenée à les constater tous les jours, du fait du métier qu’elle exerce, de manière inattendue. Elle est commissaire de police et sa réputation n’est plus à faire là où s’exerce son autorité : elle est intègre et incorruptible dans un pays où la corruption sévit à tous les niveaux, elle ne transige jamais sur les exigences de la tâche à laquelle elle se consacre exclusivement parce que tel est son choix quoi qu’il lui en coûte—ce mot « choix » étant une sorte de mot-clef du livre, qui indique une action volontaire et délibérée, non par une obstination inexplicable et bornée mais pour des raisons que le lecteur peut parfaitement comprendre, et apprécier.
L’autrice de ce court roman (son troisième) est une écrivaine dont le champ d’action se situe entre l’Algérie, la France et l’Espagne. Thanina dont ce livre fait le portrait est une Algérienne dont le choix (le mot du titre) est justement de rester dans son pays d’origine alors que la situation dans laquelle elle vit et tout son entourage ou presque l’incitent à en partir. Elle pourrait par exemple aller s’établir à Marseille où elle sait qu’elle vivrait beaucoup mieux qu’à Béjaïa, dans cette partie de la Kabylie qu’elle connaît bien mais qui a été horriblement ravagée juste avant que ne commence l’action du livre. Le moment où se passe celle-ci, plus ou moins l’an 2000, fait immédiatement suite à la décennie noire (1990-2000) marquée par les massacres d’une guerre civile entre les hommes au pouvoir et les islamistes : malgré la paix à peine rétablie, les séquelles en sont nombreuses et effroyables et Thanina est amenée à les constater tous les jours, du fait du métier qu’elle exerce, de manière inattendue. Elle est commissaire de police et sa réputation n’est plus à faire là où s’exerce son autorité : elle est intègre et incorruptible dans un pays où la corruption sévit à tous les niveaux, elle ne transige jamais sur les exigences de la tâche à laquelle elle se consacre exclusivement parce que tel est son choix quoi qu’il lui en coûte—ce mot « choix » étant une sorte de mot-clef du livre, qui indique une action volontaire et délibérée, non par une obstination inexplicable et bornée mais pour des raisons que le lecteur peut parfaitement comprendre, et apprécier.
Thanina est une femme belle et courageuse, ce qui paradoxalement éloigne d’elle la plupart des gens, en sorte que le prix à payer pour son choix est celui d’une grande solitude. Ce n’est pas gâcher le dénouement que de laisser entrevoir pour la fin du livre et au-delà la possibilité d’une rencontre amoureuse presque inespérée, car s’il y a un fil conducteur proposé aux lecteurs c’est celui-là : comment construire une relation durable et sensée, désirable et désirée, dans des conditions aussi difficiles et qui laissent tout à inventer. L’invention du livre, pour reprendre ce mot, serait justement cela, celle d’une relation devenue très improbable entre un homme et une femme qui étaient, par la force des choses, sur le point d’y renoncer.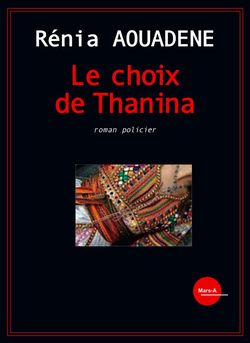 Manière de dire, on l’aura compris, que le caractère policier du roman est un peu un leurre, en tout cas le mot « policier » qui ici devrait être mis au féminin (roman d’une policière) ne correspond pas aux caractéristiques habituelles de ce genre littéraire, le livre n’est pas fondé sur la recherche difficile voire épineuse du coupable d’un crime, il n’entre pas dans la catégorie bien connue et de loin la plus fréquente dans ce genre, celle du « whodunit », mot anglais désormais adopté sous cette forme et dont la traduction en français serait « qui l’a fait ?». Certes il y aura bien une sorte d’enquête d’autant que Thanina n’est pas avare de ses peines et fait son métier scrupuleusement, mais elle va droit au but, il n’y a pas de fausses pistes ni d’embrouille et la vérité à découvrir n’est que trop flagrante. Comme dans la plupart des cas évoqués par le livre et c’est presque la totalité, il s’avère que la victime est une femme parce qu’elle est une femme, c’est-à-dire parce qu’elle appartient à cette catégorie de l’humanité, que l’autre, celle des mâles dominants, ne cesse d’écraser.
Manière de dire, on l’aura compris, que le caractère policier du roman est un peu un leurre, en tout cas le mot « policier » qui ici devrait être mis au féminin (roman d’une policière) ne correspond pas aux caractéristiques habituelles de ce genre littéraire, le livre n’est pas fondé sur la recherche difficile voire épineuse du coupable d’un crime, il n’entre pas dans la catégorie bien connue et de loin la plus fréquente dans ce genre, celle du « whodunit », mot anglais désormais adopté sous cette forme et dont la traduction en français serait « qui l’a fait ?». Certes il y aura bien une sorte d’enquête d’autant que Thanina n’est pas avare de ses peines et fait son métier scrupuleusement, mais elle va droit au but, il n’y a pas de fausses pistes ni d’embrouille et la vérité à découvrir n’est que trop flagrante. Comme dans la plupart des cas évoqués par le livre et c’est presque la totalité, il s’avère que la victime est une femme parce qu’elle est une femme, c’est-à-dire parce qu’elle appartient à cette catégorie de l’humanité, que l’autre, celle des mâles dominants, ne cesse d’écraser.
La jeune morte qui est au point de départ du livre est condamnée à mourir par un ensemble de circonstances qui remontent loin dans le passé et auxquelles s’est ajouté le terrorisme islamiste qui est venu dans ce cas comme dans d’autres renforcer le danger de mort portant sur les femmes, mais il y a dans le livre suffisamment d’exemples pour qu’on voie la diversité des formes que prend ce massacre séculaire, pour lequel le mot « oppression » paraît bien faible et bien abstrait.
Ne sont que trop concrets, matériels et physiques les cas que Rénia Aoudène introduit dans son livre sous la forme de récits secondaires insérés dans le récit principal et qui, en quelques pages, s’ajoutent au dossier effrayant des meurtres commis contre les femmes—il s’agit ici d’Algériennes, pour lesquelles le mot « féminicides » s’il n’existait pas, devrait être inventé. Ce livre, qui n’est petit qu’en apparence, constitue finalement une sorte de rapport implacable sur la souffrance féminine et un réquisitoire contre l’impunité dont jouissent ceux qui la provoquent—sauf lorsqu’une femme en arrive à se faire justice elle-même, mais une fois de plus on a envie de dire : à quel prix ! En fait il y a bien une enquête dans ce livre mais elle ne porte pas sur une seule victime ou un seul crime, c’est une situation qui est dénoncée dans sa totalité et face à laquelle trop de gens ont déjà fui ou continuent à fuir, raison pour laquelle on comprend que Thanina n’accepte pas d’en faire autant.
Depuis que l’Algérie existe en tant que telle c’est-à-dire depuis l’indépendance, elle a connu plusieurs générations (le renouvellement des classes d’âge y est extrêmement rapide) parmi lesquelles des gens, quelques-uns au moins, ont réfléchi et tenté d’agir. Mais selon Rénia Aouadène, qu’on peut prendre comme témoin, la décennie noire a causé des dégâts jusqu’ici irréversibles créant une situation dans laquelle tout est à réinventer, et sans base aucune dans la mesure où il n’est plus possible de prendre appui sur le courage impulsé par la guerre d’indépendance, ses héros supposés et autoproclamés s’étant déconsidérés et pire que cela.
« Le choix de Thanina » nous dit qu’on peut encore trouver au sein de la société civile des gens (et pas nécessairement des intellectuels) qui sont prêts à essayer d’inventer la vie ou de la réinventer à mains nues. Le livre de Rénia Aoudène, poussée par l’empathie et l’indignation, est à lire comme la volonté de partager et d’encourager cet effort dans un monde de survivants.
Denise Brahimi
Nous avons publié une chronique sur un de ses précédents livres, le très beau « Un maure dans la sierra ».
« ATTAQUER LA TERRE ET LE SOLEIL » par Mathieu Belezi Editions Le Tripode, 2022
La Guerre d’Algérie -et avec elle la Guerre d’indépendance- n’ont pas commencé en 1954, mais en 1830. Les années qui ont suivi la prise d’Alger ont été des années de violences terribles, de massacres, de viols, d’enfumades. Et aussi de Résistance. Tout cela, les historiens l’ont dit. Tout cela est documenté. Les sources principales étant celles des conquérants français eux-mêmes : les lettres, récits et rapports des « pacificateurs » (Bugeaud, Saint-Arnaud, Pélissier, Montagnac, etc.) disent crument, fièrement, « innocemment » leurs pouvoirs sans limites, ainsi que l’horreur assumée (1). De cette période tragique, de ce péché originel de l’entreprise coloniale, nulle trace, cependant, dans l’expression artistique : pas de films (des deux côtés de la Méditerranée) ; pas de romans.
Ce silence, d’une violence sidérale, l’écrivain Mathieu Belezi ne cesse de s’y confronter, roman après roman, en y opposant une violence identique, rageuse et puissante : celle de sa langue.
Après C’était notre terre (Albin Michel, 2008), Les Vieux Fous (Flammarion, 2011) et Un faux-pas dans la vie d’Emma Picard (Flammarion, 2015), il publie aujourd’hui Attaquer la Terre et le Soleil (Le Tripode, 2022). Un titre incandescent, aux ambitions prométhéennes. Littéralement délirant, à l’image de tout rêve colonisateur. Un titre que tout le livre illustre superbement.

bruno levy
Droits d’auteur : Bruno Levy/Le Monde
Mathieu Belezi, dans deux des romans précédents de sa « trilogie algérienne », avait déjà dénoncé la violence des premières années de la conquête de l’Algérie : Un faux-pas dans la vie d’Emma Picard, sous le signe de l’empathie critique, s’attachait à décrire l’installation des premiers colons, entre espoirs et désillusions ; Les vieux fous, dans un style épique, à la limite du fantastique, dénonçait ad nauseam la folie guerrière, insatiable, des conquérants français. Attaquer la Terre et le Soleil creuse jusqu’à l’obsession ces deux mêmes sujets, en les réunissant dans une construction alternée, champ/contrechamp : le roman donne tout à tour la parole à Séraphine, une jeune femme venue s’installer près de Bône avec sa famille, puis à un soldat « des armées d’Afrique ». On ne connaitra rien de lui. Rien d’autre que le récit qu’il fera de ses actes. D’emblée, individualisation ici (Séraphine et les siens), métaphore là (ce soldat incarne « tous les soldats »), choix radicaux, auxquels font écho deux écritures, elles aussi radicalement différentes, réaliste ici, sombrement lyrique, là. L’intitulé récurrent des chapitres donne la couleur : « Rude Besogne » pour le récit de Séraphine ; « Bain de sang », pour celui du soldat.
On ne cherchera pas dans ce roman de précision événementielle. On s’interroge, lors des premières pages : 1848 ? 1870 ? Un peu plus tard ? Certains détails, dans un premier temps, font pencher la balance vers les premières années (références, par exemple, aux enfumades) ; il apparait ensuite qu’on est plutôt déjà sous la Troisième République, celle des « Jules » (présence du discours « civilisateur » qui émerge seulement à partir des années 1870). Il semble que Mathieu Belezi, même s’il dit avoir situé l’action de son roman en 1845 (Entretien dans le Monde des Livres, 9 septembre 2022) prenne plaisir à brouiller un peu les pistes. En réalité, c’est l’Histoire qui l’intéresse, pas l’évènement lui-même. On le sait depuis longtemps, le roman permet le raccourci, l’empilement. De fait, Belezi s’autorise à fondre dans la même temporalité des évènements qui ont pu se dérouler sur vingt ans. Ce faisant, il renforce considérablement l’effet de réel. Il le transcende. On pourrait dire : il le sublimise, au risque, en l’occurrence, de tomber dans l’obscène.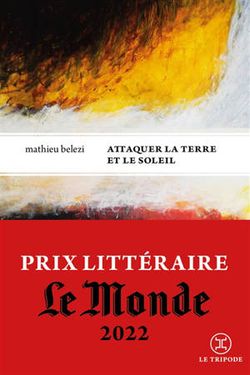 C’est particulièrement évident pour les chapitres « Bain de sang ». L’auteur aurait pu, tout aussi bien, les intituler « Bain d’ivresse ». Ivresse bien réelle, quasi permanente du soldat, jouxtant avec la fatigue, mais, plus encore, ivresse métaphorique : Mathieu Belezi nous donne à voir un personnage ivre de folie. Pas de place pour la raison, pour la pensée : quand la voix de la conscience tente, timidement et rarement, de se faire une petite place (dans une forme que l’auteur maitrise magnifiquement), le soldat lui fait comprendre sur le champ qu’elle n’a pas voix au chapitre. C’est la force du livre de nous mettre face à ce constat sans appel : toutes les valeurs sont inversées. Le mal, c’est le bien. Tuer. Violer. Piller. Brûler. Enfumer. On a le droit pour soi, on est « couvert ». Tout est permis : on « civilise ». On pense à Joseph Conrad, Au cœur des Ténèbres. Ivresse d’orgueil, jouissance d’un pouvoir sans limites, puissamment incarnées par le Capitaine qui commande le corps d’armée. Un « jeune fou », pour paraphraser Belezi, un personnage ubuesque, tragi-comique -mais davantage tragique… Les pages puissantes qui lui sont consacrées atteignent le fantastique. Un fantastique burlesque. Dans sa monstruosité tranquille, effroyable et dérisoire, le personnage rejoint la galerie des « héros » baroques d’un Gabriel Garcia Marquez et de son « réalisme magique », une des sources d’inspiration de l’auteur : il est « tous les Capitaines », passés et à venir, comme le Patriarche de GGM était, à lui seul, tous les tyrans qui-n’en-finissent-pas-de-mourir (L’Automne du Patriarche est paru en Espagne l’année de la mort de Franco…)
C’est particulièrement évident pour les chapitres « Bain de sang ». L’auteur aurait pu, tout aussi bien, les intituler « Bain d’ivresse ». Ivresse bien réelle, quasi permanente du soldat, jouxtant avec la fatigue, mais, plus encore, ivresse métaphorique : Mathieu Belezi nous donne à voir un personnage ivre de folie. Pas de place pour la raison, pour la pensée : quand la voix de la conscience tente, timidement et rarement, de se faire une petite place (dans une forme que l’auteur maitrise magnifiquement), le soldat lui fait comprendre sur le champ qu’elle n’a pas voix au chapitre. C’est la force du livre de nous mettre face à ce constat sans appel : toutes les valeurs sont inversées. Le mal, c’est le bien. Tuer. Violer. Piller. Brûler. Enfumer. On a le droit pour soi, on est « couvert ». Tout est permis : on « civilise ». On pense à Joseph Conrad, Au cœur des Ténèbres. Ivresse d’orgueil, jouissance d’un pouvoir sans limites, puissamment incarnées par le Capitaine qui commande le corps d’armée. Un « jeune fou », pour paraphraser Belezi, un personnage ubuesque, tragi-comique -mais davantage tragique… Les pages puissantes qui lui sont consacrées atteignent le fantastique. Un fantastique burlesque. Dans sa monstruosité tranquille, effroyable et dérisoire, le personnage rejoint la galerie des « héros » baroques d’un Gabriel Garcia Marquez et de son « réalisme magique », une des sources d’inspiration de l’auteur : il est « tous les Capitaines », passés et à venir, comme le Patriarche de GGM était, à lui seul, tous les tyrans qui-n’en-finissent-pas-de-mourir (L’Automne du Patriarche est paru en Espagne l’année de la mort de Franco…)
En face de cette démesure, il y a le contrepoint Séraphine. Là on est sur terre. Dans le quotidien le plus concret, et le plus rude, celui des premiers colons, attirés par des promesses d’avenir meilleur, et qui ne tarderont pas à déchanter. Un quotidien ancré dans la boue, entouré de dangers. « Rude besogne », en effet. Pour le lecteur, on ne peut pas parler de respiration, tant le destin de Séraphine et des siens est lourd de menaces en tous genres. Mais l’on n’est plus confronté à des « passions tristes ». On est dans le domaine d’une sensibilité proche, plus empathique. Portés par l’écriture, devenue brusquement sobre et retenue, de Mathieu Belezi, on s’attache à Séraphine, on ne peut pas faire autrement, on compatit, sans cesser cependant de la critiquer, impuissants que nous sommes devant son aveuglement, son entêtement : on pense à Anna Fierling, la Mère Courage de Brecht, qu’on regarde, scène après scène, aller droit dans le mur. Et l’on s’interroge : jusqu’où Séraphine ira-t-elle avant de prendre conscience qu’elle est une victime de l’entreprise coloniale – et qu’elle en est, à son corps défendant, la complice ?
L’idée de ce champ/contre champ est splendide. Elle introduit de l’humanité au cœur même de l’horreur. Elle évite, dans le même temps, de créer chez le lecteur, le sentiment de saturation qu’il ne manquerait pas d’éprouver à la seule lecture des pages « Bain de sang ».
Il faudrait dire ici, une fois encore, le souffle rageur de l’écriture de Mathieu Belezi. Dire ses brusques respirations devant un ciel, un paysage. Des moments d’autant plus précieux qu’ils sont volontairement brefs, bouffées d’air bienvenues. Il faudrait dire certaines scènes, bouleversantes de concision métaphorique, qu’il s’agisse de la mort d’un lapin, ou du regard d’un chef de village.
Le livre est bref. Il faut le lire.
En un temps où le politique peine à nommer clairement le réel, s’acharne à l’enrober de périphrases aseptisées, au risque d’entretenir éternellement une confusion mortifère, la force évocatrice et la puissance de langage qui émanent d’un roman tel qu’Attaquer la Terre et le Soleil nous obligent à y faire face, sans dérobade possible. Une entreprise hautement salutaire. Faulkner -visiblement une des autres sources d’inspiration de l’auteur- disait : « Écrire c’est comme craquer une allumette au
cœur de la nuit en pleine forêt. Ce que vous comprenez alors, c’est combien il y a d’obscurité partout. La littérature ne sert pas à mieux voir. Elle sert seulement à mesurer l’épaisseur de l’ombre ». C’est bien de cela qu’il s’agit, ici.
Dominique Lurcel 9 septembre 2022.
Depuis deux jours, Mathieu Belezi est, avec Attaquer la Terre et le Soleil, l’heureux lauréat du Prix Littéraire 2022 du Monde.
(1) On en trouvera notamment un florilège accablant dans l’ouvrage d’Olivier Le Cour Grandmaison, Coloniser Exterminer, Fayard, 2005

« AU NON DU PERE », par Ahmed Madani, théâtre, Actes Sud-Papiers 2022
Tout est dans le jeu de mots qui figure au titre de cette œuvre théâtrale : le « non » signifie ici négation et refus, refus opposé par un père à sa fille qu’il ne veut pas reconnaître comme telle et dont il ne veut même pas, absolument pas, entendre parler. Jusqu’à un certain moment de la pièce évidemment , grâce à l’extrême obstination de la jeune femme appelée Anissa qui depuis l’enfance cherche à connaître son père et grâce aussi à l’aide que lui apporte Ahmed Madani lui-même. Celui-ci en effet joue un rôle important dans ce mélange de réalité et de fiction que montre la pièce, et l’on découvrira au bout du compte (conte ?) qu’il a des raisons personnelles de se sentir impliqué dans l’histoire d’Anissa, à laquelle il s’identifie pour plusieurs raisons, notamment parce qu’il est comme elle à la recherche de son père.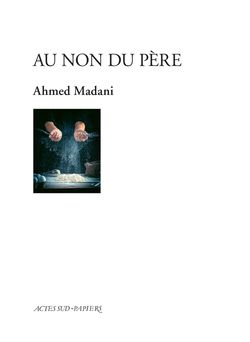 A partir de leurs deux exemples, le sujet ou thème principal de la pièce pourrait bien être « chacun cherche son père » et parfois par personne interposée. Ce qui est évidemment immense et certainement pathétique, mais « Au non du père » ne se situe pas sous le signe de la tragédie. Tout autre est le ton d’un homme politique américain dans une citation mise en exergue du petit livre publié par Actes Sud-Papiers : « Le destin n’est pas une question de chance, c’est une question de choix : il n’est pas quelque chose qu’on doit attendre, mais qu’on doit accomplir. » L’histoire d’Anissa et de sa recherche du père illustre parfaitement ces mots. Contre toute vraisemblance et probabilité, elle va jusque dans le New Hampshire aux Etats-Unis pour rencontrer ce père boulanger, et si la rencontre a lieu en effet au sens le plus fort de ce mot, ce n’est pas par goût d’un happy end à la Walt Disney, c’est parce que les deux interlocuteurs s’y emploient, ayant sans doute découvert (chez le père c’est peut-être dans son inconscient) à quel point leur était important voire vital l’échange qui s’instaure entre eux.
A partir de leurs deux exemples, le sujet ou thème principal de la pièce pourrait bien être « chacun cherche son père » et parfois par personne interposée. Ce qui est évidemment immense et certainement pathétique, mais « Au non du père » ne se situe pas sous le signe de la tragédie. Tout autre est le ton d’un homme politique américain dans une citation mise en exergue du petit livre publié par Actes Sud-Papiers : « Le destin n’est pas une question de chance, c’est une question de choix : il n’est pas quelque chose qu’on doit attendre, mais qu’on doit accomplir. » L’histoire d’Anissa et de sa recherche du père illustre parfaitement ces mots. Contre toute vraisemblance et probabilité, elle va jusque dans le New Hampshire aux Etats-Unis pour rencontrer ce père boulanger, et si la rencontre a lieu en effet au sens le plus fort de ce mot, ce n’est pas par goût d’un happy end à la Walt Disney, c’est parce que les deux interlocuteurs s’y emploient, ayant sans doute découvert (chez le père c’est peut-être dans son inconscient) à quel point leur était important voire vital l’échange qui s’instaure entre eux.
Le recours à la boulangerie et à la pâtisserie, qui sont à la fois les métiers et les domaines d’excellence du père et de la fille, crée entre eux un lien très concret, très physique qui évite que la quête avec laquelle ils sont aux prises ne prenne un caractère psychologique voire psychanalytique et fait en sorte qu’elle soit résolument physique voire sensorielle plutôt que métaphysique. Ce qui frappe en effet dans la pièce d’Ahmed Madani, c’est qu’elle puisse être à la fois aussi simple et aussi immense dans son propos. Il en découle un humour très particulier dont on trouve un exemple à l’extrême fin. L’auteur du texte y reproduit, sans autre commentaire, ce qu’il appelle les « recettes d’Anissa », celle des pralines et celle des fondants au chocolat ! Histoire de laisser aux spectateurs-lecteurs une bonne bouche comme on dit, et de se refuser à « lacaniser » si l’on ose fabriquer ce verbe à partir du nom de Lacan, psychanalyste et philosophe auquel on doit maint propos sur « le nom du père », à l’origine du jeu de mot qui est au titre de la pièce.
Ce qui frappe en effet dans la pièce d’Ahmed Madani, c’est qu’elle puisse être à la fois aussi simple et aussi immense dans son propos. Il en découle un humour très particulier dont on trouve un exemple à l’extrême fin. L’auteur du texte y reproduit, sans autre commentaire, ce qu’il appelle les « recettes d’Anissa », celle des pralines et celle des fondants au chocolat ! Histoire de laisser aux spectateurs-lecteurs une bonne bouche comme on dit, et de se refuser à « lacaniser » si l’on ose fabriquer ce verbe à partir du nom de Lacan, psychanalyste et philosophe auquel on doit maint propos sur « le nom du père », à l’origine du jeu de mot qui est au titre de la pièce.
La présentation de ce spectacle qui a été donné à Avignon en 2022 vise à nous mettre dans une grande familiarité, ou proximité, avec les deux personnages principaux : « alors je me présente je suis Ahmed Madani et voici Anissa ». Cette simplicité ne doit pas faire illusion : nous sommes embarqués dans une réflexion qui va loin.
Denise Brahimi

Ce long métrage revendique en même temps une appartenance à la catégorie documentaire, en sorte qu’il n’est pas évident de savoir quelle part y tient la fiction. On peut d’ailleurs penser que cela fait partie d’une certaine stratégie de la réalisatrice que de laisser planer un doute à cet égard, —manière de dire que la vérité n‘est pas forcément dans l’exactitude des détails mais qu’elle est ou qu’elle est aussi d’un autre ordre. C’est justement cette vérité humaine qui frappe chez le personnage principal Hassan dont on entend la voix tout au long du film. On a envie de dire que cette voix, belle, chaude, riche d’inflexions variées, est le cœur vivant du film car elle s’adresse à nous en tant que personnes, non pour nous émouvoir au sens où le ferait un mélodrame, mais plutôt pour nous dire que cette part à la fois intime et intense de l’être est l’essence de l’humanité sous toutes ses formes. Naïvement, voire niaisement, on s’attend peut-être un peu moins à la trouver lorsque ces formes sont, comme ici, celles d’une vie réduite au plus grand dénuement.
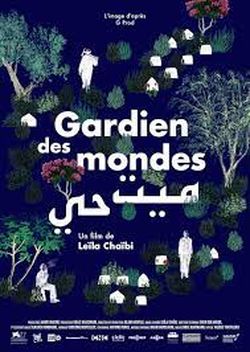 Toute l’action du film (qui à dire vrai se réduit à bien peu de chose) se passe parmi ceux qu’à l’époque de Victor Hugo on aurait appelés des gueux mais le poète était de ceux qui n’emploient pas ce mot à son sens habituel, péjoratif et dévalorisant , bien au contraire. Et s’il y a une raison de le rappeler ici, c’est justement parce que la réalisatrice du film est poète elle aussi : son film-documentaire est une sorte de long poème dont le fil principal échappe à la matérialité du monde pour en dire à la fois la misère et la beauté. Gueux ou misérables au sens hugolien, en cela réside leur paradoxe, que seule peut nous dire la poésie
Toute l’action du film (qui à dire vrai se réduit à bien peu de chose) se passe parmi ceux qu’à l’époque de Victor Hugo on aurait appelés des gueux mais le poète était de ceux qui n’emploient pas ce mot à son sens habituel, péjoratif et dévalorisant , bien au contraire. Et s’il y a une raison de le rappeler ici, c’est justement parce que la réalisatrice du film est poète elle aussi : son film-documentaire est une sorte de long poème dont le fil principal échappe à la matérialité du monde pour en dire à la fois la misère et la beauté. Gueux ou misérables au sens hugolien, en cela réside leur paradoxe, que seule peut nous dire la poésieA une autre époque et dans une autre culture, on aurait sans doute parlé de néo-réalisme car on désigne par ce mot, notamment dans le cinéma italien, un style qui permet à la fois de montrer les corps abîmés par la vie (ceux des pauvres le sont terriblement plus que les autres !) et les âmes qui habitent ces corps en les imprégnant de spiritualité. Dans le film de Leïla Chraïbi, on pourrait être tenté de remplacer ce dernier mot par celui de religion, du fait que la présence de l’islam est dans tous les propos et dans tous les comportements qui nous sont donnés à voir. Mais il s’agit plutôt de rituels du fait que tout se passe dans un cimetière, celui où habite Hassan et dont il assure soigneusement l’entretien, en sorte que ces rituels sont ceux du deuil, qui se reproduisent à chaque fois que nous assistons à un enterrement. La religion implique un ensemble de croyances, et il est certain qu’Hassan n’en manque pas mais il n’en fait jamais état comme à des dogmes ou à des certitudes, on a plutôt le sentiment qu’il invente seul ses lignes de force, pour peu qu’il en ait. La principale et la plus profonde est l’échange qu’il entretient avec sa défunte mère, représentée par sa pierre tombale qu’il caresse avec la plus émouvante et la plus naturelle des tendresses : quotidiennement, à toute heure, elle lui permet d’accéder à une autre vie et d’en éprouver la présence.
Cependant sa mère n’a pas été la seule femme de sa vie. Le peu qu’on apprend, par lui-même, de l’histoire d’Hassan, nous prouve qu’il a plusieurs fois aimé des femmes et continue à les porter dans son cœur. Au moment où on fait connaissance avec lui, il est nostalgique de ces amours et désire très fort en retrouver. Pour autant il ne se laisse pas prendre à des apparences ni à la facilité et il ne se décide à aimer vraiment la jeune Sabrine (en tout cas plus jeune que lui, bien qu’il ne soit pas un vieillard) que lorsqu’il la connaît suffisamment pour être sûr d’elle et de lui ; les liens forts et réciproques qu’il veut entre eux sont ceux du mariage auquel on assiste à la fin du film, elle est délicate et discrète sans l’ombre d’une vulgarité. C’est d’ailleurs une caractéristique constante du film que ne pas se compromettre avec la grossièreté, du moins pas Hassan, qui la réprouve et reste toujours naturellement distingué.
 Hassan est un gardien sans qu’on sache forcément quels sont les mondes dont il est question dans le titre du film. Mais ce titre, correspondant au métier qu’il s’est attribué à lui-même, veut dire qu’en dépit de toute misère matérielle (incluant la faim, la douleur physique et la maladie) il est conscient d’une sorte de devoir de sauvegarde, préserver ce qui est et ne rien lâcher. De toute évidence il a une grande expérience de la vie, dont il fait d’ailleurs rarement état mais dont il a retenu l’idée que la richesse est méprisable, parce qu’elle est source de laisser-aller. La retraite qu’il s’est aménagée au fond du cimetière l’autorise à juger le monde, mais sans l’amertume ni le cynisme d’un autre Diogène. La différence est dans l‘amour et c’est justement là que réside le secret de Hassan. L’amour qui est son credo n’est pas seulement, comme on l’a vu, celui d’une femme, il faut l’entendre de manière plus complexe et plus complète car il est à la fois physique et sensuel tout autant que sentimental et spirituel. Là réside peut-être la pluralité des mondes dont il se fait le gardien et ne veut rien sacrifier.
Hassan est un gardien sans qu’on sache forcément quels sont les mondes dont il est question dans le titre du film. Mais ce titre, correspondant au métier qu’il s’est attribué à lui-même, veut dire qu’en dépit de toute misère matérielle (incluant la faim, la douleur physique et la maladie) il est conscient d’une sorte de devoir de sauvegarde, préserver ce qui est et ne rien lâcher. De toute évidence il a une grande expérience de la vie, dont il fait d’ailleurs rarement état mais dont il a retenu l’idée que la richesse est méprisable, parce qu’elle est source de laisser-aller. La retraite qu’il s’est aménagée au fond du cimetière l’autorise à juger le monde, mais sans l’amertume ni le cynisme d’un autre Diogène. La différence est dans l‘amour et c’est justement là que réside le secret de Hassan. L’amour qui est son credo n’est pas seulement, comme on l’a vu, celui d’une femme, il faut l’entendre de manière plus complexe et plus complète car il est à la fois physique et sensuel tout autant que sentimental et spirituel. Là réside peut-être la pluralité des mondes dont il se fait le gardien et ne veut rien sacrifier.La fréquentation de la mort, sous la forme des crânes qui abondent dans le cimetière où beaucoup viennent se débarrasser de cadavres encombrants , n’est pas sans rapport avec son incontestable sagesse, qui est d’abord et avant tout le goût de la vie. La fin du film donne au spectateur le plaisir de partager la joie et l’émotion de Hassan et même si elles devaient être éphémères qu’importe, puisqu’en effet toute chose est périssable : loin d’être métaphysique c’est pour lui la plus physique des vérités.
Il faut peut-être ajouter pour finir que la parole inlassable d’Hassan n’épuise pas le mystère de l’homme qu’il est, ce qui signifie que sa créatrice, ou celle qui a su le trouver et nous le montrer , a voulu préserver l’étonnement de la rencontre avec un homme comme lui.
Denise Brahimi
« LE CINEMA AMAZIGH, GENRE DU CINEMA ALGERIEN OU CINEMA A PART, » par Latéfa Lafer, éditions du Croquant, 2022
Les films analysés dans ce livre sont au nombre de trois, considérés comme exemplaires de ce qu’est le cinéma amazigh, y compris dans sa diversité, et chacun des trois a droit à une étude monographique, mettant en valeur ses traits particuliers. Pour le dire d’emblée, et dans l’ordre chronologique, il s’agit de La Colline oubliée par Abderrahmane Bougermouh ; de La Montagne de Baya par Azzedine Meddour et de Machaho par Belkacem Hadjadj ; ils datent tous trois des années 90 du siècle dernier. C’est le moment où se crée en Algérie un secteur privé de production et de distribution des films, permettant d’échapper au strict contrôle d’Etat et d’exprimer une opposition à ce qu’a été jusque là le cinéma algérien. Tout ceci qui n’est pas toujours facile à comprendre, est expliqué de manière détaillée par Latéfa Lafer. En effet, de part et d’autre du socle constitué par les trois livres qu’elle privilégie, l’autrice du livre a ajouté, dans plusieurs chapitres, toute une série de faits et de réflexions personnelles bien informées, qui sont très précieuses à divers égards . Car ils et elles portent aussi bien sur l’art cinématographique en général, sur le cinéma algérien vu dans sa totalité depuis l’indépendance et sur le cinéma amazigh dans son rapport avec l’identité. Pour ce qui est en tout cas de ce dernier centre d’intérêt, on remarque très vite que loin de souscrire aux idées répandues, Latéfa Lafer apporte, avec force et conviction, des points de vue originaux. Elle vise à caractériser ce cinéma qu’on désigne non sans raison, comme identitaire, à condition que ce mot ne prenne pas un sens étroit et réducteur, voire régionaliste.
Tout ceci qui n’est pas toujours facile à comprendre, est expliqué de manière détaillée par Latéfa Lafer. En effet, de part et d’autre du socle constitué par les trois livres qu’elle privilégie, l’autrice du livre a ajouté, dans plusieurs chapitres, toute une série de faits et de réflexions personnelles bien informées, qui sont très précieuses à divers égards . Car ils et elles portent aussi bien sur l’art cinématographique en général, sur le cinéma algérien vu dans sa totalité depuis l’indépendance et sur le cinéma amazigh dans son rapport avec l’identité. Pour ce qui est en tout cas de ce dernier centre d’intérêt, on remarque très vite que loin de souscrire aux idées répandues, Latéfa Lafer apporte, avec force et conviction, des points de vue originaux. Elle vise à caractériser ce cinéma qu’on désigne non sans raison, comme identitaire, à condition que ce mot ne prenne pas un sens étroit et réducteur, voire régionaliste.
Elle le fait aussi bien dans ses analyses séparées de chacun des trois films que dans le regroupement thématique qu’elle opère à propos des trois grands sujets qui sont prégnants dans ce cinéma : La langue, la terre et les femmes.
Pour montrer à quel point elle est loin des positions qu’elle sait attendues, commençons par résumer très sommairement (en recommandant une lecture complète du livre) ce qu’il y a de remarquable dans ses positions à ce triple égard, grâce au fait que ce ne sont jamais des présentations purement thématiques mais bien davantage la confrontation avec des problématiques complexes, aux enjeux considérables. Ce n’est pas par hasard s’il y a dès le titre de ce livre un point d’interrogation car ce sont en effet beaucoup de questions qui s’y posent, qu’elles le soient par les trois réalisateurs ou par nous-mêmes lecteurs du livre—deux catégories par rapport auxquelles l’autrice se situe en position intermédiaire. Pour commencer par ce qui semblerait le plus évident et qui pourtant ne l’est pas, l’appartenance au cinéma amazigh n’est pas la conséquence immédiate de l’emploi de la langue amazighe, celle-ci n’est pas forcément une condition indispensable et en tout cas elle ne suffit pas. De toute façon, il n’y a pas de règle définissant cette appartenance en termes tout à fait clairs et formels ; pour ce qui est de la langue, il est certain qu’elle fait partie, de manière particulièrement visible, de la culture amazighe, mais l’objectif est de lutter contre l’effacement de celle-ci dans sa totalité, c’est-à-dire dans la diversité de ses aspects.
Pour commencer par ce qui semblerait le plus évident et qui pourtant ne l’est pas, l’appartenance au cinéma amazigh n’est pas la conséquence immédiate de l’emploi de la langue amazighe, celle-ci n’est pas forcément une condition indispensable et en tout cas elle ne suffit pas. De toute façon, il n’y a pas de règle définissant cette appartenance en termes tout à fait clairs et formels ; pour ce qui est de la langue, il est certain qu’elle fait partie, de manière particulièrement visible, de la culture amazighe, mais l’objectif est de lutter contre l’effacement de celle-ci dans sa totalité, c’est-à-dire dans la diversité de ses aspects.
S’agissant de la manière dont la terre y est évoquée , le cinéma amazigh se sépare nettement de la représentation qui en est donnée dans le cinéma algérien en général ; celui-ci en effet, dès ses débuts rattache tous les problèmes au fait de la posséder ou d’en être dépossédé ; on pourrait parler d’une perspective marxiste et c’est sans doute celle qui a été le plus souvent mise en avant par la décolonisation : tous les malheurs de la colonisation viendraient du fait que les paysans ont été dépossédés de leurs terres au profit des colons , au sens le plus matériel du mot, entraînant la grande majorité du pays dans une extrême pauvreté. Le cinéma amazigh montre que l’attachement à la terre a principalement une valeur culturelle voire symbolique, la terre est transportable, elle n’est pas, ne doit pas être, un enracinement. Et si elle le devient, il peut y avoir une régression très dommageable à un stade dangereusement archaïque.
Les films amazighs s’opposent aussi à une certaine représentation dominante des femmes, due à la même lecture plus ou moins marxiste de leur situation en Algérie. Le cinéma algérien en général montre qu’elles doivent lutter contre la soumission et la dépendance, en passant par les voies connues de l’émancipation, le travail, l’autonomie financière, un certain contrôle sur leur corps…tout ce qui leur manque, ou leur manquerait, de manière séculaire en Algérie. Il est évident que les films amazighs ne correspondent en aucune manière à cette représentation des femmes, et qu’elles y sont au contraire détentrices de toute sorte de pouvoirs, qui ne permettent pas de les définir comme dominées, pour reprendre un terme utilisé par le sociologue Pierre Bourdieu. En tout cas les femmes ne sont pas plus victimes que les hommes, il n’y a pas des victimes d’un côté et des dominateurs de l’autre. Le cinéma amazigh a pour premier effet de rompre avec des stéréotypes ressassés.
D’une manière générale, les différentes caractéristiques du cinéma amazigh sont en rupture avec tout ce que nous a montré le cinéma algérien (dont Latéfa Lafer utilise maint exemple) depuis l’indépendance. Dans ces conditions il est difficile de ne pas lui faire un sort particulier et de ne voir en lui qu’une catégorie au sein du vaste ensemble national. C’est plutôt d’une mise en question qu’il s’agit et donc d’un cinéma à part, vraiment différent Il est certain qu’il a été ressenti de cette manière par ses nombreux adeptes, même si les conditions de distribution des films ont maintenu ceux-ci dans une sphère géographique restreinte- certainement trop restreinte par rapport à leur signification potentielle. Tel est le paradoxe du cinéma amazigh, il est certainement moins connu que la chanson kabyle si aisément transportable et reproductible. Et même moins connu que les arts plastiques, si différents de ce qu’on appelle l’art arabe qu’on ne saurait s’y tromper. Latéfa Lafer fait donc un travail très important en rappelant la grande originalité du cinéma amazigh au sein de la production nationale et en s’opposant à certains critères qu’on croit utile pour le définir. Quoi qu’il en soit, il paraît acquis voire évident que les films amazighs ont atteint leur objectif commun : donner une visibilité à l’identité amazighe. Ils ont réactualisé une revendication rendue plus aiguë par les affrontements sanglants de la décennie à laquelle ils appartiennent.
Denise Brahimi
Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.
 – Utiles
– Utiles
de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun
Cliquez ici pour voir le film

–Entre nos mains
de Leila Saadna
Cliquez ici pour voir le film,
Et sa bande-annonce, cliquez ici

Si vous souhaitez aider notre association régionale à développer ses actions, vous avez aussi la possibilité de faire un DON, via Hello Asso. Soyez-en remercié.e.s.
Si vous souhaitez vous investir à nos côtés, nous serions heureux d’accueillir votre adhésion. Il vous est possible de le faire en ligne sur notre site via Hello Asso.

Vous pouvez aussi nous commander notre livre « Algérie à coeur » en envoyant un chèque de 16€, port compris,
chez Michel Wilson 5 rue Auguste Comte 69002 LYON.
Et également vous avez la possibilité de souscrire en ligne sur notre site à l’ultime numéro de la Revue Le Croquant, un hommage à son créateur Michel Cornaton, que nous avons co-édité.
Nous souhaitons aussi contribuer à la diffusion du livre posthume de notre cher Abdelhamid LAGHOUATI, poète, artiste plasticien, ami de Jean Sénac et de tant d’autres. Une souscription est ouverte pour commander son livre par la Maison de la Poésie Rhône-Alpes à Saint Martin d’Hères.
SOUSCRIPTION
BON DE COMMANDE
Je commande .. .. .. .. exemplaire(s) de « Entre cri et passion » de Abdelhamid Laghouati.
Je règle par : ☐ chèque bancaire
☐ autre moyen (sauf carte bancaire)
☐ postal
À l’ordre de :
Maison de la Poésie Rhône-Alpes
33 avenue Ambroise Croizat
38400 Saint-Martin-d’Hères
Date : .. .. / .. .. / .. .. Signature :

- Jeudi 29 septembre, dans le cadre du festival Les Inattendus à Lyon, projection du film « Gardien des Mondes » de Leila Chaibi au Périscope.
- Samedi 1er octobre, à l’Espace Nelson Mandela de Clermont Ferrand, projection du film Torba sur une association algérienne développant des projets d’agroécologie, et conférence du professeur Omar Bessaoud sur l’histoire et l’actualité de l’Algérie vues à travers les transformations agraires subies depuis deux siècles par ce pays.
- Lundi 3 octobre au Cinéma Lumière Terreaux de Lyon, à 20h, avant-première du Film Les Harkis de Philippe Faucon, débat animé par Michel Wilson, vice président de Coup de Soleil AuRA.
- Vendredi 7 octobre, au cinéma L’Opéra de Lyon, Projection du film « Les femmes du pavillon J », en présence de son auteur, Mohamed Nadif, débat animé par Tahar Ben Meftah, universitaire, et président du Maghreb des Films en Rhône-Alpes
- Jeudi 13 octobre à 11h vernissage de l’exposition « En guerre d’Algérie », aux Archives de Saint-Etienne.
- Samedi 15 octobre, à Grenoble à la Bibliothèque d’études et du Patrimoine, « La littérature algérienne de langue française, une histoire à suivre », avec Salim Jay, Habib Tengour, Hervé Samson. Dans le cadre des manifestations « Algérie 1962-2022 » organisées par plusieurs villes de l’agglomération grenobloise et leurs partenaires.
N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.